
Parution des numéros 455 et 456 du Bulletin célinien
N°455:
Sommaire :
 Hommage à Robert Le Vigan [1972 – 2022]
Hommage à Robert Le Vigan [1972 – 2022]
Le Vigan à Montmartre
Rencontre avec Le Vigan (1939)
Une amitié épistolaire
Propos d’exil
Le procès de Le Vigan
À Fresnes
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Parution des numéros 455 et 456 du Bulletin célinien
N°455:
Sommaire :
 Hommage à Robert Le Vigan [1972 – 2022]
Hommage à Robert Le Vigan [1972 – 2022]
Le Vigan à Montmartre
Rencontre avec Le Vigan (1939)
Une amitié épistolaire
Propos d’exil
Le procès de Le Vigan
À Fresnes

Les historiens, qui n’aiment guère Céline, sont rarement d’accord entre eux. « Céline a été un collaborateur enthousiaste de l’Allemagne nazie », déclare Pierre-André Taguieff¹. Ce n’est pas l’avis de Pascal Ory qui évoque « une collaboration hypocondriaque »². Divergence aussi quant au jugement du 21 février 1950 : « Le jugement qui le sanctionne est d’une sévérité extrême », constate Anne Simonin³. Pas du tout, affirme sa consœur Odile Roynette observant que « le verdict de la Cour de Justice s’avéra indulgent »4. À cet égard, elle commet une erreur dans le livre qu’elle lui a consacré : Céline a été uniquement condamné au titre de l’article 83-4 du Code pénal (pour “actes de nature à nuire à la défense nationale”), et non du fait de ses prises de position antisémites (p. 177). La même cite Drieu la Rochelle et Brasillach, « anciens combattants de la Grande Guerre, comme Céline » (p. 243). Apprenons lui que Brasillach avait cinq ans en 1914 et que son père mourut au combat. Il est assez étonnant que ces historiennes, rigoureuses l’une et l’autre, commettent de telles erreurs. Ainsi, Simonin affirme avec force que la seule fois où Céline utilise une note infrapaginale, c’est dans Les Beaux draps. Or il recourt à ce procédé dans Semmelweis [1936, éd., p. 89] et dans L’École des cadavres. (p. 35). Les allégations erronées sont une chose, les commentaires où perce de manière constante le dénigrement en sont une autre. À propos de la guerre de Louis Destouches, Roynette évoque des « actes prétendument héroïques » et dresse, au fil des pages, le portrait d’un homme humainement peu fréquentable, affabulateur médiocre et calculateur. Il s’agit surtout de tenter de démontrer que sa blessure n’était pas si grave et que Destouches aurait logiquement dû retourner au combat au lieu de « s’embusquer » à Londres. Simonin renchérit et évoque « une médaille [militaire] que Céline a obtenue sans qu’on sache comment [sic]. »5 Et de faire l’amalgame entre Louis Destouches et le narrateur de Guerre pour mieux discréditer le premier. Bien entendu, elle est hostile à la réédition des pamphlets, ne comprenant pas cette « insistance à revisiter la bibliothèque antisémite française. » Or ce corpus est abondamment commenté ici et là : ne serait-il pas utile qu’il soit autant accessible que les explications le concernant ? On s’étonne qu’un historien ne veuille résoudre ce paradoxe. On peut aussi se demander si celui-ci est dans son rôle lorsqu’il adopte de manière constante une rhétorique moralisatrice même quand la conduite de Louis Destouches est exempte de tout reproche, comme ce fut assurément le cas en 1914. Pas que les historiens. Ainsi, un lecteur de L’Express, domicilié à Courbevoie (!), déplore que, dans un article consacré à Guerre, il ne soit pas rappelé que Céline « fut aussi collaborationniste, antisémite et frappé d’indignité nationale »6. Ce lecteur est-il également déçu lorsqu’un article sur Aragon ne rappelle pas ses turpitudes staliniennes ? Étant entendu que les dévoiements de l’un n’excusent pas ceux de l’autre.
N°456
Sommaire :
 Entretien avec Frédéric Hardouin –
Entretien avec Frédéric Hardouin –
Deux points de vue inattendus sur Guerre –
Le cas Thibaudat –
Yvon Morandat –
Héritage –
Les Hussards, suite et fin –
“Martynabe” persiste mais ne convainc pas.
Au départ, il s’agit d’une thèse de doctorat : “Le style réactionnaire : positions de la droite littéraire française sur la langue et le style au XXe siècle ». Ayant à y revenir afin de l’adapter pour l’édition, son auteur ne cache pas que cela lui a procuré « un sentiment nauséeux » [sic]¹. Une plongée dans l’œuvre de Bernanos, Marcel Aymé, Paul Morand, Antoine Blondin, Jacques Laurent, pour ne citer qu’eux, est-elle de nature à susciter cette réaction répulsive ? Pour ce jeune universitaire qui traque les menées de la Réaction dans les lettres, c’est assurément le cas. Et lorsqu’un bas-bleu lui demande si prendre du plaisir à lire Céline fait d’elle une réactionnaire qui s’ignore, il recommande « de lire du Sartre pour se laver un peu l’esprit »². C’est que pour ce jeune universitaire, animateur d’un séminaire “Lectures de Marx”, il s’agit de combattre l’idée selon laquelle les réactionnaires sont de grands stylistes irréprochables. Ce livre rappelle irrésistiblement celui de l’inénarrable Daniel Lindenberg qui, dans son Rappel à l’ordre : enquête sur les nouveaux réactionnaires (2002) fustigeait déjà Houellebecq mais aussi Philippe Muray. Si Berthelier ne lui accorde pas un chapitre entier, il consacre tout de même quelques pages à Céline, histoire de tancer au passage ses « idées exterminatrices ». Peu importe que les exégètes céliniens les moins complaisants à son égard, tels Godard ou Tettamanzi, répètent à l’envi qu’il n’y a pas chez lui d’appel au meurtre des juifs.

Berthelier maîtrise manifestement mal ce sujet. Si l’on trouve des tropismes réactionnaires chez Céline, il ne peut de toute évidence être réduit à ça. La Réaction étant ce qui s’oppose au progrès social, cela cadre mal avec les réformes proposées, par exemple, dans Les Beaux draps. En réalité, vouloir enfermer Céline dans un carcan (conservateur, fasciste ou anarchiste) s’avère une impasse. Il apparaît davantage comme un hapax que comme un échantillon représentatif des écrivains de droite. Précisément en raison du style. Dans sa Poétique de Céline, Henri Godard affirme que son écriture est à contre-courant de son idéologie, le plaisir que procure au lecteur le style célinien ayant un pouvoir libérateur. Lequel serait en opposition avec un fascisme de l’ordre réprimant les instincts³. Ce qu’avait contesté, on s’en souvient, Marie-Christine Bellosta qui estime au contraire que son style est en phase avec cette idéologie dans la mesure où elle se présente précisément comme un triomphe de l’instinctif sur l’intellectualité4. Il est exact que la droite révolutionnaire a souvent utilisé les ressources de la verve populaire. Mais est-ce typiquement “fasciste” ? On retrouve des procédés analogues chez Hébert, le créateur du Père Duchesne. Rendant compte du livre de Berthelier, un critique en arrive même à se demander s’il faut considérer le lyrisme célinien comme le véhicule de son fascisme (!)5. Tout cela est grotesque. Sur son site internet, l’auteur clame que son livre mérite d’être acheté. On n’est jamais mieux servi que par soi-même.
• Vincent BERTHELIER, Le style réactionnaire (De Maurras à Houellebecq), Éditions Amsterdam, 2022, 385 p. (22 €)
19:02 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, bulletin célinien, louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Edward Bernays et Louis-Ferdinand Céline face au conditionnement moderne
par Nicolas Bonnal
Avant d’étudier Bernays, on rappellera Céline. Apparemment, tout les oppose, mais sur l’essentiel ils sont d’accord : le monde moderne nous conditionne !
« Nous disions qu'au départ, tout article à "standardiser": vedette, écrivain, musicien, politicien, soutien-gorge, cosmétique, purgatif, doit être essentiellement, avant tout, typiquement médiocre. Condition absolue. Pour s'imposer au goût, à l'admiration des foules les plus abruties, des spectateurs, des électeurs les plus mélasseux, des plus stupides avaleurs de sornettes, des plus cons jobardeurs frénétiques du Progrès, l'article à lancer doit être encore plus con, plus méprisable qu'eux tous à la fois. »
Bernays… C’est un des personnages les plus importants de l’histoire moderne, et on ne lui a pas suffisamment rendu hommage ! Il est le premier à avoir théorisé l’ingénierie du consensus et la définition du despotisme éclairé. Reprenons Normand Baillargeon :
Edouard Bernays est un expert en contrôle mental et en conditionnement de masse. C’est un neveu viennois de Freud, et comme son oncle un lecteur de Gustave Le Bon. Il émigre aux États-Unis, sans se préoccuper de ce qui va se passer à Vienne... Journaliste (dont le seul vrai rôle est de créer une opinion, de l’in-former au sens littéral), il travaille avec le président Wilson au Committee on Public Information, au cours de la première Guerre Mondiale. Dans les années Vingt, il applique à la marchandise et à la politique les leçons de la guerre et du conditionnement de masse ; c’est l’époque du spectaculaire diffus, comme dit Debord. A la fin de cette fascinante et marrante décennie, qui voit se conforter la société de consommation, le KKK en Amérique, le fascisme et le bolchévisme en Europe, le surréalisme et le radicalisme en France, qui voit progresser la radio, la presse illustrée et le cinéma, Bernays publie un très bon livre intitulé Propagande (la première congrégation de propagande vient de l’Eglise catholique, créée par Grégoire XV en 1622) où le plus normalement et le plus cyniquement du monde il dévoile ce qu’est la démocratie américaine moderne : un simple système de contrôle des foules à l’aide de moyens perfectionnés et primaires à la fois ; et une oligarchie, une cryptocratie plutôt où le sort de beaucoup d’hommes, pour prendre une formule célèbre, dépend d’un tout petit nombre de technocrates et de faiseurs d’opinion. C’est Bernays qui a imposé la cigarette en public pour les femmes ou le bacon and eggsau petit déjeuner par exemple : dix ans plus tard les hygiénistes nazis, aussi forts que lui en propagande (et pour cause, ils le lisaient) interdisent aux femmes de fumer pour raisons de santé. Au cours de la seconde guerre mondiale il travaille avec une autre cheville ouvrière d’importance, Walter Lippmann.
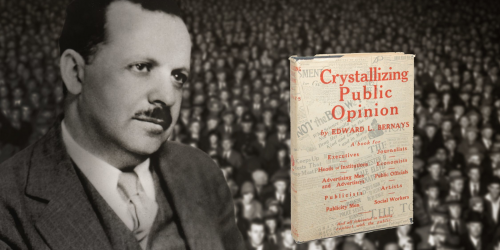
Avec un certain culot Bernays dévoile les arcanes de notre société de consommation. Elle est conduite par une poignée de dominants, de gouvernants invisibles. Rétrospectivement on trouve cette confession un rien provocante et –surtout – imprudente. A moins qu’il ne s’agît à l’époque pour ce fournisseur de services d’épater son innocente clientèle américaine ?
“Oui, des dirigeants invisibles contrôlent les destinées de millions d'êtres humains. Généralement, on ne réalise pas à quel point les déclarations et les actions de ceux qui occupent le devant de la scène leur sont dictées par d'habiles personnages agissant en coulisse.”
Bernays reprend l’image fameuse de Disraeli dans Coningsby: l’homme-manipulateur derrière la scène. C’est l’image du parrain, en fait un politicien, l’homme tireur de ficelles dont l’expert russe Ostrogorski a donné les détails et les recettes dans son classique sur les partis politiques publié en 1898, et qui est pour nous supérieur aux Pareto-Roberto Michels. Nous sommes dans une société technique, dominés par la machine (Cochin a récupéré aussi l’expression d’Ostrogorski) et les tireurs de ficelles, ou wire-pullers (souvenez-vous de l’affiche du Parrain, avec son montreur de marionnettes) ; ces hommes sont plus malins que nous, Bernays en conclut qu’il faut accepter leur pouvoir. La société sera ainsi plus smooth. On traduit ?
Comme je l’ai dit, Bernays écrit simplement et cyniquement. On continue donc:
“Les techniques servant à enrégimenter l'opinion ont été inventées puis développées au fur et à mesure que la civilisation gagnait en complexité et que la nécessité du gouvernement invisible devenait de plus en plus évidente.”
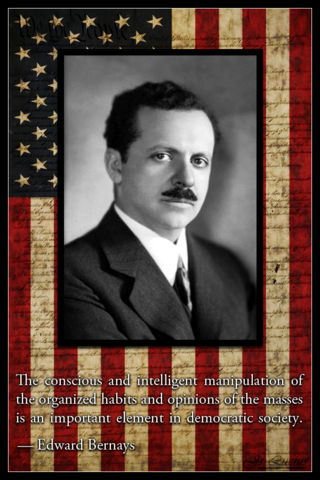
La complexité suppose des élites techniques, les managers dont parle Burnham dans un autre classique célèbre (l’ère des managers, préfacé en France par Léon Blum en 1946). Il faut enrégimenter l’opinion, comme au cours de la première guerre mondiale, qui n’aura servi qu’à cela : devenir communiste, anticommuniste, nihiliste, consommateur ; comme on sait le nazisme sera autre chose, d’hypermoderne, subtil et fascinant, avec sa conquête spatiale et son techno-charisme – modèle du rock moderne (lisez ma damnation des stars).
L’ère des masses est aussi très bien décrite – mais pas comprise – par Ortega Y Gasset (il résume tout dans sa phrase célèbre ; « les terrasses des cafés sont pleines de consommateurs »…). Et cette expression, ère des masses, traduit tristement une standardisation des hommes qui acceptent humblement de se soumettre et de devenir inertes (Tocqueville, Ostrogorski, Cochin aussi décrivaient ce phénomène).
“Nous acceptons que nos dirigeants et les organes de presse dont ils se servent pour toucher le grand public nous désignent les questions dites d'intérêt général ; nous acceptons qu'un guide moral, un pasteur, par exemple, ou un essayiste ou simplement une opinion répandue nous prescrivent un code de conduite social standardisé auquel, la plupart du temps, nous nous conformons.”
Pour Bernays bien sûr on est inerte quand on résiste au système oppressant et progressiste (le social-corporatisme dénoncé dans les années 80 par Minc & co).
La standardisation décrite à cette époque par Sinclair Lewis dans son fameux Babbitt touche tous les détails de la vie quotidienne : Babbitt semble un robot humain plus qu’un chrétien (il fait son Church-shopping à l’américaine d’ailleurs), elle est remarquablement rendue dans le cinéma comique de l’époque, ou tout est mécanique, y compris les gags. Bergson a bien parlé de ce mécanisme plaqué sur du vivant. Il est favorisé par le progrès de la technique :
« Il y a cinquante ans, l'instrument par excellence de la propagande était le rassemblement public. À l'heure actuelle, il n'attire guère qu'une poignée de gens, à moins que le programme ne comporte des attractions extraordinaires. L'automobile incite nos compatriotes à sortir de chez eux, la radio les y retient, les deux ou trois éditions successives des quotidiens leur livrent les nouvelles au bureau, dans le métro, et surtout ils sont las des rassemblements bruyants. »
La capture de l’esprit humain est l’objectif du manipulateur d’opinion, du spécialiste en contrôle mental, cet héritier du magicien d’Oz.
“La société consent à ce que son choix se réduise aux idées et aux objets portés à son attention par la propagande de toute sorte. Un effort immense s'exerce donc en permanence pour capter les esprits en faveur d'une politique, d'un produit ou d'une idée.”
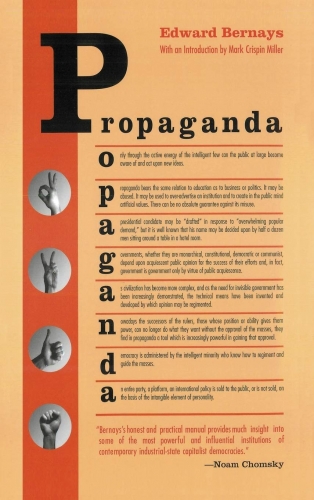
Concernant la première guerre mondiale, Bernays “révise” simplement l’Histoire en confiant que la croisade des démocraties contre l’Allemagne s’est fondée sur d’habituels clichés et mensonges ! Il a d’autant moins de complexes que c’est lui qui a mis cette propagande au point…
“Parallèlement, les manipulateurs de l'esprit patriotique utilisaient les clichés mentaux et les ressorts classiques de l'émotion pour provoquer des réactions collectives contre les atrocités alléguées, dresser les masses contre la terreur et la tyrannie de l'ennemi. Il était donc tout naturel qu'une fois la guerre terminée, les gens intelligents s'interrogent sur la possibilité d'appliquer une technique similaire aux problèmes du temps de paix.”
On n'a jamais vu un cynisme pareil. Machiavel est un enfant de chœur. La standardisation s’applique bien sûr à la politique. Il ne faut pas là non plus trop compliquer les choses, écrit Bernays. On a trois poudres à lessive pour laver le linge, qui toutes appartiennent à Procter & Gamble (les producteurs de soap séries à la TV) ou à Unilever ; et bien on aura deux ou trois partis politiques, et deux ou trois programmes simplifiés !
Bernays reprend également l’expression demachinede Moïse Ostrogorski (voir notre étude sur ce chercheur russe, qui disséqua et désossa l'enfer politique américain), qui décrit l’impeccable appareil politique d’un gros boss. La machine existe déjà chez le baroque Gracian. Ce qui est intéressant c’est de constater que la mécanique politique – celle qui a intéressé Cochin - vient d’avant la révolution industrielle. Le mot industrie désigne alors l’art du chat botté de Perrault, celui de tromper, d’enchanter – et de tuer ; l’élite des chats bottés de la politique, de la finance et de l’opinion est une élite d’experts se connaissant, souvent cooptés et pratiquant le prosélytisme. Suivons le guide :
“Il n'en est pas moins évident que les minorités intelligentes doivent, en permanence et systématiquement, nous soumettre à leur propagande. Le prosélytisme actif de ces minorités qui conjuguent l'intérêt égoïste avec l'intérêt public est le ressort du progrès et du développement des États-Unis. Seule l'énergie déployée par quelques brillants cerveaux peut amener la population tout entière à prendre connaissance des idées nouvelles et à les appliquer.”
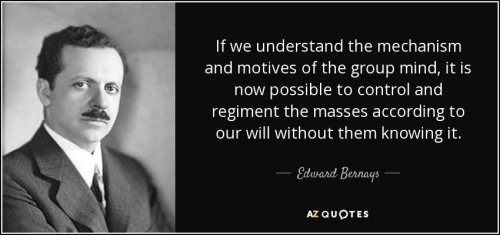
Comme je l’ai dit, cette élite n’a pas besoin de prendre de gants, pas plus qu’Edouard Bernays. Il célèbre d’ailleurs son joyeux exercice de style ainsi :
“Les techniques servant à enrégimenter l'opinion ont été inventées puis développées au fur et à mesure que la civilisation gagnait en complexité et que la nécessité du gouvernement invisible devenait de plus en plus évidente.”
La démocratie a un gouvernement invisible qui nous impose malgré nous notre politique et nos choix. Si on avait su…
Après la Guerre, Bernays inspire le méphitique Tavistock Institute auquel Daniel Estulin a consacré un excellent et paranoïaque ouvrage récemment.
Mais en le relisant, car cet ouvrage est toujours à relire, je trouve ces lignes définitives sur l'organisation conspirative de la vie politique et de ses partis :
« Le gouvernement invisible a surgi presque du jour au lendemain, sous forme de partis politiques rudimentaires. Depuis, par esprit pratique et pour des raisons de simplicité, nous avons admis que les appareils des partis restreindraient le choix à deux candidats, trois ou quatre au maximum. »
Et cette conspiration était n'est-ce pas très logique, liée à l’esprit pratique et à la simplicité :
« Les électeurs américains se sont cependant vite aperçus que, faute d'organisation et de direction, la dispersion de leurs voix individuelles entre, pourquoi pas, des milliers de candidats ne pouvait que produire la confusion ».
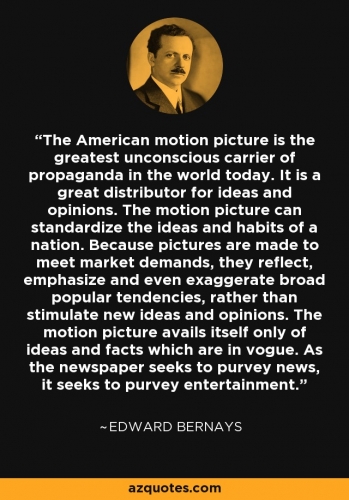
Pour le grand Bernays il n'y a de conspiration que logique. La conspiration n'est pas conspirative, elle est indispensable. Sinon tout s'écroule. L'élite qu'il incarne, et qui œuvre d'ailleurs à l’époque de Jack London, ne peut pas ne pas être. Et elle est trop souple et trop liquide pour se culpabiliser. N'œuvre-t-elle pas à la réconciliation franco-allemande après chaque guerre qu'elle a contribué à déclencher, et que la Fed a contribué à financer au-delà des moyens de tous ?
Elle est aussi innocente que l'enfant qui vient de naître.
Un qui aura bien pourfendu Bernays sans le savoir dans ses pamphlets est Louis-Ferdinand Céline. Sur la standardisation par exemple, voici ce qu’il écrit :
« Standardisons! le monde entier! sous le signe du livre traduit! du livre à plat, bien insipide, objectif, descriptif, fièrement, pompeusement robot, radoteur, outrecuidant et nul. »
Et d’ajouter sur un ton incomparable et une méchanceté inégalable :
« le livre pour l'oubli, l'abrutissement, qui lui fait oublier tout ce qu'il est, sa vérité, sa race, ses émotions naturelles, qui lui apprend mieux encore le mépris, la honte de sa propre race, de son fond émotif, le livre pour la trahison, la destruction spirituelle de l'autochtone, l'achèvement en somme de l'œuvre bien amorcée par le film, la radio, les journaux et l'alcoolisme. »
La standardisation (j’écris satan-tardisation…) rime avec la mort (mais n’étions-nous pas morts avant, cher Ferdinand ? Vois Drumont, Toussenel même, ce bon Cochin, ce génial Villiers…). Le monde est mort, et on a pu ainsi le réifier et le commercialiser ;
« Puisque élevés dans les langues mortes ils vont naturellement au langage mort, aux histoires mortes, à plat, aux déroulages des bandelettes de momies, puisqu'ils ont perdu toute couleur, toute saveur, toute vacherie ou ton personnel, racial ou lyrique, aucun besoin de se gêner! Le public prend ce qu'on lui donne. Pourquoi ne pas submerger tout! simplement, dans un suprême effort, dans un coup de suprême culot, tout le marché français, sous un torrent de littérature étrangère? Parfaitement insipide?... »
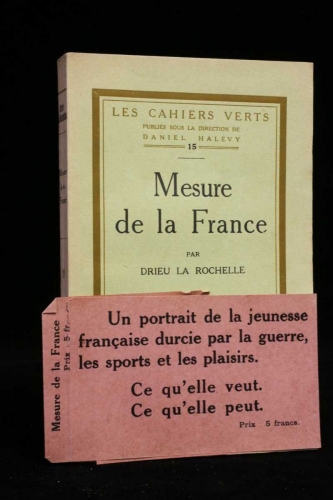
Divaguons sur ce thème de la civilisation mortelle – et sortons du Valéry pour une fois. A la même époque Drieu la Rochelle écrivait dans un beau libre préfacé par Halévy, Mesure de la France :
« Il n'y a plus de conservateurs, de libéraux, de radicaux, de socialistes. Il n'y a plus de conservateurs, parce qu'il n'y a plus rien à conserver. Religion, famille, aristocratie, toutes les anciennes incarnations du principe d'autorité, ce n'est que ruine et poudre. »
Puis Drieu enfonce plus durement le clou (avait-il déjà lu Guénon ?) :
« Tous se promènent satisfaits dans cet enfer incroyable, cette illusion énorme, cet univers de camelote qui est le monde moderne où bientôt plus une lueur spirituelle ne pénétrera. »
Le gros shopping planétaire est mis en place par la matrice américaine, qui va achever de liquider la vieille patrie prétentieuse :
« Il n'y a plus de partis dans les classes, plus de classes dans les nations, et demain il n'y aura plus de nations, plus rien qu'une immense chose inconsciente, uniforme et obscure, la civilisation mondiale, de modèle européen. »
Drieu affirme il y a cent ans que le catholicisme romain est zombie :
« Le Vatican est un musée. Nous ne savons plus bâtir de maisons, façonner un siège où nous y asseoir. A quoi bon défendre des banques, des casernes, et les Galeries Lafayette ? »
Enfin, vingt ans avant Heidegger ou Ellul, Drieu désigne la technique et l’industrie comme les vrais conspirateurs :
« Il y aura beaucoup de conférences comme celle de Gênes où les hommes essaieront de se guérir de leur mal commun : le développement pernicieux, satanique, de l'aventure industrielle. »

Revenons à Céline, qui avec ferveur et ire dépeint la faune nouvelle de l’art pour tous :
« Les grands lupanars d'arts modernes, les immenses clans hollywoodiens, toutes les sous-galères de l'art robot, ne manqueront jamais de ces saltimbanques dépravés... Le recrutement est infini. Le lecteur moyen, l'amateur rafignolesque, le snob cocktailien, le public enfin, la horde abjecte cinéphage, les abrutis-radios, les fanatiques envedettés, cet international prodigieux, glapissant, grouillement de jobards ivrognes et cocus, constitue la base piétinable à travers villes et continents, l'humus magnifique le terreau miraculeux, dans lequel les merdes publicitaires vont resplendir, séduire, ensorceler comme jamais. »
Et de conclure avec son habituelle outrance que l’époque de l’inquisition et des gladiateurs valait bien mieux :
« Jamais domestiques, jamais esclaves ne furent en vérité si totalement, intimement asservis, invertis corps et âmes, d'une façon si dévotieuse, si suppliante. Rome? En comparaison?... Mais un empire du petit bonheur! une Thélème philosophique! Le Moyen Age?... L'Inquisition?... Berquinades! Epoques libres! d'intense débraillé! d'effréné libre arbitre! le duc d'Albe? Pizarro? Cromwell? Des artistes! »
Dans son très bon livre sur Spartacus, l’écrivain juif communiste Howard Fast établit lui aussi un lien prégnant entre la décadence impériale et son Amérique ploutocratique. C’est que l’homme postmoderne et franchouillard a du souci à se faire (ce que Léon Bloy nommait sa capacité bourgeoise à avaler – surtout de la merde) :
« Plus c'est cul et creux, mieux ça porte. Le goût du commun est à ce prix. Le "bon sens" des foules c'est : toujours plus cons. L'esprit banquiste, il se finit à la puce savante, achèvement de l'art réaliste, surréaliste. Tous les partis politiques le savent bien. Ce sont tous des puciers savants. La boutonneuse Mélanie prend son coup de bite comme une reine, si 25.000 haut-parleurs hurlent à travers tous les échos, par-dessus tous les toits, soudain qu'elle est Mélanie l'incomparable... Un minimum d'originalité, mais énormément de réclame et de culot. L'être, l'étron, l'objet en cause de publicité sur lequel va se déverser la propagande massive, doit être avant tout au départ, aussi lisse, aussi insignifiant, aussi nul que possible. La peinture, le battage-publicitaire se répandra sur lui d'autant mieux qu'il sera plus soigneusement dépourvu d'aspérités, de toute originalité, que toutes ses surfaces seront absolument planes. Que rien en lui, au départ, ne peut susciter l'attention et surtout la controverse. »
Et comme s’il avait lu et digéré Bernays Céline ajoute avec le génie qui caractérise ses incomparables pamphlets :
« La publicité pour bien donner tout son effet magique, ne doit être gênée, retenue, divertie par rien. Elle doit pouvoir affirmer, sacrer, vociférer, mégaphoniser les pires sottises, n'importe quelle himalayesque, décervelante, tonitruante fantasmagorie... à propos d'automobiles, de stars, de brosses à dents, d'écrivains, de chanteuses légères, de ceintures herniaires, sans que personne ne tique... ne s'élève au parterre, la plus minuscule naïve objection. Il faut que le parterre demeure en tout temps parfaitement hypnotisé de connerie.
Le reste, tout ce qu'il ne peut absorber, pervertir, déglutir, saloper standardiser, doit disparaître. C'est le plus simple. Il le décrète. Les banques exécutent. Pour le monde robot qu'on nous prépare, il suffira de quelques articles, reproductions à l'infini, fades simulacres, cartonnages inoffensifs, romans, voitures, pommes, professeurs, généraux, vedettes, pissotières tendancieuses, le tout standard, avec énormément de tam-tam d'imposture et de snobisme La camelote universelle, en somme, bruyante, juive et infecte... »

Et de poursuivre sa belle envolée sur la standardisation :
« Le Standard en toutes choses, c'est la panacée. Plus aucune révolte à redouter des individus pré-robotiques, que nous sommes, nos meubles, romans, films, voitures, langage, l'immense majorité des populations modernes sont déjà standardisés. La civilisation moderne c'est la standardisation totale, âmes et corps. »
La violence pour finir :
« Publicité ! Que demande toute la foule moderne ? Elle demande à se mettre à genoux devant l'or et devant la merde !... Elle a le goût du faux, du bidon, de la farcie connerie, comme aucune foule n'eut jamais dans toutes les pires antiquités... Du coup, on la gave, elle en crève... Et plus nulle, plus insignifiante est l'idole choisie au départ, plus elle a de chances de triompher dans le cœur des foules... mieux la publicité s'accroche à sa nullité, pénètre, entraîne toute l'idolâtrie... Ce sont les surfaces les plus lisses qui prennent le mieux la peinture. »
Céline est incomparable quand il s’attaque à la foule, discutable quand il reprend le lemme du juif comme missionnaire du mal dans le monde moderne. Mais c’est cette folie narrative qui crée la tension géniale de son texte. De toute manière, ce n’est pas notre sujet. Et puis c’est Disraeli et c’est Bernays qui ont joué à l’homme invisible un peu trop visible. Comme dit Paul Johnson dans sa fameuse Histoire des Juifs (p. 329): “Thus Disraeli preached the innate superiority of certain races long before the social Darwinists made it fashionable, or Hitler notorious.”
Bibliographie:
Nicolas Bonnal – Littérature et conspiration (Dualpha, Amazon.fr)
Frédéric Bernays/Normand Baillargeon – Propagande
Céline – Bagatelles…
Drieu la Rochelle – Mesure de la France
Johnson (Paul) – A History of the Jews
19:57 Publié dans Littérature, Manipulations médiatiques, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edward bernays, louis-ferdinand céline, céline, nicolas bonnal, propagande, manipulatiosn médiatiques, conditionnement, contrôle mental, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

16:59 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, livre, frédéric andreu |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Cinquantième anniversaire de la mort d'Henry de Montherlant
"La liberté existe toujours. Elle n'en paie que le prix".
Par Eduardo Nuñez
Source: https://www.tradicionviva.es/2022/09/22/50-aniversario-de-la-muerte-de-henry-de-montherlant/?fbclid=IwAR2pDQowh7lp6hSpFz_UsAAi2s0CmoVtjiFtOmT3mczvOR8WKlhHqNCTPrQ
Henry de Montherlant était un romancier, essayiste, dramaturge et universitaire français d'origine catalane, et l'un des meilleurs écrivains de langue française du 20ème siècle.
Il est né à Paris le 20 avril 1895. Issu d'une famille noble et aristocratique, il a été éduqué dans un élitisme influencé par Maurice Barrès et Nietzsche, et était un ardent nationaliste et sportif qui combinait les valeurs du paganisme et de la religion chrétienne.
Sa principale contribution à la littérature française est un cycle de quatre romans élégamment écrits, qui expriment des analyses intérieures. Sa renommée en tant que dramaturge repose sur ses nombreux drames historiques, dont "Malatesta" (1946), "Le Maître de Santiago" (1947) et "Port-Royal" (1954).
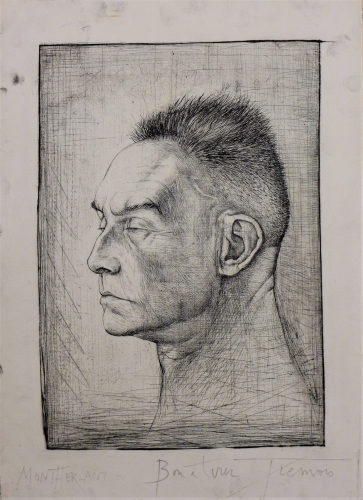
Montherlant a combattu pendant la Première Guerre mondiale, une expérience qu'il a retranscrite dans son roman "Songe". Se consacrant au théâtre et aux essais, il a joué plusieurs pièces à succès telles que "La reine morte" (1934) et "La Ville dont le prince est un enfant", qui a été transformée en pièce télévisée en 1997.
De son expérience communautaire, religieuse et amicale à l'école Sainte-Croix de Neuilly, sont nés Relève du matin (1920), La ville dont le prince est un enfant (1951) et Les garçons (1969). Mobilisé en 1916, blessé au combat et décoré, son roman autobiographique Songe (1922) est une exaltation de l'héroïsme et de la fraternité. Dans ses œuvres ultérieures, Les bestiaires (1926), Les olympiques (1924), Aux fontaines du désir (1927), La petite infante de Castille (1929), etc., on retrouve le même esprit héroïque et fraternel que pendant la guerre, jusqu'à ce que son roman Les jeunes filles (1936-1939), mélange de tyrannie possessive et de renoncement, d'intégrité et d'amoralité, déclare ouvertement sa misogynie.

À partir des années 1940, au sommet de sa maturité intellectuelle et de sa maîtrise de la langue, le théâtre occupe une place prépondérante dans sa production littéraire. De plus, la demande qu'il reçoit de la Comédie-Française d'adapter une comédie de l'âge d'or espagnol - il opte pour Reinar después de morir de Vélez de Guevara - confirme son intérêt pour les thèmes hispaniques, qui avait commencé avec La petite infante de Castille: La reine morte (1942), Malatesta (1946), Le maître de Santiago (1947), Port-Royal (1954), Don Juan (1958), Le cardinal d'Espagne (1960), etc. Ses œuvres reflètent sa noble éthique d'inspiration romaine, à mi-chemin entre le stoïcisme et le jansénisme, toujours à la recherche d'une esthétique virile et impériale.
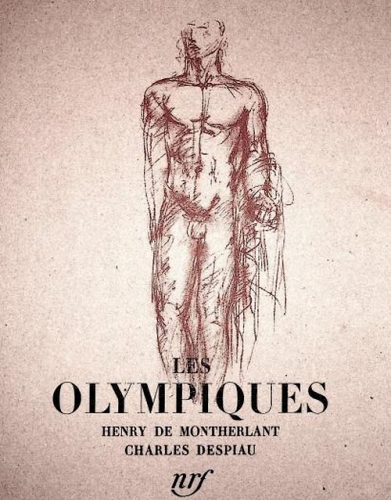
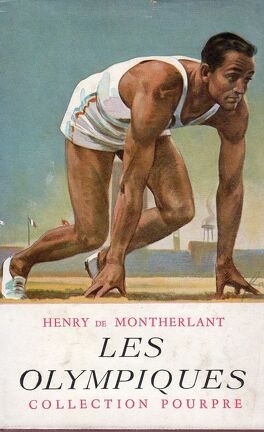
La présence de son œuvre en Espagne commence avec la publication de Las olímpicas (1925), dans une version de Manuel Abril, collaborateur de La Ilustración Española y Americana, avec un prologue d'Antonio Marichalar, et avec Los bestiarios (M., Biblioteca Nueva, 1926), une traduction, ou plutôt une "restitution culturelle", de Pedro Salinas, rééditée en 1979 (M., Alianza). Le roman décrit le monde de la tauromachie et incorpore sa propre terminologie ainsi que des termes dialectaux et d'argot du sud que le traducteur non seulement transcrit, mais explique relativement souvent et tout aussi inutilement. S'il est vrai que la traduction de l'œuvre de Montherlant a commencé dans le premier tiers du 20ème siècle et s'est poursuivie dans les années 1950 avec la parution dans Revista de Occidente (1950) d'un volume de pièces (El maestre de Santiago, Hijo de nadie, Malatesta, La reina muerta et Mañana amanecerá), traduites par Mauricio Torra-Balarí et Fernando Vela, on ne peut pas dire qu'elle ait eu une quelconque influence littéraire, bien que sa figure et son œuvre aient suscité un certain intérêt. Il convient toutefois de mentionner l'attention portée à l'auteur par des publications culturelles de premier plan, telles que la Revista de Occidente et Ínsula, qui ont publié plusieurs articles critiques sur Montherlant, son œuvre et certaines de ses traductions en espagnol.
Les pièces de théâtre transposant des figures emblématiques et des moments exceptionnels de l'Espagne du 16ème siècle ont bénéficié d'une attention particulière en tant que traductions : La reina muerta, dans une "version espagnole" de Fernando Díaz-Plaja (San Sebastián, Alfil, 1959 ; rééd. B., Círculo de Lectores, 1973), El cardenal de España (M., Aguilar, 1962), traduit par le dramaturge Joaquín López Rubio. Ces versions alternaient avec les premières de pièces telles que La ciudad en la que reina un niño (1973) et La reina muerta (1995). Il en va de même pour les récits à caractère nostalgique, libertaire ou anarchique : M.ª Luisa Gefaell a traduit, avec succès éditorial (1974, 3e éd.), El caos y la noche (B. Noguer, 1964), et Josep Palàcios a traduit l'œuvre en catalan, El caos i la nit (B., Proa, 1965). Il existe une édition de Mi jefe es un asesino (B., Noguer, 1972), traduit par Ana Inés Bonnín, de La rosa de arena (B., Seix Barral, 1975), traduit par José Escué, et une autre de Las olímpicas (Círculo de Lectores, 1979), traduit par Carlos Manzano. Dans les années 80, de nouvelles versions de certaines œuvres déjà publiées - Las olímpicas de Jorge de Lorbar (B., Nuevo Arte Thor, 1983) - ont été publiées à nouveau, ou traduites pour la première fois : Don Juan et Hijo de nadie de Mauro Armiño (M., Cátedra, 1989).
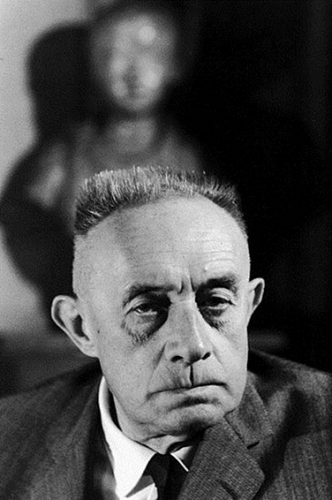
Membre de l'Académie française depuis 1960, Henry de Montherlant est l'un des grands écrivains de la littérature française contemporaine. Son œuvre prolifique nous montre un culte païen de l'action et de l'audace. "Les Olympiques" - l'œuvre préférée de Montherlant - fait l'éloge du sport, de la volonté et de la camaraderie. C'est un hymne à la jeunesse et à l'effort, dont la lecture reste toujours actuelle et jeune.
Montherlant s'est suicidé à l'âge de 77 ans le 21 septembre 1972 car, pour lui, "il s'agit moins d'avoir une vie que d'avoir une vie supérieure".
Eduardo Núñez
23:25 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, henry de montherlant, montherlant |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 454 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
L’épigraphe de Voyage au bout de la nuit (Le chant de la Bérézina)
Entretien avec Jean Guenot (5e et dernière partie)
Guerre, antérieur à Voyage ?
Jean-Pierre Maxence, critique de Céline.
Thibaudat a lâché le morceau cet été : le détenteur des fameux inédits n’était autre qu’Yvon Morandat (1913-1972), celui que Céline appelle comiquement « mon occupant » puisqu’il emménage dans son appartement, réquisitionné par la Résistance, à la Libération. Ailleurs il évoque « celui qui occupe [s]on lit à Montmartre ». On savait que ce résistant, gaulliste de la première heure, avait placé le mobilier de Céline dans un garde-meuble. Et que celui-ci avait refusé de le récupérer contre le paiement des frais de gardiennage. On savait aussi que l’écrivain n’avait pas tenu à recouvrer ces manuscrits qui n’avaient, disait-il, aucun intérêt pour lui ¹. Ce qui ne l’empêcha pas de se poser en victime de Morandat. Mais se souvenait-il de tout ce qu’il avait laissé ? On ignorait par ailleurs que le nouveau locataire détenait aussi, dans une malle, des documents personnels de Céline dont des lettres, photographies et autres archives privées. C’est l’une des filles du résistant qui, via un ami de la compagne de Thibaudat, lui a remis le tout à l’aube des années 80. Il a donc détenu ces inédits pendant quarante ans. Il ne s’agissait en aucun cas de les remettre à Lucette Destouches car c’était « s’exposer à voir des documents gênants pour Céline disparaître ou être interdits de publication. » Il importait aussi de ne pas faire de cadeau à celle qui « avait déployé beaucoup d’efforts pour tenter de gommer l’ignominie antisémite de son époux » [sic]. On comprend aussi qu’il ne fallait pas entacher la mémoire de Morandat que de mauvais esprits eussent pu accuser de recel puisqu’il conserva par-devers lui, outre les manuscrits (que Céline déclina), des documents privés qu’il aurait pu lui remettre en mains propres lorsqu’il le rencontra, au domicile de Pierre Monnier, au début des années cinquante. Quid d’Oscar Rosembly ? C’est de toute évidence lui qui, en août 1944, subtilisa le manuscrit complet de Casse-pipe (plus de 800 pages, selon Céline), la version cédée par Morandat étant, elle, très lacunaire ².
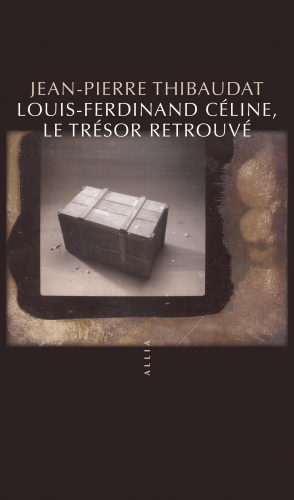
Que sont devenus les manuscrits dérobés par Rosembly (car il y aurait aussi la version finale de La volonté du roi Krogold) ? Les ayants droit comptent-ils s’adresser au petit-fils de Rosembly, journaliste à Marseille, afin de savoir ce qu’il en est ? Guère d’espoir de ce côté puisqu’on se souvient qu’il tomba des nues lorsqu’il apprit, l’été précédent, les “exploits” de son grand-père. Comme on le voit, bien des zones d’ombre subsistent et, avec Céline, on n’est pas au bout de nos surprises. Toutes ces péripéties sont d’ailleurs très céliniennes. De même le fait que cette histoire suscite tant de commentaires imbéciles. Ainsi, à la suite de l’ineffable Roussin, l’ancien journaliste de Libération relève que, dans l’exposition organisée par Gallimard, la médaille militaire de Louis Destouches a été exposée sans que ne fût rappelé qu’il n’avait plus le droit de la porter par décision de justice. Cette hargne envers un auteur mort il y a 60 ans a quelque chose de fascinant…
• Jean-Pierre THIBAUDAT, « Céline, le trésor retrouvé. La piste Morandat », Mediapart, 10 août 2022. Neuf épisodes ont été publiés au total [https://blogs.mediapart.fr]

22:30 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 453 du Bulletin célinien
Sommaire :
- Céline et Paul Mondain
- Entretien avec Jean Guenot (IV)
- Une conférence sur Céline en 1950
- Chez Lacloche à Nice, 1912
 Dans la dernière “Lettre d’actualité” de la Société des Lecteurs de Céline ¹, Christian Mouquet, qui préside à ses destinées, rappelle ce propos imprudent de Pierre-André Taguieff : « Le culte célinien a eu ses Cinquante Glorieuses. Mais, depuis quelques années, il a de moins en moins d’adeptes. Nous assistons aujourd’hui à la fin d’un engouement soigneusement entretenu par divers milieux culturels, éditoriaux et académiques. » Cette affirmation péremptoire date d’il y a quatre ans. Elle est, une fois encore, démentie par les faits. Avec la parution de Guerre (120.000 exemplaires vendus), Céline fait un retour fracassant sur la scène littéraire, adoubé à la fois par la critique et le public. Et le récent colloque de la Société des Études céliniennes a été une indéniable réussite : plus de trente communications, dont la majorité émane de célinistes de la nouvelle génération. Par ailleurs, les « hors-série » consacrées à Céline connaissent un succès de vente notable, tel celui réalisé précisément par Christian Mouquet. Ainsi que la réédition (augmentée de deux nouvelles contributions) de celui qu’avait sorti Le Monde en 2014. Ce numéro est réalisé par Émile Brami, célinien patenté, et ne peut donc qu’être recommandé. On sera en revanche plus réservé quant à la manière de le vendre. Passons sur les expressions convenues (“porte-voix des idées les plus nauséabondes”, “voyage au bout de la haine”, ô mânes de L’Express de Servan-Schreiber !) pour ne retenir que cette forte déclaration : « Le Monde dresse le portrait de celui qui se décrivait comme un “infâme et répugnant saligaud” [sic] »² On a là un exemple de malhonnêteté intellectuelle de la plus belle eau.
Dans la dernière “Lettre d’actualité” de la Société des Lecteurs de Céline ¹, Christian Mouquet, qui préside à ses destinées, rappelle ce propos imprudent de Pierre-André Taguieff : « Le culte célinien a eu ses Cinquante Glorieuses. Mais, depuis quelques années, il a de moins en moins d’adeptes. Nous assistons aujourd’hui à la fin d’un engouement soigneusement entretenu par divers milieux culturels, éditoriaux et académiques. » Cette affirmation péremptoire date d’il y a quatre ans. Elle est, une fois encore, démentie par les faits. Avec la parution de Guerre (120.000 exemplaires vendus), Céline fait un retour fracassant sur la scène littéraire, adoubé à la fois par la critique et le public. Et le récent colloque de la Société des Études céliniennes a été une indéniable réussite : plus de trente communications, dont la majorité émane de célinistes de la nouvelle génération. Par ailleurs, les « hors-série » consacrées à Céline connaissent un succès de vente notable, tel celui réalisé précisément par Christian Mouquet. Ainsi que la réédition (augmentée de deux nouvelles contributions) de celui qu’avait sorti Le Monde en 2014. Ce numéro est réalisé par Émile Brami, célinien patenté, et ne peut donc qu’être recommandé. On sera en revanche plus réservé quant à la manière de le vendre. Passons sur les expressions convenues (“porte-voix des idées les plus nauséabondes”, “voyage au bout de la haine”, ô mânes de L’Express de Servan-Schreiber !) pour ne retenir que cette forte déclaration : « Le Monde dresse le portrait de celui qui se décrivait comme un “infâme et répugnant saligaud” [sic] »² On a là un exemple de malhonnêteté intellectuelle de la plus belle eau. 
20:07 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Chateaubriand et la conclusion de notre histoire
Nicolas Bonnal
Un des plus importants textes du monde moderne, le premier qui nous annonce comment tout va être dévoré : civilisation chrétienne occidentale et autres, peuples, sexes, cultures, religions aussi. C’est la conclusion des Mémoires d’outre-tombe. On commence avec l’unification technique du monde :
« Quand la vapeur sera perfectionnée, quand, unie au télégraphe et aux chemins de fer, elle aura fait disparaître les distances, ce ne seront plus seulement les marchandises qui voyageront, mais encore les idées rendues à l’usage de leurs ailes. Quand les barrières fiscales et commerciales auront été abolies entre les divers Etats, comme elles le sont déjà entre les provinces d’un même Etat ; quand les différents pays en relations journalières tendront à l’unité des peuples, comment ressusciterez−vous l’ancien mode de séparation ? »
On ne réagira pas. Chateaubriand voit l’excès d’intelligence venir avec un excès de mécanique et un déclin de la force et de la liberté :
« La société, d’un autre côté, n’est pas moins menacée par l’expansion de l’intelligence qu’elle ne l’est par le développement de la nature brute. Supposez les bras condamnés au repos en raison de la multiplicité et de la variété des machines, admettez qu’un mercenaire unique et général, la matière, remplace les mercenaires de la glèbe et de la domesticité : que ferez−vous du genre humain désoccupé ? Que ferez−vous des passions oisives en même temps que l’intelligence ? La vigueur du corps s’entretient par l’occupation physique ; le labeur cessant, la force disparaît ; nous deviendrions semblables à ces nations de l’Asie, proie du premier envahisseur, et qui ne se peuvent défendre contre une main qui porte le fer. Ainsi la liberté ne se conserve que par le travail, parce que le travail produit la force : retirez la malédiction prononcée contre les fils d’Adam, et ils périront dans la servitude : In sudore vultus tui, vesceris pane. »
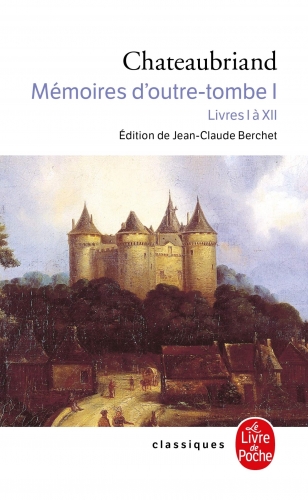
Le gain technique va se payer formidablement. Vient une formule superbe (l’homme moins esclave de ses sueurs que de ses pensées) :
« La malédiction divine entre donc dans le mystère de notre sort ; l’homme est moins l’esclave de ses sueurs que de ses pensées : voilà comme, après avoir fait le tour de la société, après avoir passé par les diverses civilisations, après avoir supposé des perfectionnements inconnus on se retrouve au point de départ en présence des vérités de l’Ecriture. »
Chateaubriand constate la fin de la monarchie :
« La société entière moderne, depuis que la barrière des rois français n’existe plus, quitte la monarchie. Dieu, pour hâter la dégradation du pouvoir royal, a livré les sceptres en divers pays à des rois invalides, à des petites filles au maillot ou dans les aubes de leurs noces : ce sont de pareils lions sans mâchoires, de pareilles lionnes sans ongles, de pareilles enfantelettes tétant ou fiançant, que doivent suivre des hommes faits, dans cette ère d’incrédulité. »
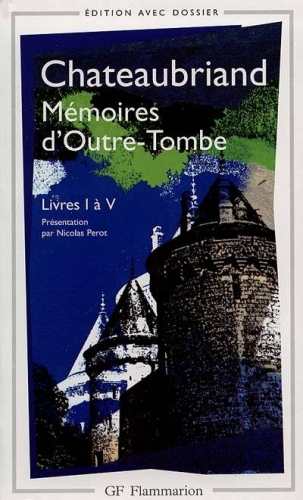
Il voit le basculement immoral de l’homme moderne, grosse bête anesthésiée, ou aux indignations sélectives, qui aime tout justifier et expliquer :
« Au milieu de cela, remarquez une contradiction phénoménale: l’état matériel s’améliore, le progrès intellectuel s’accroît, et les nations au lieu de profiter s’amoindrissent : d’où vient cette contradiction ?
C’est que nous avons perdu dans l’ordre moral. En tout temps il y a eu des crimes; mais ils n’étaient point commis de sang−froid, comme ils le sont de nos jours, en raison de la perte du sentiment religieux. A cette heure ils ne révoltent plus, ils paraissent une conséquence de la marche du temps; si on les jugeait autrefois d’une manière différente, c’est qu’on n’était pas encore, ainsi qu’on l’ose affirmer, assez avancé dans la connaissance de l’homme; on les analyse actuellement; on les éprouve au creuset, afin de voir ce qu’on peut en tirer d’utile, comme la chimie trouve des ingrédients dans les voiries».
La corruption va devenir institutionnalisée :
« Les corruptions de l’esprit, bien autrement destructives que celles des sens, sont acceptées comme des résultats nécessaires ; elles n’appartiennent plus à quelques individus pervers, elles sont tombées dans le domaine public. »
On refuse une âme, on adore le néant et l’hébétement (Baudrillard use du même mot) :
« Tels hommes seraient humiliés qu’on leur prouvât qu’ils ont une âme, qu’au-delà de cette vie ils trouveront une autre vie ; ils croiraient manquer de fermeté et de force et de génie, s’ils ne s’élevaient au-dessus de la pusillanimité de nos pères ; ils adoptent le néant ou, si vous le voulez, le doute, comme un fait désagréable peut−être, mais comme une vérité qu’on ne saurait nier. Admirez l’hébétement de notre orgueil ! »
L’individu triomphera et la société périra :
« Voilà comment s’expliquent le dépérissement de la société et l’accroissement de l’individu. Si le sens moral se développait en raison du développement de l’intelligence, il y aurait contrepoids et l’humanité grandirait sans danger, mais il arrive tout le contraire : la perception du bien et du mal s’obscurcit à mesure que l’intelligence s’éclaire ; la conscience se rétrécit à mesure que les idées s’élargissent. Oui, la société périra : la liberté, qui pouvait sauver le monde, ne marchera pas, faute de s’appuyer à la religion ; l’ordre, qui pouvait maintenir la régularité, ne s’établira pas solidement, parce que l’anarchie des idées le combat… »
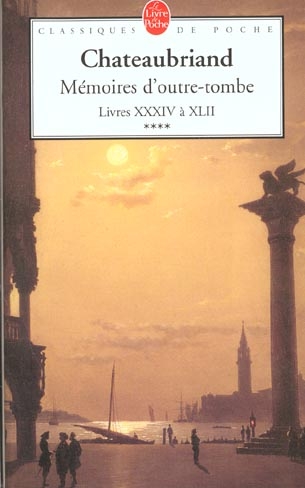
Une belle intuition est celle-ci, qui concerne…la mondialisation, qui se fera au prix entre autres de la famille :
« La folie du moment est d’arriver à l’unité des peuples et de ne faire qu’un seul homme de l’espèce entière, soit ; mais en acquérant des facultés générales, toute une série de sentiments privés ne périra−t−elle pas ? Adieu les douceurs du foyer ; adieu les charmes de la famille ; parmi tous ces êtres blancs, jaunes, noirs, réputés vos compatriotes, vous ne pourriez-vous jeter au cou d’un frère. »
Puis Chateaubriand décrit notre société nulle, plate et creuse - et surtout ubiquitaire :
« Quelle serait une société universelle qui n’aurait point de pays particulier, qui ne serait ni française, ni anglaise, ni allemande, ni espagnole, ni portugaise, ni italienne ? ni russe, ni tartare, ni turque, ni persane, ni indienne, ni chinoise, ni américaine, ou plutôt qui serait à la fois toutes ces sociétés ? Qu’en résulterait−il pour ses mœurs, ses sciences, ses arts, sa poésie ? Comment s’exprimeraient des passions ressenties à la fois à la manière des différents peuples dans les différents climats ? Comment entrerait dans le langage cette confusion de besoins et d’images produits des divers soleils qui auraient éclairé une jeunesse, une virilité et une vieillesse communes ? Et quel serait ce langage ? De la fusion des sociétés résultera−t−il un idiome universel, ou bien y aura−t−il un dialecte de transaction servant à l’usage journalier, tandis que chaque nation parlerait sa propre langue, ou bien les langues diverses seraient−elles entendues de tous ? Sous quelle règle semblable, sous quelle loi unique existerait cette société ? »
Et de conclure sur cette prison planétaire :
« Comment trouver place sur une terre agrandie par la puissance d’ubiquité, et rétrécie par les petites proportions d’un globe fouillé partout ? Il ne resterait qu’à demander à la science le moyen de changer de planète. »
Elle n’en est même pas capable…
Et Chateaubriand insiste encore – l’air va devenir irrespirable (entre le modèle chinois et le modèle américain !) – et on n’aura décidément plus qu’une envie : ne plus être là ou ne plus être carrément :
« Les modernes sectaires...pensent qu’on pourrait nous mener à l’idéale médiocrité américaine… D'autres, plus obligeants encore, et qui admettent une sorte d'élégance de civilisation, se contenteraient de nous transformer en Chinois constitutionnels, à peu près athées, vieillards éclairés et libres, assis en robes jaunes pour des siècles dans nos semis de fleurs, passant nos jours dans un confortable acquis à la multitude, ayant tout inventé, tout trouvé, végétant en paix au milieu de nos progrès accomplis, et nous mettant seulement sur un chemin de fer, comme un ballot, afin d'aller de Canton à la grande muraille deviser d'un marais à dessécher, d'un canal à creuser, avec un autre industriel du Céleste−Empire. Dans l'une ou l'autre supposition, Américain ou Chinois, je serai heureux d'être parti avant qu'une telle félicité me soit advenue ».
Sources principales :
François-René de Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, conclusion
https://www.ebooksgratuits.com/ebooksfrance/chateaubriand_memoires_outre-tombe.pdf
Nicolas Bonnal – Chroniques sur la fin de l’histoire ; Guénon, Bernanos et les gilets jaunes (Amazon.fr)
22:50 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chateaubriand, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, philosophie, philosophie de l'histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Sommaire :
- Guerre vu par la presse
- Personnages & avatars dans Guerre
- Cascade ou l’Œdipe des bas-fonds.
 Pour le premier numéro de sa revue, Littératures & Cie, Joseph Vebret nous gratifie de deux articles relatifs à la découverte des manuscrits de Céline. Celui signé David Alliot, « Qui a volé Louis-Ferdinand Céline ? », retrace l’étonnante histoire de ces manuscrits inédits qui firent surface l’été dernier. L’autre, « Céline en valises », est dû à Emmanuel Pierrat, conseil du receleur Thibaudat. Certes, il faut savoir gré à celui-ci d’avoir préservé ces trésors et de ne pas avoir cherché à les monnayer. Mais comment ne pas songer à Lucette qui eût été heureuse de savoir que ces manuscrits n’avaient pas disparu et dont l’exploitation commerciale l’aurait aidée à la fin de sa vie ? On pense aussi aux amis céliniens, aujourd’hui disparus, qui n’auront jamais pu lire ces textes que Thibaudat dit détenir depuis une quinzaine d’années alors même qu’il savait leur origine frauduleuse.
Pour le premier numéro de sa revue, Littératures & Cie, Joseph Vebret nous gratifie de deux articles relatifs à la découverte des manuscrits de Céline. Celui signé David Alliot, « Qui a volé Louis-Ferdinand Céline ? », retrace l’étonnante histoire de ces manuscrits inédits qui firent surface l’été dernier. L’autre, « Céline en valises », est dû à Emmanuel Pierrat, conseil du receleur Thibaudat. Certes, il faut savoir gré à celui-ci d’avoir préservé ces trésors et de ne pas avoir cherché à les monnayer. Mais comment ne pas songer à Lucette qui eût été heureuse de savoir que ces manuscrits n’avaient pas disparu et dont l’exploitation commerciale l’aurait aidée à la fin de sa vie ? On pense aussi aux amis céliniens, aujourd’hui disparus, qui n’auront jamais pu lire ces textes que Thibaudat dit détenir depuis une quinzaine d’années alors même qu’il savait leur origine frauduleuse.
Manuscrits volés, et non pas “abandonnés« , puis “confisqués” par la Résistance comme certains se plaisent à l’affirmer aujourd’hui¹. Les mêmes soulignent le piquant paradoxe du “sauvetage” des manuscrits par des résistants mais se font discrets sur la personnalité de Rosembly, se gardant bien d’indiquer qu’avant de devenir un résistant de la onzième heure (emprisonné à la Libération pour pillage d’appartements), il fut un militant actif d’un parti collaborationniste radical. Mais est-ce vraiment lui l’auteur du vol ? Et, si tel est le cas, a-t-il conservé longtemps ces manuscrits ? Ou sont-ce les (vrais) résistants, membres du futur Comité parisien de la Libération, qui se réunissaient dans l’appartement en-dessous de celui de Céline ? Ce qui n’est pas davantage rappelé, c’est que la plainte des ayants droit fut suscitée par le refus catégorique de Thibaudat de restituer ce qui ne lui appartenait pas.
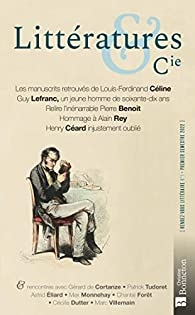 Mieux : il entendait, comme l’un de ses courriels l’atteste, imposer ses conditions : 1) céder les manuscrits à l’IMEC dont il est proche (alors que la BNF, qui dispose déjà d’un important fonds Céline, a la préférence des ayants droit) ; 2) en assurer seul l’édition scientifique. Son intransigeance s’évanouit dès qu’une plainte pour recel et vol fut déposée : il s’exécuta alors sans barguigner et remit les manuscrits à l’OCBC (Office central de lutte contre le trafic des biens culturels). Pierrat affirme que si sa relation avec les ayants droit s’est rapidement dégradée, c’est parce que Véronique Chovin s’est dite effrayée à l’idée que fût révélé l’’antisémitisme de Céline (!). Sollicitée par le BC, elle s’insurge : « En aucune façon je n’ai pu exprimer une telle crainte d’autant plus que je suis résolument contre toute censure et ne chercherai jamais à cacher l’antisémitisme de Céline si de nouveaux documents venaient à apparaître. Les seuls propos que j’ai échangés avec Pierrat traitaient du vol qu’il n’a d’ailleurs jamais cherché à nier (prescrit, m’a-t-il répondu), et du recel qui n’aurait posé aucun problème si nous avions été d’accord. »
Mieux : il entendait, comme l’un de ses courriels l’atteste, imposer ses conditions : 1) céder les manuscrits à l’IMEC dont il est proche (alors que la BNF, qui dispose déjà d’un important fonds Céline, a la préférence des ayants droit) ; 2) en assurer seul l’édition scientifique. Son intransigeance s’évanouit dès qu’une plainte pour recel et vol fut déposée : il s’exécuta alors sans barguigner et remit les manuscrits à l’OCBC (Office central de lutte contre le trafic des biens culturels). Pierrat affirme que si sa relation avec les ayants droit s’est rapidement dégradée, c’est parce que Véronique Chovin s’est dite effrayée à l’idée que fût révélé l’’antisémitisme de Céline (!). Sollicitée par le BC, elle s’insurge : « En aucune façon je n’ai pu exprimer une telle crainte d’autant plus que je suis résolument contre toute censure et ne chercherai jamais à cacher l’antisémitisme de Céline si de nouveaux documents venaient à apparaître. Les seuls propos que j’ai échangés avec Pierrat traitaient du vol qu’il n’a d’ailleurs jamais cherché à nier (prescrit, m’a-t-il répondu), et du recel qui n’aurait posé aucun problème si nous avions été d’accord. »
Toute la vérité au sujet du vol et de la restitution sera-t-elle un jour révélée ? Thibaudat annonce un livre dans lequel il « promet de tout révéler »³. …Chiche !
• Littératures & Cie, n° 1, 1er semestre 2022, 218 pages.

Notes:
18:13 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, litt&érature, littérature française, lettres, lettres françaises, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Brasillach, le paria qui a vu les "sept couleurs" du cinéma
L'essai de Claudio Siniscalchi "Sans romantisme" raconte la relation entre l'écrivain et l'image
Stenio Solinas
Source: https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/brasillach-reietto-che-vide-i-sette-colori-cinema-2043998.html
J'ai commencé à lire Robert Brasillach quand j'étais encore très jeune. J'ai ensuite écrit sur lui, j'ai préfacé un de ses romans, Les sept couleurs, j'ai édité et traduit un autre, Comme le temps passe et je lui suis resté fidèle au fil des ans, comme cela se produit avec les choses de la vie que l'on chérit le plus, cette amitié, cet amour, un certain paysage, une peinture, un film... Quand on me dit qu'après tout, c'est un écrivain mineur, je laisse tomber. Que signifie "mineur" ? Par rapport à qui, par rapport à quoi ? Quel est le critère d'évaluation, le critère de jugement ?
Si l'on veut comprendre ce qu'était la France entre les deux guerres mondiales, son témoignage intellectuel reste incontournable, si l'on veut comprendre l'attraction et/ou la tentation fasciste dans les démocraties à l'heure du totalitarisme, également. Quant au narrateur, rares sont ceux qui, comme lui, ont su nous rendre cette saveur si particulière qu'a la jeunesse lorsqu'elle part à l'aventure, s'épanche dans les passions, rêve de grands exploits et, entre-temps, panse ses plaies: la première déception, la première trahison, les faux pas, les bévues sans échappatoire. Mineur ? Peu importe.
Toutes les raisons pour lesquelles la musique d'un certain Brasillach ne cesse de résonner dans notre tête à chaque fois que nous la lisons se trouvent bien alignées dans cet essai de Claudio Siniscalchi, Senza romanticismo (Bietti, pp. 350, euro 20), ostensiblement centré sur le cinéma, dont Brasillach fut un historien et un critique exemplaire, ainsi qu'à l'avant-garde par rapport à son époque, mais en réalité construit dans un soleil d'histoire, de politique, d'idéologie, de culture, de coutumes et de société autour de la France de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, et donc à ce qui en partie existait avant cette année 1909 où Brasillach vint au monde, et à ce qui en partie y sera après cette 1945 où il fut enlevé du monde. Siniscalchi sait très bien qu'une naissance enregistrée à l'état civil ne suffit pas à enfermer une vie, tout comme une pierre tombale au cimetière n'y met pas fin.

L'un des mérites de ce livre est le naturel avec lequel son auteur se promène dans un domaine aussi accidenté que l'histoire des idées et l'histoire politique, un naturel qui est le résultat d'une maîtrise des deux: Siniscalchi a tout lu, sait faire les bons liens, cherche à comprendre et n'a pas la prétention de juger. En commentant la bipartition de Walter Benjamin entre l'esthétisation de la politique et la politisation de l'esthétique, la première négative, comme fasciste, la seconde positive, comme communiste, il saisit intelligemment qu'elle n'est rien d'autre qu'une bizarrerie de sophiste: en réalité, explique-t-il, en tant que phénomènes totalitaires, le fascisme et le communisme ont pratiqué les deux options, c'est-à-dire qu'ils ont embelli la politique et fait de l'art son bras armé. Ce qui est intéressant à voir, c'est la façon dont des concepts de ce genre ont été traduits dans ce qui n'était pas des régimes totalitaires, mais des démocraties parlementaires plus ou moins en crise, la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne elle-même, du moins jusqu'à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Pour rester dans le premier cas, nous nous contenterons de constater qu'ici la droite intellectuelle est plus généreuse dans ses jugements critiques que son homologue, c'est-à-dire aussi bien en termes aussi larges que, cela va sans dire, généraux.
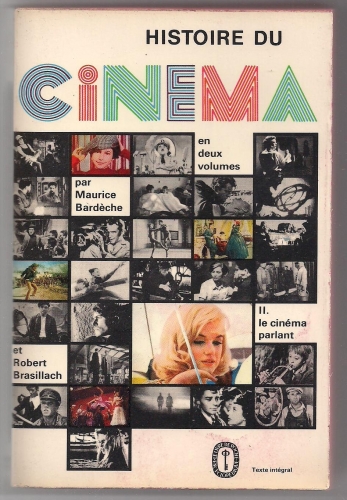
Il y a de nombreuses raisons à cela : à gauche, l'idéologie est plus ferrée et ne donne pas de rabais, ni littéraire ni amical, alors qu'à droite, elle est plus fallacieuse car fortement conditionnée par l'individualité. Il y a dans cette dernière une idée chevaleresque de la vie, dans l'autre elle est absente, ce qui se répercute dans toute une série de choix, y compris artistiques, sans oublier la moindre emprise de la forme dite du parti à l'égard de ses militants. Dans les années 1930, Bernanos quitte poliment l'Action française, mais cela ne fait pas déserter son entourage. Dans les années 1930, Paul Nizan a critiqué le Parti communiste français et a été traité comme un vendu et un traître.
(...)
Dans son livre, Siniscalchi saisit très bien un point central de la poétique de Brasillach, avec son culte de la jeunesse qui signifie mémoire, souvenir, fidélité, vie et modèle de comportement lorsqu'il observe que pour ceux de son âge "la jeunesse est le cinéma".
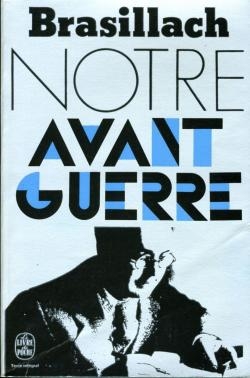 Brasillach appartient à une génération qui n'a pas eu le temps de vivre la Première Guerre mondiale, ce qui le rend moins cynique, moins désabusé, moins meurtri et moins désenchanté que ceux qui, comme Drieu, Céline, Montherlant et Aragon, ont plutôt vécu cette expérience et ne l'ont pas oubliée. Son adolescence coïncide avec les années 20, avec la grande illusion (ce n'est pas un hasard si c'est aussi le titre d'un film de Jean Renoir) de la "guerre qui mit fin à toutes les guerres" et la découverte du cinéma comme le véritable art du 20e siècle, quelque chose d'inégalé, un nouveau langage sous la bannière des images en mouvement, le mouvement qui devient verbe. La combinaison est explosive, d'autant plus que le cinéma est un plaisir individuel, mais aussi de masse, qui se savoure ensemble, qu'il bénéficie d'espaces physiques reconnus et favorise ainsi les rencontres et les connaissances, qu'il est une religion avec ses rituels, ses adorateurs, ses officiants, le sentiment commun d'une même foi... Cette acceptation de la modernité est chez Brasillach typiquement fasciste, au sens de l'homme nouveau qu'il a théorisé et dont nous avons déjà parlé. Siniscalchi note à juste titre que Charles Maurras, qui avait également été le maître politique de l'Action française de Brasillach, n'avait jamais dépassé la vision de Ben Hur au cinéma... Ce n'était pas son monde, c'était un monde qu'il ne comprenait pas..... Sur la cinéphilie de Brasillach, une parenthèse doit être faite. Laissant de côté l'Histoire du cinéma, dans nombre de ses romans ainsi que dans ses mémoires autobiographiques, elle est racontée, revendiquée, fait partie de l'éducation sentimentale et de la vie de ses protagonistes et de lui-même. Cependant, elle ne se transforme jamais en fétichisme, en idolâtrie, en rejet de toute autre expérience esthétique. Il est trop cultivé, Brasillach, trop imprégné de la culture classique pour faire l'erreur de la jeter. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est suffisamment curieux pour essayer de comprendre dans quelle mesure et jusqu'à quel point les deux cultures peuvent fusionner, surtout à une époque où l'avènement du son marque la ligne de partage des eaux entre le domaine de l'image mobile pure et ce qui viendra plus tard et qui, cependant, c'est sa réflexion, doit être au service de la première, et non la dominer. En bref, le lecteur verra que Brasillach raconte des expériences, des réflexions, des rencontres et des heurts qui étaient typiques de la passion pour le cinéma au moins jusqu'aux années 1970 et 1980, lorsque les ciné-clubs et les cinémas d'art et d'essai existaient encore et, en bref, toute cette coterie cinéphile qui a longtemps été liée à la jeunesse. On peut comprendre pourquoi, dans les années 1950, François Truffaut a rendu hommage à Brasillach. Ils étaient du même type.
Brasillach appartient à une génération qui n'a pas eu le temps de vivre la Première Guerre mondiale, ce qui le rend moins cynique, moins désabusé, moins meurtri et moins désenchanté que ceux qui, comme Drieu, Céline, Montherlant et Aragon, ont plutôt vécu cette expérience et ne l'ont pas oubliée. Son adolescence coïncide avec les années 20, avec la grande illusion (ce n'est pas un hasard si c'est aussi le titre d'un film de Jean Renoir) de la "guerre qui mit fin à toutes les guerres" et la découverte du cinéma comme le véritable art du 20e siècle, quelque chose d'inégalé, un nouveau langage sous la bannière des images en mouvement, le mouvement qui devient verbe. La combinaison est explosive, d'autant plus que le cinéma est un plaisir individuel, mais aussi de masse, qui se savoure ensemble, qu'il bénéficie d'espaces physiques reconnus et favorise ainsi les rencontres et les connaissances, qu'il est une religion avec ses rituels, ses adorateurs, ses officiants, le sentiment commun d'une même foi... Cette acceptation de la modernité est chez Brasillach typiquement fasciste, au sens de l'homme nouveau qu'il a théorisé et dont nous avons déjà parlé. Siniscalchi note à juste titre que Charles Maurras, qui avait également été le maître politique de l'Action française de Brasillach, n'avait jamais dépassé la vision de Ben Hur au cinéma... Ce n'était pas son monde, c'était un monde qu'il ne comprenait pas..... Sur la cinéphilie de Brasillach, une parenthèse doit être faite. Laissant de côté l'Histoire du cinéma, dans nombre de ses romans ainsi que dans ses mémoires autobiographiques, elle est racontée, revendiquée, fait partie de l'éducation sentimentale et de la vie de ses protagonistes et de lui-même. Cependant, elle ne se transforme jamais en fétichisme, en idolâtrie, en rejet de toute autre expérience esthétique. Il est trop cultivé, Brasillach, trop imprégné de la culture classique pour faire l'erreur de la jeter. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est suffisamment curieux pour essayer de comprendre dans quelle mesure et jusqu'à quel point les deux cultures peuvent fusionner, surtout à une époque où l'avènement du son marque la ligne de partage des eaux entre le domaine de l'image mobile pure et ce qui viendra plus tard et qui, cependant, c'est sa réflexion, doit être au service de la première, et non la dominer. En bref, le lecteur verra que Brasillach raconte des expériences, des réflexions, des rencontres et des heurts qui étaient typiques de la passion pour le cinéma au moins jusqu'aux années 1970 et 1980, lorsque les ciné-clubs et les cinémas d'art et d'essai existaient encore et, en bref, toute cette coterie cinéphile qui a longtemps été liée à la jeunesse. On peut comprendre pourquoi, dans les années 1950, François Truffaut a rendu hommage à Brasillach. Ils étaient du même type.
20:38 Publié dans Cinéma, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert brasillach, cinéma, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
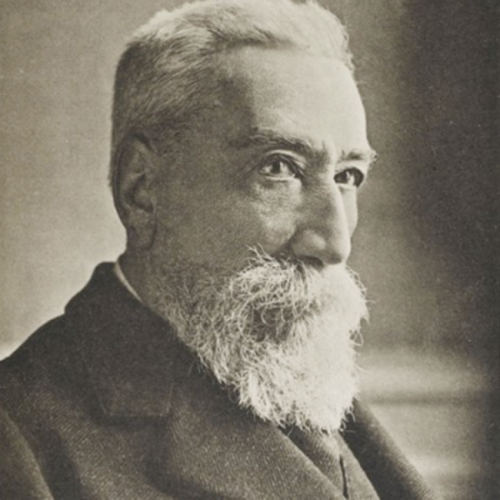
Anatole France sur la guerre en Ukraine – et la folie américaine
par Nicolas Bonnal
L’Amérique est toujours en guerre, un peu comme sa marâtre anglaise ; elle a fait détruire l’Ukraine et prépare l’anéantissement de l’Europe comme en 1942-43 (on rase l’Occident et on laisse l’Orient à Staline); ensuite l’infatigable ira exterminer russes et chinois; et si elle peut au bout détruire une nouvelle fois le monde, elle sera exaucée car on pourra tout reconstruire ou faire des croisières au milieu des ruines (Julius Evola sera bien attrapé). Anatole France nous explique pourquoi dans l’Ile aux pingouins (merci à un lecteur anonyme).
C’était il y a plus de cent ans. Avant la guerre, on fait les présentations (Titan, Babel, géant, Walhalla du business comme dans le film Network, etc.) :
« Après quinze jours de navigation son paquebot entra, la nuit, dans le bassin de Titanport où mouillaient des milliers de navires. Un pont de fer, jeté au-dessus des eaux, tout resplendissant de lumières, s'étendait entre deux quais si distants l'un de l'autre que le professeur Obnubile crut naviguer sur les mers de Saturne et voir l'anneau merveilleux qui ceint la planète du Vieillard. Et cet immense transbordeur charriait plus du quart des richesses du monde. »
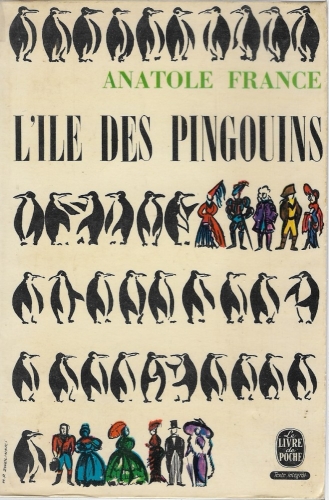
On arrive dans la Nouvelle Atlantide façon Francis Bacon (on y reviendra à celui-là) :
« Le savant pingouin, ayant débarqué, fut servi dans un hôtel de quarante-huit étages par des automates, puis il prit la grande voie ferrée qui conduit à Gigantopolis, capitale de la Nouvelle-Atlantide. Il y avait dans le train des restaurants, des salles de jeux, des arènes athlétiques, un bureau de dépêches commerciales et financières, une chapelle évangélique et l'imprimerie d'un grand journal que le docteur ne put lire, parce qu'il ne connaissait point la langue des Nouveaux Atlantes. Le train rencontrait, au bord des grands fleuves, des villes manufacturières qui obscurcissaient le ciel de la fumée de leurs fourneaux: villes noires le jour, villes rouges la nuit, pleines de clameurs sous le soleil et de clameurs dans l'ombre. »
Le très crétin professeur obnubilé se croit dans un pays pacifique (il n’a pas lu Smedley Butler) :
« —Voilà, songeait le docteur, un peuple bien trop occupé d'industrie et de négoce pour faire la guerre. Je suis, dès à présent, certain que les Nouveaux Atlantes suivent une politique de paix. Car c'est un axiome admis par tous les économistes que la paix au dehors et la paix au dedans sont nécessaires au progrès du commerce et de l'industrie. »
Gigantopolis est une dromocratie (comme dirait Virilio) :
« En parcourant Gigantopolis, il se confirma dans cette opinion. Les gens allaient par les voies, emportés d'un tel mouvement, qu'ils culbutaient tout ce qui se trouvait sur leur passage. Obnubile, plusieurs fois renversé, y gagna d'apprendre à se mieux comporter: après une heure de course, il renversa lui-même un Atlante. »
On arrive au parlement (style grec néoclassique) :
« Parvenu sur une grande place, il vit le portique d'un palais de style classique dont les colonnes corinthiennes élevaient à soixante-dix mètres au-dessus du stylobate leurs chapiteaux d'acanthe arborescente.
Comme il admirait immobile, la tête renversée, un homme d'apparence modeste, l'aborda et lui dit en pingouin:
—Je vois à votre habit que vous êtes de Pingouinie. Je connais votre langue; je suis interprète juré. Ce palais est celui du Parlement. En ce moment, les députés des États délibèrent. Voulez-vous assister à la séance?
Introduit dans une tribune, le docteur plongea ses regards sur la multitude des législateurs qui siégeaient dans des fauteuils de jonc, les pieds sur leur pupitre. »
La séance commence – et les justes guerres et autres guerres du droit commercial ou autre. On commencera par la Mongole (c’est entre la Chine et la Russie) :
« Le président se leva et murmura plutôt qu'il n'articula, au milieu de l'inattention générale, les formules suivantes, que l'interprète traduisit aussitôt au docteur:
—La guerre pour l'ouverture des marchés mongols étant terminée à la satisfaction des États, je vous propose d'en envoyer les comptes à la commission des finances….
»Il n'y a pas d'opposition?…
»La proposition est adoptée.
»La guerre pour l'ouverture des marchés de la Troisième-Zélande étant terminée à la satisfaction des États, je vous propose d'en envoyer les comptes à la commission des finances….
»Il n'y a pas d'opposition?…
»La proposition est adoptée. »
Après Anatole nous explique pourquoi cette grande nation commerçante adore comme l’Angleterre faire tout le temps et partout la guerre. Lisez bien c’est génial :
—Ai-je bien entendu? demanda le professeur Obnubile. Quoi? vous, un peuple industriel, vous vous êtes engagés dans toutes ces guerres!
—Sans doute, répondit l'interprète: ce sont des guerres industrielles. Les peuples qui n'ont ni commerce ni industrie ne sont pas obligés de faire la guerre; mais un peuple d'affaires est astreint à une politique de conquêtes. Le nombre de nos guerres augmente nécessairement avec notre activité productrice. Dès qu'une de nos industries ne trouve pas à écouler ses produits, il faut qu'une guerre lui ouvre de nouveaux débouchés. C'est ainsi que nous avons eu cette année une guerre de charbon, une guerre de cuivre, une guerre de coton. Dans la Troisième- Zélande nous avons tué les deux tiers des habitants afin d'obliger le reste à nous acheter des parapluies et des bretelles. »
La suite n’est pas mal non plus :
« À ce moment, un gros homme qui siégeait au centre de l'assemblée monta à la tribune.
—Je réclame, dit-il, une guerre contre le gouvernement de la république d'Émeraude, qui dispute insolemment à nos porcs l'hégémonie des jambons et des saucissons sur tous les marchés de l'univers.
—Qu'est-ce que ce législateur? demanda le docteur Obnubile.
—C'est un marchand de cochons.
—Il n'y a pas d'opposition? dit le président. Je mets la proposition aux voix.
La guerre contre la république d'Emeraude fut votée à mains levées à une très forte majorité.
—Comment? dit Obnubile à l'interprète; vous avez voté une guerre avec cette rapidité et cette indifférence!… »
Cerise sur le gâteau, le coût humain :
—Oh! c'est une guerre sans importance, qui coûtera à peine huit millions de dollars.
—Et des hommes….
—Les hommes sont compris dans les huit millions de dollars. »
N’oublions pas que nos commerçants anglo-saxons sont malthusiens aussi. Il leur faudra 500 millions d’hommes, comme indiqué en Géorgie.
On laisse le maître conclure :
« Alors le docteur Obnubile se prit la tête dans les mains et songea amèrement:
—Puisque la richesse et la civilisation comportent autant de causes de guerres que la pauvreté et la barbarie, puisque la folie et la méchanceté des hommes sont inguérissables, il reste une bonne action à accomplir. Le sage amassera assez de dynamite pour faire sauter cette planète. Quand elle roulera par morceaux à travers l'espace une amélioration imperceptible sera accomplie dans l'univers et une satisfaction sera donnée à la conscience universelle, qui d'ailleurs n'existe pas. »
Mais si que la conscience universelle existe, ou la communauté internationale, ils l’ont dit à la télé !
On répète car c’est merveilleux :
—Les hommes sont compris dans les huit millions de dollars. »
Sources :
http://www.bouquineux.com/index.php?telecharger=1970&...
https://fr.wikisource.org/wiki/Nouvelle_Atlantide_(trad._...
20:51 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anatole france, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Dominique et Pierre-Guillaume de Roux
Par Davide Bellomo
Source: https://domus-europa.eu/2022/05/09/12150/
Dominique et Pierre Guillaume de Roux, père et fils morts jeunes, privés de ce que le destin aurait souhaité et que le destin a refusé, de sorte qu'il reste d'eux un homme inachevé, pris dans l'embuscade de la mort.
Éditeurs par urgence impraticables, gaullistes à la droite du Général, Dominique païen posthume de tout serment et Pierre Guillaume chrétien par la foi : il a choisi l'Église orthodoxe comme un Byzantin après l'implosion des Croisades, prostitué à un souk d'indulgences, d'honneurs, de manœuvres avec l'Islam.
Des éditeurs prosaïques avec peu à faire mais beaucoup à créer, une prairie d'idées et de courage, pour ne pas épater les bourgeois mais pour ne pas prêter cœur et cervelle à l'amas d'enclaves à la puanteur sartrienne dans le nez des livrets rouges agités du Grand ( ?!) Timonier.
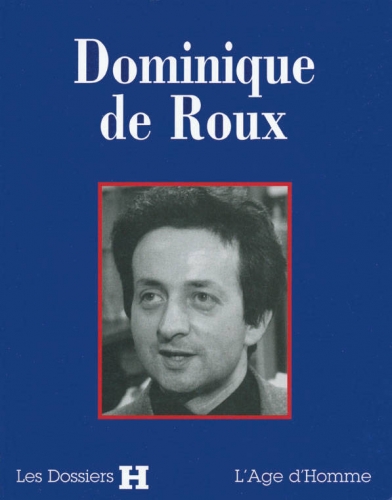
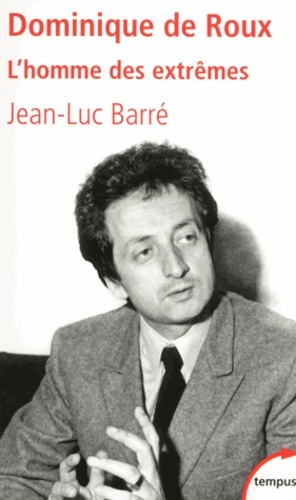
Robert Levrac-Tournières en aurait fait le meilleur portrait, avant la salle de bal et les délires de Voltaire, car la grandeur doit être recherchée dans l'histoire et dans l'ici et maintenant. Quand la fierté d'être conservateur est une valeur auto- et hétéro-perceptive non négociable, voici les de Roux, qui ont regardé un monde à secouer la tête mais ont tiré droit devant.
N'étaient les termes ad quem, dans l'ordre chronologique, 1977, à 41 ans, et 2021, à 58 ans, ils auraient pu être interchangeables dans leurs rôles. Dominique clôt le spiel à dix-sept ans: il n'y a pas un seul séducteur sur la chaise, tout au plus des commis avec un registre et un crayon rouge et bleu. La vieille et aisée famille languedocienne - son grand-père Marie De Roux avait été l'avocat de Charles Maurras et de l'Action française - sait que le garçon est au crédit de la vie: il paie les droits de banquier de son père à Londres, travaille brièvement dans la City - vu son âge, comme employé de bureau -, puis en Allemagne dans une fabrique de feutre, et à vingt ans, il est déjà cycliste pour l'Herne, qu'il transformera, aidé de sa femme Jacqueline Brusset, en la série des Cahiers de l'Herne, des monographies sur les figures les plus significatives de la littérature du siècle. A vingt-sept ans, il publie son premier roman, Mademoiselle Anicet, et des dizaines d'essais ; il est l'âme des éditions Christian Bourgois, d'Exil, de la collection 10/18 ; ses amis sont ses auteurs : la convenance ne sait pas ce que c'est. Consultant aux Presses de la Cité, défenseur de Céline, de Pound, d'Abellio et de tous les incommodes, les pestiférés et les enlevés, il s'attaque au futur locataire de l'Elysée, Georges Pompidou, qui succédera à De Gaulle, le traitant de véto... et à deux des plus intouchables, Maurice Genevoix et Roland Barthes. Le pouvoir réagit, Elysée ou Académie, toujours, avec l'embargo : collaborations tronquées, silence de la presse sur le Gavroche des pages écrites. Carbonaro sans en être un, posthume volontaire de lui-même, pendu à son propre compte, chaque jour à Nuremberg, mestatore qui ne cache jamais son bras, il a rassemblé, avec les Cahiers, les points de rhumb-line des routes de la culture de front, en dehors du pouvoir qui contrôle la presse, la télévision, l'édition, le cinéma, l'école. Qui a eu une relation aussi profonde avec Witold Gombrowitz, l'écrivain le plus baroque du siècle, avec Emilio Gadda, peut-être, sinon Dominique de Roux ? Qui s'est jamais rendu compte de ce que la littérature lui doit aux dehors des académies, au massacre des prix littéraires, à l'assoupissement de la médiocrité élue comme démiurge? Ce serait un projet de loi inconfortable pour les parvenus de ce "truc" prêt et enclin à la délégitimation. Le départ : les dernières courtes années, 1973-1976, sont toutes dans le roman Le cinquième empire, publié deux semaines après sa mort. Le Portugal et l'Afrique australe, les événements politiques et la fidélité narrative qui vient à être elle-même, l'événement. Comme les aphorismes d'Immédiatement, moins quelques bavures bienvenues. Beaucoup de ceux qui auraient dû les lire ont tourné leur visage vers le mur.

Pierre-Guillaume, le front haut d'un mathématicien pur et les mains pour un Nocturne de Chopin, a été à la hauteur de son père, pas un segment de vie mais cette vie, sans faille. Le labyrinthe de la rue Richelieu était une tranchée entre les livres rassemblés, lus, publiés et les manuscrits attendus avec confiance, dans un temps suspendu partagé avec Balzac et Nerval et les nombreux inconnus qui avaient réuni deux cents dossiers dans le corps douze. Il n'a pas été facile de passer sous silence la lâcheté de la mémoire de son père ni la critique du catalogue de sa maison d'édition - les logos sont ses initiales - car il fallait le faire, un sacrifice qualitatif pour financer les publications "nécessaires", les sorties, magnifiques !, difficilement compatibles avec une balance excédentaire. Le style est l'homme même, a écrit George-Louis Leclerc de Bouffon. A dix-neuf ans, il travaille pour l'éditeur Christian Bourgois, nervure de la Presse de la Cité et indépendant depuis 1992 ; à vingt et un ans, il est directeur éditorial de Table Ronde, puis de Juillard, Bartillat, Rocher, Criterion, Les Syrtes et enfin PGDR, acronyme de ses initiales. Le présent pour l'avenir, le livre comme un défi, comme un guerrier sinon un vainqueur qui connaît les conventions et s'en moque. Voici, parmi beaucoup d'autres, François Billot de Lochner et son analyse de la double dérive du banlieu au croissant de lune, n'incluant que le désastre social, Tarr de l'incatable peintre-romancier Windham Lewis - une splendide biographie, celle de Stenio Solinas ! et Roger Nimier, le génial scénariste d'Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle et romancier de premier ordre, Ezra Pound, et, pour ne pas être en reste, le déflagrant Éloge littéraire d'Anders Breivik de Richard Millet, sur le meurtrier de soixante-dix-sept personnes, résultat, selon l'auteur, du multiculturalisme, de l'abandon des racines chrétiennes et de l'islamisation. Quatre ans avant le Bataclan, nous ajoutons pour mémoire. Les rares apparitions à la télévision ont démantelé le paradigme d'une intelligence cultivée confinée au rôle de curiosité dangereuse, mais l'ensemble sentait l'excusatio non petita, le bon droit. Le fossé culturel entre l'intervieweur et l'interviewé a été décliné en un verbe défectif et donc honny soit qui mal y pense.
Davide Bellomo.
14:25 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique de roux, pierre-guillaume de roux, lettres françaises, lettres, édition, éditeurs, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par Nicolas Bonnal
On a vu avec Castaneda l’importance des prédateurs qui se sont emparés de la terre et nous sucent comme des bonbons. Ils se nourrissent de notre énergie psychique (disons pour satisfaire les imbéciles que tout cela est une métaphore littéraire, OK ?). Le vaccin planétaire, le Reset et autres abominations technologiques, écologiques et territoriales nous ont fait basculer dans une ultra-réalité cauchemardesque basée sur la terreur, la pénurie, la connexion neuronale et l’hypnose. Hannibal Genséric a consacré un texte passionnant sur les liens de la grippe et de l’électricité, de la guerre de 14 et de la grippe soi-disant espagnole. J’ai expliqué dans un texte souvent repris que la crétinisation est venue avec la technologie, le premier à l’avoir senti et décrit fut Villiers de l’Ile-Adam (Contes cruels).
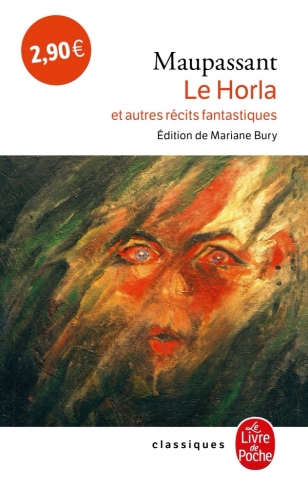
Lovecraft admirait beaucoup Maupassant. Nous aussi : Maupassant dans le Horla décrit cette intrusion extraterrestre avec un bateau marchand (ah, la mondialisation, ah, les exportations, ah, les belles usines…) qui remonte la Seine. Mais il décrit aussi TOUJOURS DANS LE HORLA la crétinisation du peuple parisien par le patriotisme (Céline fera pareil). Et cela donne ces lignes sans pareilles et jamais lues comme toujours (ah, l’école…) :
14 juillet. – Fête de la République. Je me suis promené par les rues. Les pétards et les drapeaux m’amusaient comme un enfant. C’est pourtant fort bête d’être joyeux, à date fixe, par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit : « Amuse-toi. » Il s’amuse. On lui dit : « Va te battre avec le voisin. » Il va se battre. On lui dit : « Vote pour l’Empereur. » Il vote pour l’Empereur. Puis, on lui dit : « Vote pour la République. » Et il vote pour la République. »
Le peuple technophile et moderne est bête-manipulé mais ses élites sont fanatiques-dangereuses. Maupassant :
« Ceux qui le dirigent sont aussi sots ; mais au lieu d’obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux, par cela même qu’ils sont des principes, c’est-à-dire des idées réputées certaines et immuables, en ce monde où l’on n’est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. »
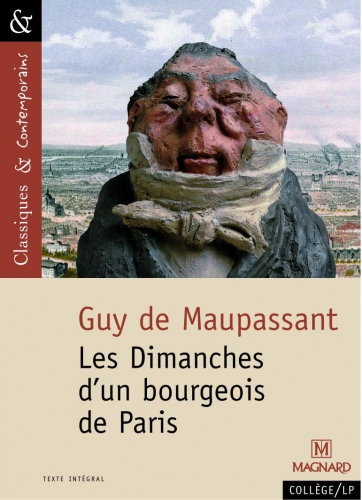
Dans Les dimanches d’un bourgeois de Paris Maupassant tape aussi sur la république et les élections. Et cela donne :
« Reste le suffrage universel. Vous admettez bien avec moi que les hommes de génie sont rares, n’est-ce pas ? Pour être large, convenons qu’il y en ait cinq en France, en ce moment. Ajoutons, toujours pour être large, deux cents hommes de grand talent, mille autres possédant des talents divers, et dix mille hommes supérieurs d’une façon quelconque. Voilà un état-major de onze mille deux cent cinq esprits. Après quoi vous avez l’armée des médiocres, qui suit la multitude des imbéciles. Comme les médiocres et les imbéciles forment toujours l’immense majorité, il est inadmissible qu’ils puissent élire un gouvernement intelligent. »
Et d’ajouter sur les députés :
« Autrefois, quand on ne pouvait exercer aucune profession, on se faisait photographe ; aujourd’hui on se fait député. Un pouvoir ainsi composé sera toujours lamentablement incapable ; mais incapable de faire du mal autant qu’incapable de faire du bien. Un tyran, au contraire, s’il est bête, peut faire beaucoup de mal et, s’il se rencontre intelligent (ce qui est infiniment rare), beaucoup de bien. »
Maupassant est libertarien en fait :
« Entre ces formes de gouvernement, je ne me prononce pas ; et je me déclare anarchiste, c’est-à-dire partisan du pouvoir le plus effacé, le plus insensible, le plus libéral au grand sens du mot, et révolutionnaire en même temps, c’est-à-dire l’ennemi éternel de ce même pouvoir, qui ne peut être, de toute façon, qu’absolument défectueux. Voilà. »
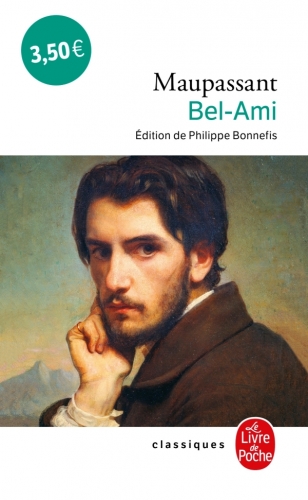
Dans Bel-ami l’auteur français le plus lu dans le monde durant un siècle écrivait :
« Il espérait bien réussir en effet à décrocher le portefeuille des Affaires étrangères qu’il visait depuis longtemps. C’était un de ces hommes politiques à plusieurs faces, sans conviction, sans grands moyens, sans audace et sans connaissances sérieuses, avocat de province, joli homme de chef-lieu, gardant un équilibre de finaud entre tous les partis extrêmes, sorte de jésuite républicain et de champignon libéral de nature douteuse, comme il en pousse par centaines sur le fumier populaire du suffrage universel. Son machiavélisme de village le faisait passer pour fort parmi ses collègues, parmi tous les déclassés et les avortés dont on fait des députés. Il était assez soigné, assez correct, assez familier, assez aimable pour réussir. Il avait des succès dans le monde, dans la société mêlée, trouble et peu fine des hauts fonctionnaires du moment. »
Depuis que nous sommes sous l’emprise de ses prédateurs dépourvus d’imagination (Castaneda) ou de cette modernité techno-sulfureuse, le Temps est, comme je ne cesse de le dire immobile. Même la mode disait Debord n’a plus bougé et ne bougera plus : costard-cravate. Et nous vivons dans un cercle d’informations abrutissantes et répétées. Debord :
« La construction d’un présent où la mode elle-même, de l’habillement aux chanteurs, s’est immobilisée, qui veut oublier le passé et qui ne donne plus l’impression de croire à un avenir, est obtenue par l’incessant passage circulaire de l’information, revenant à tout instant sur une liste très succincte des mêmes vétilles, annoncées passionnément comme d’importantes nouvelles ; alors que ne passent que rarement, et par brèves saccades, les nouvelles véritablement importantes, sur ce qui change effectivement. Elles concernent toujours la condamnation que ce monde semble avoir prononcée contre son existence, les étapes de son autodestruction programmée. »
Mais revenons au Horla et aux prédateurs. On a l’impression que Castaneda a lu et plagié Maupassant. Car le dernier maître de notre littérature (très grand inspirateur des deux plus grands génies du cinéma américain, Raoul Walsh et John Ford – la diligence…) écrit:
« Ah ! le vautour a mangé la colombe ; le loup a mangé le mouton ; le lion a dévoré le buffle aux cornes aiguës ; l’homme a tué le lion avec la flèche, avec le glaive, avec la poudre; mais le Horla va faire de l’homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf : sa chose, son serviteur et sa nourriture, par la seule puissance de sa volonté. Malheur à nous ! »
Ensuite on entre carrément dans la SF. Je vous laisse retrouver des titres de films (mon préféré est le classique de Don Siegel sur les body snatchers) et je cite :
« Mais celui qui me gouverne, quel est-il, cet invisible ? cet inconnaissable, ce rôdeur d’une race surnaturelle ?
Donc les Invisibles existent ! Alors, comment depuis l’origine du monde ne se sont-ils pas encore manifestés d’une façon précise comme ils le font pour moi ? Je n’ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s’est passé dans ma demeure. Oh ! si je pouvais la quitter, si je pouvais m’en aller, fuir et ne pas revenir. Je serais sauvé, mais je ne peux pas. »
Hitler a parlé dans Hitler m’a dit de Rauschning (je sais, c’est un faux, etc.) de ses visions du dur surhomme qui l’effrayaient. Maupassant :
« On dirait que l’homme, depuis qu’il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde, et que, le sentant proche et ne pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé, dans sa terreur, tout le peuple fantastique des êtres occultes, fantôme vagues nés de la peur… »
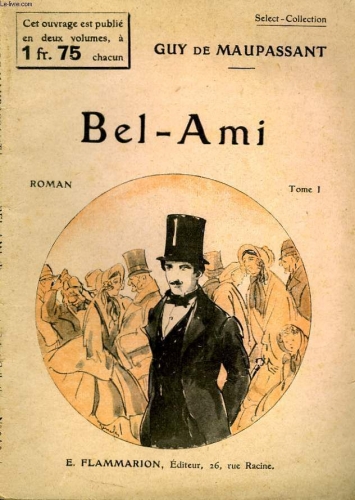
Après le narrateur fait allusion au grand espace :
« Pas de lune. Les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants. Qui habite ces mondes ? Quelles formes, quels vivants, quels animaux, quelles plantes sont là-bas ? Ceux qui pensent dans ces univers lointains, que savent-ils plus que nous ? Que peuvent-ils plus que nous ? Que voient-ils que nous ne connaissons point ? Un d’eux, un jour ou l’autre, traversant l’espace, n’apparaîtra-t-il pas sur notre terre pour la conquérir, comme les Normands jadis traversaient la mer pour asservir des peuples plus faibles ? »
Et il cite la presse ce narrateur (le conditionnement par la presse est la clé de l’involution spirituelle puis psychique depuis cinq siècles – relisez Macluhan) :
« Une nouvelle assez curieuse nous arrive de Rio de Janeiro. Une folie, une épidémie de folie, comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d’Europe au moyen âge, sévit en ce moment dans la province de San-Paulo.
Les habitants éperdus quittent leurs maisons, désertent leurs villages, abandonnent leurs cultures, se disant poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles bien que tangibles, des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie, pendant leur sommeil, et qui boivent en outre de l’eau et du lait sans paraître toucher à aucun autre aliment. »
Ici on est très proche du film Prédateur ; car la petite paysanne indienne explique qu’un diable venu de l’espace venait dans sa jeunesse manger les hommes. Le savant ufologue Jean-Pierre Petit a fait état d’observations en ce sens dans plusieurs de ses livres :
« Il est venu, Celui que redoutaient les premières terreurs des peuples naïfs, Celui qu’exorcisaient les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient par les nuits sombres, sans le voir apparaître encore, à qui Les pressentiments des maîtres passagers du monde prêtèrent toutes les formes monstrueuses ou gracieuses des gnomes, des esprits, des génies, des fées, des farfadets. »
Ce qui m’intéresse en conclusion c’est de souligner que le fantastique – comme la crétinisation industrielle et typographique-médiatique – s’est développé avec la révolution industrielle, technologique et médiatique, comme si nous avions en notre époque troublée lâché et absorbé des forces méphitiques, comme ce qui était annoncé du reste dans l’Apocalypse. J’ai cité Monseigneur Gaume qui a très bellement parlé pour nous éclairer de « boucherie des âmes » pour expliquer ce qui se passe en nous depuis le temps des Lumières…
Et je vous recommande pour terminer de pratiquer la discipline de Castaneda ainsi que la relecture de mon livre sur Littérature et conspiration…
Sources :
http://achard.info/debord/CommentairesSurLaSocieteDuSpect...
http://maupassant.free.fr/pdf/horla.pdf
https://www.dedefensa.org/article/le-pokemon-et-la-cretin...
https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/05/covid-arnaqu...
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/12/01/t...
20:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guy de maupassant, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, nicolas bonnal; |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution des numéros 449 et 450 du Bulletin célinien
 N°449:
N°449:
Sommaire :
Entretien avec Damian Catani –
Le Céline de Damian Catani –
Dr Destouches versus Dr Ichok. Retour sur une rivalité médicale.
Suite à la parution de Céline à hue et à dia, un ami m’écrit qu’il n’apprécie guère que l’on prenne D’un château l’autre pour une œuvre historique. « Les malheureux exilés de Sigmaringen ne méritaient pas cela, et ces sarcasmes à leurs dépens me chagrinent », ajoute-t-il. Il n’est pas le seul. À la différence d’un Rebatet, Pierre-Antoine Cousteau se sentit, lui, franchement offensé par ce livre qu’il considérait comme une trahison. C’est que celui qu’on appelait « PAC » avait l’esprit clanique et réagissait comme tel. Céline, lui, se voulait libre et n’entendait pas être assimilé aux journalistes de la presse collabo qui, contrairement à lui, étaient rémunérés et soumis à la censure allemande. D’un autre côté, nombreux furent les témoins de l’époque à dire que, malgré ses outrances et affabulations, Céline est le seul à avoir restitué la vérité de ce que fut le chaudron de Sigmaringen. La déception de Cousteau fut à la mesure de l’admiration qu’il portait auparavant au pamphlétaire. En mars 1957, dans le premier numéro de la revue de son ami Coston, il rappelle que Céline est « le plus grand polémiste de l’immédiate avant-guerre ». Mais trois mois plus tard paraît D’un château l’autre, précédé dans la presse de la fameuse interview à L’Express, qui va susciter l’ire de PAC. Au point de lui consacrer, en quelques semaines, pas moins de trois articles. Le premier paraît le 20 juin dans l’hebdomadaire Rivarol sous le titre « M. Céline rallie le fumier (doré) du système ». Le seul fait qu’il ait accordé un entretien à L’Express, dirigé par Schreiber et Giroud-Gourdji, le hérisse, et plus encore le fait que Céline renie, selon lui, ce qu’il écrivit jadis dans ses pamphlets.
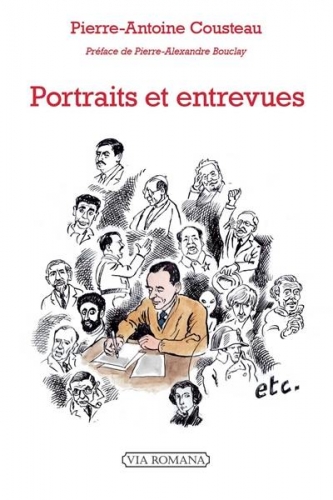
Dans la revue Lectures françaises, il remet le couvert, pratiquant la satire avec un art consommé. Parodiant le titre du roman qui marque le grand retour de Céline sur la scène littéraire, il porte l’estocade, le 11 juillet, avec un brûlot titré « D’un râtelier l’autre ». Son goût de la parodie y fait merveille. Cet article vient d’être repris dans une anthologie des écrits journalistiques de Cousteau. Bien entendu, Céline ne laissera pas ces attaques sans réponse : il y répliquera dès son roman suivant, Nord, précisant qu’il n’avait pas besoin d’autres haineux, ceux de son clan lui suffisant. PAC y est cité une dizaine de fois. Idem dans Rigodon (posthume), où il se voit traité d’employé de la Propagandastaffel, et de « bourrique » aussi enragée que Sartre. Toutes ces querelles appartiennent au passé. Ce qui importe désormais c’est le talent. Et, s’il n’atteignait pas, loin s’en faut, le génie de Céline, Cousteau n’était pas dépourvu de savoir-faire. Dans un style bien différent, ce prince de la litote était un sacré polémiste. Qu’il se soit, lui aussi, fourvoyé ne change rien à l’affaire. Depuis qu’il est à la retraite, son fils, cardiologue émérite, a entrepris de publier sa biographie et différents inédits, dont son journal de prison, qui constitue un document exceptionnel. Reste à rééditer Les Lois de l’hospitalité, sans doute son meilleur livre. Il n’a jamais été republié depuis sa parution, l’année même où parut D’un château l’autre. Cousteau mourut prématurément l’année suivante, victime d’un cancer qui suscita, il faut bien en convenir, les sarcasmes malvenus de Céline dans Rigodon. Ce qui lui vaudra d’être vilipendé post-mortem par l’un des amis de Cousteau lorsque ce livre fut réédité en Pléiade¹.
• Pierre-Antoine COUSTEAU, Portraits et entrevues [textes réunis et présentés par Jean-Pierre Cousteau], préface de Pierre-Alexandre Bouclay , Via Romana, 2022, 410 p. (29 €)
 N°450:
N°450:
Sommaire :
Woinville, 22 septembre 1914
Les affabulations de Marc-Édouard Nabe
Bibliographies
Entretien avec Jean Guenot (3e partie)
Céline sauvé par ses pamphlets ? Telle est la thèse hétérodoxe d’un prêtre catholique, docteur en philosophie. Ils sauvent, selon lui, l’œuvre célinienne « de la banalisation, de l’embourgeoisement, bref du “classicisme” ». …Comme si cette œuvre avait besoin de ça ! Jamais les lettrés ne risqueront de la trouver banale ou conformiste. Ni même classique au sens où l’entend l’auteur. Et Céline n’a aucunement besoin du scandale pour demeurer un auteur vivant, comme l’a récemment montré l’écho suscité par la découverte des manuscrits inédits. Le scandale suscité par ses écrits polémiques aurait plutôt pour effet d’écarter de lui de nombreux lecteurs. Ce scandale, l’auteur ne craint pas de l’affronter, rendant compte, de manière probe, de la teneur des “pamphlets”. (Pas tous. Mea culpa n’est pas pris en compte, ce qui est dommage car il s’y trouve un passage qui plairait au philosophe chrétien.) À juste titre, il estime Bagatelles supérieur aux deux suivants, appréciant notamment l’épisode à l’hôpital de Leningrad, « absolument hilarant ». D’une manière générale, il estime que ce livre, en beaucoup d’endroits, est « un ouvrage intensément drôle, qui fait hurler de rire son lecteur. » Commentaire audacieux alors que certains s’attachent aujourd’hui à culpabiliser ceux qui osent rire à la lecture de ce brûlot. À propos de L’École des cadavres, l’auteur rappelle qu’il faut se garder de verser dans l’anachronisme et rappelle que le livre a été publié en novembre 1938 : « La France n’est nullement en guerre contre l’Allemagne, encore moins envahie par les Allemands. » Et d’ajouter que ce pamphlet n’est pas un livre « collaborationniste ». Mais sait-il que, quatre ans plus tard, Céline le revendiquera comme étant « collaborateur (avant le mot) » ? Quant aux Beaux draps, il écrit que ce livre est « beaucoup plus lisible et intéressant » que le précédent. L’auteur commet, en revanche, un contresens lorsqu’il estime que Céline se contredit, ayant d’abord proclamé, rappelle-t-il, son intention de ne jamais « s’engager ». Si le pamphlétaire affirme dans Bagatelles qu’il n’a, en effet, jamais pris parti pour tel ou tel, bref qu’il n’a voulu être inféodé à personne, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’ait pas pris position. Lorsque les Allemands confisquent son or en Hollande, il écrit à Brinon : « J’espère que l’on voudra bien ne pas me “punir” d’avoir été partisan. »

L’auteur n’est pas un célinien patenté. Ainsi n’apprécie-t-il guère, dans la trilogie allemande, les passages savoureux où Céline évoque sa vie à Meudon. Il assure aussi que, même lorsqu’on l’apprécie, Nord est « un peu longuet » (!). En le lisant, on comprend que ses goûts l’orientent davantage vers des écrivains, également sulfureux, mais plus conventionnels. Il a devancé le reproche qu’on pourrait lui adresser en rappelant que ces auteurs – également traités dans son livre –, pour critiquables qu’ils soient, n’ont jamais assassiné personne. Et d’ajouter ceci qui ne manque pas de force : « Quand je pense que de grands massacreurs comme Danton et Robespierre possèdent respectivement une vingtaine de rues à leur nom en France ; quand je songe qu’un archi-criminel scandaleux comme Lénine est gratifié de près de quatre-vingt-dix rues, toujours en France, je me dis que parler de Drumont, de Barrès, ou de Maurras, est vraiment permis aux honnêtes gens¹. »
• Grégoire CELIER, Le XIXe parallèle (Flâneries littéraires hors des sentiers battus), Via Romana, 2022, 348 p.
18:40 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, louis-ferdinand céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Astolphe de Custine et les racines du conflit entre Russes et Occidentaux
Nicolas Bonnal
Les lettres de Custine sont une démonstration géopolitique du présent permanent : dans les années 1830-40, le « monde moderne » se forme – et comme dit Guénon, au moment où on abuse du mot, la « civilisation » au sens réel et traditionnel disparaît.
A ce moment se crée le combat et le thème de la russophobie. Custine incarne cet ordre libéral à qui la Russie répugne. Et cela donne ces lignes sur le Russe :
«Le despotisme complet, tel qu'il règne chez nous, s'est fondé au moment où le servage s'abolissait dans le reste de l'Europe. Depuis l'invasion des Mongols, les Slaves, jusqu'alors l'un des peuples les plus libres du monde, sont devenus esclaves des vainqueurs d'abord, et ensuite de leurs propres princes. Le servage s'établit alors chez eux non-seulement comme un fait, mais comme une loi constitutive de la société. Il a dégradé la parole humaine en Russie, au point qu'elle n'y est plus considérée que comme un piège: notre gouvernement vit de mensonge, car la vérité fait peur au tyran comme à l'esclave. Aussi quelque peu qu'on parle en Russie, y parle-t-on encore trop, puisque dans ce pays tout discours est l'expression d'une hypocrisie religieuse ou politique".
«L'autocratie, qui n'est qu'une démocratie idolâtre, produit le nivellement tout comme la démocratie absolue le produit dans les républiques simples. »

Custine voit déjà le futur « homo sovieticus » de Zinoviev et il décrit le russe comme un automate :
« Ce membre, fonctionnant d'après une volonté qui n'est pas en lui, vit autant qu'un rouage d'horloge; on appelle cela l'homme, en Russie… La vue de ces automates volontaires me fait peur; il y a quelque chose de surnaturel dans un individu réduit à l'état de pure machine. Si, dans les pays où les mécaniques abondent, le bois et le métal nous semblent avoir une âme, sous le despotisme les hommes nous semblent de bois; on se demande ce qu'ils peuvent faire de leur superflu de pensée, et l'on se sent mal à l'aise à l'idée de la force qu'il a fallu exercer contre des créatures intelligentes pour parvenir à en faire des choses; en Russie j'ai pitié des personnes, comme en Angleterre j'avais peur des machines. Là il ne manque aux créations de l'homme que la parole; ici la parole est de trop aux créatures de l'État. »
Petite pointe involontairement humoristique :
« Ces machines, incommodées d'une âme, sont, au reste, d'une politesse épouvantable; on voit qu'elles ont été ployées dès le berceau à la civilité comme au maniement des armes… »
On fait souvent de Poutine un grand joueur d’échecs. Custine écrit déjà :
« Cette population d'automates ressemble à la moitié d'une partie d'échecs, car un seul homme fait jouer toutes les pièces, et l'adversaire invisible, c'est l'humanité. On ne se meut, on ne respire ici que par une permission ou par un ordre impérial; aussi tout est-il sombre et contraint; le silence préside à la vie et la paralyse. Officiers, cochers, cosaques, serfs, courtisans, tous serviteurs du même maître avec des grades divers, obéissent aveuglément à une pensée qu'ils ignorent; c'est un chef-d'œuvre de discipline; mais la vue de ce bel ordre ne me satisfait pas du tout, parce que tant de régularité ne s'obtient que par l'absence complète d'indépendance. »
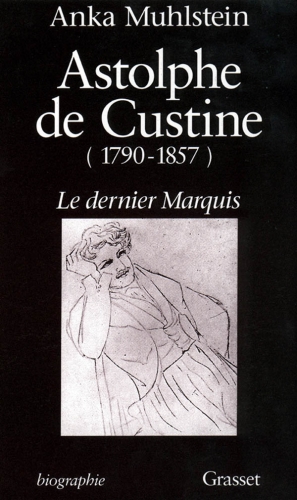
Un seul cerveau contrôle tout le monde :
« Parmi ce peuple privé de loisir et de volonté, on ne voit que des corps sans âmes, et l'on frémit en songeant que, pour une si grande multitude de bras et de jambes, il n'y a qu'une tête. »
Et Custine prévoit aussi la Révolution russe :
« Le pouvoir exorbitant et toujours croissant du maître est la trop juste punition de la faiblesse des grands. Dans l'histoire de Russie personne, hors l'Empereur, n'a fait son métier; la noblesse, le clergé, toutes les classes de la société se sont manqué à elles-mêmes. Un peuple opprimé a toujours mérité sa peine; la tyrannie est l'œuvre des nations. Ou le monde civilisé passera de nouveau avant cinquante ans sous le joug des barbares, ou la Russie subira une révolution plus terrible que ne le fut la révolution dont l'Occident de l'Europe ressent encore les effets. »
Ceci dit il prévoit une guerre avec supériorité russe à la clé :
« Lorsque notre démocratie cosmopolite, portant ses derniers fruits, aura fait de la guerre une chose odieuse à des populations entières, lorsque les nations, soi-disant les plus civilisées de la terre, auront achevé de s'énerver dans leurs débauches politiques, et que de chute en chute elles seront tombées dans le sommeil au dedans et dans le mépris au dehors, toute alliance étant reconnue impossible avec ces sociétés évanouies dans l'égoïsme, les écluses du Nord se lèveront de nouveau sur nous, alors nous subirons une dernière invasion non plus de barbares ignorants, mais de maîtres rusés, éclairés, plus éclairés que nous, car ils auront appris de nos propres excès comment on peut et l'on doit nous gouverner. »
Une génération plus tard Ernest Renan écrira à ce propos :
« Le Slave, dans cinquante ans, saura que c’est vous qui avez fait son nom synonyme d’esclave : il verra cette longue exploitation historique de sa race par la vôtre, et le nombre du Slave est le double du vôtre, et le Slave, comme le dragon de l’Apocalypse dont la queue balaye la troisième partie des étoiles, traînera un jour après lui le troupeau de l’Asie centrale, l’ancienne clientèle des Gengis Khan et Tamerlan. »
https://www.gutenberg.org/ebooks/25755
https://www.les4verites.com/culture-4v/1870-la-prophetie-...
11:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : russophobie, astolphe de custine, 19ème siècle, russie, france, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

De Pétain à Macron: Bernanos contre leur France robotisée
Nicolas Bonnal
Bernanos publie sa fastueuse France contre les robots en 1945. Il rêve d’une France qui serait reine de la Liberté dans le futur, mais nous savons ce qu’il en est. Pour le reste il ne se trompe sur rien ; il voit un monde déjà unifié (le monde multilatéral est un simulacre sur le plan du réalisme) :
« Car, à la fin du compte, la Russie n’a pas moins tiré profit du système capitaliste que l’Amérique ou l’Angleterre ; elle y a joué le rôle classique du parlementaire qui fait fortune dans l’opposition. Bref, les régimes jadis opposés par l’idéologie sont maintenant étroitement unis par la technique. »
Il résume le monde moderne :
« Un monde gagné pour la Technique (qui) est perdu pour la Liberté. »
Il voit déjà un monde fermé, comme celui de nos passes vaccinaux et politiques (voyez les émissions de l’avocat Pierre Gentillet) :
« Jamais un système n’a été plus fermé que celui-ci, n’a offert moins de perspectives de transformations, de changements, et les catastrophes qui s’y succèdent, avec une régularité monotone, n’ont précisément ce caractère de gravité que parce qu’elles s’y passent en vase clos. »

Le monde moderne est le fils de la civilisation capitaliste anglo-saxonne ; les démocraties et les dictatures ne sont pas très différentes :
« Ce qui fait l’unité de la civilisation capitaliste, c’est l’esprit qui l’anime, c’est l’homme qu’elle a formé. Il est ridicule de parler des dictatures comme de monstruosités tombées de la lune, ou d’une planète plus éloignée encore, dans le paisible univers démocratique. Si le climat du monde moderne n’était pas favorable à ces monstres, on n’aurait pas vu en Italie, en Allemagne, en Russie, en Espagne, des millions et des millions d’hommes s’offrir corps et âmes aux demi-dieux, et partout ailleurs dans le monde — en France, en Angleterre, aux États-Unis — d’autres millions d’hommes partager publiquement ou en secret la nouvelle idolâtrie. »
Bernanos résume son époque de pétainistes de 1945 :
« …contre de Gaulle cette poignée de nobles dégénérés, de militaires sans cervelle et sans cœur, d’intellectuels à la solde des spéculateurs, d’académiciens sans vergogne, de prélats serviles… »
Les seuls à attaquer la tyrannie vaccinale sont d’ailleurs les gaullistes (il est vrai qu’en Gaule éternellement occupée tout le monde se réclame de lui). Bernanos aussi souligne une « coalition d’ignorance et d’intérêts… ». On est bien d’accord.
Pour le reste il rappelle :
« Ce sont les démocrates qui font les démocraties, c’est le citoyen qui fait la République. Une démocratie sans démocrates, une République sans citoyens, c’est déjà une dictature. »
Depuis la Révolution Française on a créé le citoyen docile :
« Tel est le résultat de la propagande incessante faite depuis tant d’années par tout ce qui dans le monde se trouve intéressé à la formation en série d’une humanité docile, de plus en plus docile, à mesure que l’organisation économique, les concurrences et les guerres exigent une réglementation plus minutieuse. »

Bernanos a été marqué par une pièce du méprisé Courteline :
« Il y a vingt ans, le petit bourgeois français refusait de laisser prendre ses empreintes digitales, formalité jusqu’alors réservée aux forçats…Ce n’était pas ses doigts que le petit bourgeois français, l’immortel La Brige de Courteline, craignait de salir, c’était sa dignité, c’était son âme. »
Ce résistant annonçait un monde sinistre :
« Le petit bourgeois français n’avait certainement pas assez d’imagination pour se représenter un monde comme le nôtre si différent du sien, un monde où à chaque carrefour la Police d’État guetterait les suspects, filtrerait les passants, ferait du moindre portier d’hôtel, responsable de ses fiches, son auxiliaire bénévole et public. »
Avant le marquage numérique, le marquage digital n’est guère acceptable ; mais il fut accepté par tout le monde :
« Depuis vingt ans, combien de millions d’hommes, en Russie, en Italie, en Allemagne, en Espagne, ont été ainsi, grâce aux empreintes digitales, mis dans l’impossibilité non pas seulement de nuire aux Tyrans, mais de s’en cacher ou de les fuir ? »
Brève allusion au code QR ou au Nombre de la Bête :
« Et lorsque l’État jugera plus pratique, afin d’épargner le temps de ses innombrables contrôleurs, de nous imposer une marque extérieure, pourquoi hésiterions-nous à nous laisser marquer au fer, à la joue ou à la fesse, comme le bétail ? L’épuration des Mal-Pensants, si chère aux régimes totalitaires, en serait grandement facilitée. »
La civilisation de la liberté sous l’Ancien Régime (que Bernanos reconnaît, mais pas Foucault – par exemple) a disparu car l’homme preux de l’Ancien monde est mort. Ce qui reste c’est le bobo acidulé ou le retraité téléphage que Bernanos décrit dans ses termes :
« Une civilisation ne s’écroule pas comme un édifice ; on dirait beaucoup plus exactement qu’elle se vide peu à peu de sa substance, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que l’écorce. On pourrait dire plus exactement encore qu’une civilisation disparaît avec l’espèce d’homme, le type d’humanité, sorti d’elle. »

Le service militaire a joué son rôle (la France toujours est responsable…) :
« L’institution du service militaire obligatoire, idée totalitaire s’il en fut jamais, au point qu’on en pourrait déduire le système tout entier comme des axiomes d’Euclide la géométrie, a marqué un recul immense de la civilisation. »
Il ne faut pas s’étonner de la passivité et de la collaboration de la population. L’homme hait la Liberté :
« Des millions et des millions d’hommes ne croyaient plus à la liberté, c’est-à-dire qu’ils ne l’aimaient plus, ils ne la sentaient plus nécessaire, ils y avaient seulement leurs habitudes, et il leur suffisait d’en parler le langage. Depuis longtemps, l’État se fortifiait de tout ce qu’ils abandonnaient de plein gré. Ils n’avaient que le mot de révolution à la bouche, mais ce mot de révolution, par une comique chinoiserie du vocabulaire, signifiait la Révolution Socialiste, c’est-à-dire le triomphal et définitif avènement de l’État, la Raison d’État couronnant aussi l’édifice économique… »
Et notre écrivain ajoute magnifiquement :
« Ils le savaient bien, ils souhaitaient en finir le plus tôt possible avec leur conscience, ils souhaitaient, au fond d’eux-mêmes, que l’État les débarrassât de ce reste de liberté, car ils n’osaient pas s’avouer qu’ils en étaient arrivés à la haïr. Oh ! ce mot de haine doit paraître un peu gros, qu’importe ! Ils haïssaient la liberté comme un homme hait la femme dont il n’est plus digne… »
Je vous laisse redécouvrir ce texte inoubliable et inutile.
Sources:
https://www.youtube.com/watch?v=RJ6xLA0LQqk
https://fr.wikisource.org/wiki/La_France_contre_les_robots
https://fr.wikisource.org/wiki/Boubouroche_et_autres_pi%C...
17:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bernanos, france, robots, robotisation, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du n°448 du Bulletin Célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Gianni Celati nous a quittés
Entretien avec Jean Guenot (II)
Un professeur suisse nous fait relire Bagatelles
Oscar Rosembly (1909-1990)
Rosembly dans Gringoire
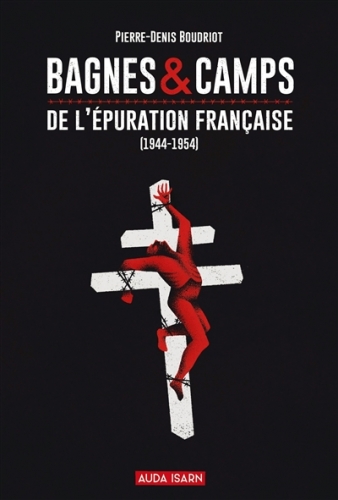
Mais c’est aux prisons françaises de l’épuration qu’un historien, Pierre-Denis Boudriot, vient de consacrer un livre d’autant plus passionnant que le sujet n’a jamais été traité auparavant. Cette plongée dans le monde carcéral de l’immédiate après-guerre est basée sur les nombreux témoignages de condamnés politiques. Aussi retrouve-t-on dans ce livre des personnages connus tels ceux déjà cités mais aussi Ralph Soupault, Lucien Combelle, Claude Jamet et d’autres qui payèrent parfois très cher leur engagement. L’auteur s’est également appuyé, ce qui est plus rare, sur les nombreuses notes et circulaires de l’administration pénitentiaire relatives aux maisons centrales et à leurs prisonniers. L’exceptionnelle richesse documentaire de ce fonds donne à cet ouvrage tout son prix. La confrontation de ces deux sources a permis de confirmer la véracité des écrits des épurés, souvent jugés tendancieux car pétris de ressentiment. De manière exhaustive, l’auteur analyse tout ce qui constitue la vie carcérale : le personnel pénitentiaire, la discipline, l’alimentation, le travail, la correspondance et le parloir, les lectures (autorisées), puis l’amnistie et les libérations conditionnelles ou anticipées. Et enfin, sous le titre « Une vie à recommencer », le retour au foyer. Ce sujet a concerné pas moins de 10.000 hommes et 4.000 femmes de toutes conditions sociales, connus ou pas. Un ouvrage dont le réalisme suscite une certaine compassion rétrospective tant les conditions de détention étaient dures à cette époque.
• Pierre-Denis BOUDRIOT, Bagnes & camps de l’épuration française (1944-1954), Auda Isarn [BP 80432, 31004 Toulouse cedex 6], 2021, 239 p., bibliographie et index (20 € franco)
09:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, revue, livre, épuration, univers carcéral, prison, années 40 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du n°447 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Entretien avec Jean Guenot
Céline dans France-Soir (1946-47)
Entretien avec Oskar Hedemann
Suspicion et mauvaise foi. C’est ce qui caractérise l’article de Philippe Roussin sur l’affaire des manuscrits retrouvés. Il tance les ayants droit et loue le receleur. Selon lui, il n’y eut d’ailleurs pas de recel puisqu’il n’y eut pas de vol ! Explication : les manuscrits furent « abandonnés » [sic] par Céline. Spécieux. Tout juste si Roussin ne le suspecte pas d’avoir laissé ouverte la porte de son appartement lorsqu’il s’enfuit le 17 juin 1944. Peu importe que celui-ci ait écrit : « On ne va rien toucher à l’appartement on reviendra… l’on ne peut pas dire que l’on ne reviendra jamais. » Si Céline avait été propriétaire (et non locataire) de l’appartement rue Girardon, Roussin serait-il aussi péremptoire ? Ce qui l’insupporte, c’est que, dans cette affaire, l’écrivain soit considéré comme un volé, et donc une victime. Logique : si l’écrivain n’a pas été volé, les ayants droit n’avaient aucune raison d’ester en justice. Ce que Roussin omet soigneusement de préciser, c’est que si François Gibault et Véronique Chovin ont déposé plainte, c’est parce que Thibaudat refusait obstinément de restituer ces manuscrits qui leur appartiennent. Et entendait décider seul de leur sort : en l’occurrence, en faire don à l’Institut Mémoire de l’Édition (IMEC) dont il est proche. Par ailleurs, le fait que ce recel ait privé Lucette d’une joie certaine ne préoccupe nullement Roussin. Pas davantage le fait qu’à la fin de sa vie, elle avait un pressant besoin d’argent, ayant à rémunérer plusieurs personnes qui s’occupaient d’elle en permanence. Thibaudat, lui, se considérait comme le dépositaire des manuscrits, ce qui l’a autorisé à les garder par devers lui pendant des années. Le conseil des ayants droit, Jérémie Assous, n’a pas tort de dire que le journaliste de Libé est comparable à quelqu’un qui aurait gardé pendant des décennies dans son salon une toile de maître volée. Mais, de toute évidence, le droit moral et patrimonial des héritiers, Roussin n’en a cure. Mieux : il leur fait un procès d’intention en subodorant qu’ils pourraient garder sous le boisseau des textes compromettants, ce qui est saugrenu, connaissant l’objectivité du biographe qu’est Gibault. Roussin, auteur d’un livre sur Céline de 800 pages, a-t-il jamais éprouvé pour l’écrivain « une admiration sans bornes », à l’instar de Taguieff et Duraffour qui nous firent cette confidence dans leur livre obèse ? Sûrement pas. On comprend même, entre les lignes, que Céline ne mérite pas, selon lui, le statut de « plus grand écrivain français du XXe siècle » qu’on lui accorde généralement. Et de citer complaisamment l’appréciation de Houellebecq qui le considère comme « un auteur ridiculement surévalué ». Venant de la part de quelqu’un dont le style est aussi plat qu’une limande, cela prête à sourire. Quant à Roussin, il estime qu’il faut rendre grâce à ceux qui ont “recueilli” ces manuscrits pendant des décennies. Et qu’il faut, en revanche, juger âprement les ayants droit qui ont eu le front de déposer plainte. Il importe surtout de condamner, une fois encore et toujours, les fautes dont Céline s’est rendu coupable. Et de ressasser ad libitum les éléments du procès qui lui est intenté depuis près de 80 ans. C’est qu’il s’agit pour Roussin de conjurer « le mauvais vent d’hiver maurrassien de l’époque ». De la part d’un fonctionnaire, on pouvait s’attendre à davantage de réserve. L’ironie de l’histoire étant que cet article soit publié sur un site internet placé sous l’égide de Maurice Nadeau qui prit fait et cause pour Céline lorsqu’il était exilé.
• Philippe ROUSSIN, « Déshonneur et patrie : retour sur l’affaire Céline », En attendant Nadeau, 15 décembre 2021 [https://www.en-attendant-nadeau.fr/2021/12/15/deshonneur-patrie-affaire-celine].

Marc Laudelout
Céline à hue et à dia
Louis-Ferdinand Céline est un immense écrivain. Il fut aussi antisémite et souhaita la victoire des forces de l’Axe. Deux raisons pour lesquelles il est légitime pour beaucoup de le honnir. Mais ce n’est pas suffisant pour certains qui, ajoutant la diffamation à la détestation, l’accusent d’avoir été un vil délateur, un auxiliaire de la police allemande et un partisan du génocide. Sans apporter aucune preuve formelle et contredisant ainsi les spécialistes intègres de l’écrivain : « Ses pamphlets ne présentent pas d’appel au meurtre explicite » (R. Tettamanzi) ; « Céline n’avait pas voulu l’holocauste et n’en avait pas même été l’involontaire instrument » (F. Gibault) ; « Les mesures que Céline préconise contre les juifs se suffisent à elles-mêmes, sans qu’on aille jusqu’à lui prêter une idée ou un désir d’extermination » (H. Godard).
D’autres enfin, pour enfoncer le clou, affirment que c’est un écrivain surévalué. Dans cet ouvrage, Marc Laudelout, éditeur du Bulletin célinien depuis 40 ans, épingle ces anticéliniens rabiques. Il évoque aussi diverses interférences littéraires, dresse le portrait de quelques figures (dont les « céliniens historiques ») et explore quelques faits liés à la biographie ainsi qu’à la réception critique de l’œuvre.
Un volume broché de 412 pages, 25 € frais de port inclus.
Exemplaire dédicacé sur demande.
Mode de règlement : chèque (bancaire ou postal) à l’ordre de M. Laudelout. Ou par virement bancaire sur le compte LCL du Bulletin célinien à Lille : IBAN : FR59 3000 2082 3100 0019 5794 L60 (BIC : CRLYFRPP).
Dans ce cas, il est recommandé de nous adresser un courriel signalant ce virement.
Autre mode de paiement : virement sur le compte du BC à Bruxelles : BE 79 0637 1647 0933 (BIC : GKCCBEBB).
Commander à :
Marc Laudelout
139 rue Saint-Lambert
B. P. 77
BE 1200 Bruxelles
14:34 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, louis-ferdinand céline, céline, marc laudelout, livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Toulouse et le génie roman
Notes sur l'inspiration occitanienne
« Le voyage, l’amour et le songe d’Aquitaine
Ont dévorés l’espace où nous étions enfouis
Châteaux d’azur et d’or, petite île, fontaine
Fleuve que l’on remonte aux sources inouïes
Immobiles domaine
Flamine au Roi dormant qui traverse le Temple
Chercheur de grand soleil dans les brouillards glacés
Miroir magique écho, songe que je contemple
Jour après jour du fardeau compassé
D’un conte sans exemple
Le noble Voyageur vise la voie profonde… »
On comprendra fort peu de choses à l’œuvre de Henry Montaigu sans y reconnaître d'emblée une œuvre de combat. L'érudit, certes, y trouvera sa provende de repères historiques et d'aperçus précis mais, bien davantage qu'au spécialiste, cette œuvre s'adresse à l'amoureux, à celui dont les pas s'accordent à une songerie intérieure, semblable au Grand Songe qui donna naissance à la Ville, si bien que le parcours extérieur correspond à quelque parcours intérieur, au véritable sens du terme ésotérique. La Ville rose est une Dame. De même que, pour les Fidèles d'Amour, dont Toulouse est une sorte de capitale, il ne saurait être question, en aucune façon, de réduire les noces philosophales de l'Amour, de l'Amant et de l'Aimée à quelque déterminisme physiologique, de même l'approche symbolique de Toulouse, que propose Henry Montaigu ne cède en rien à cette superstition de l'histoire ou du « sens de l'histoire » qui tend à confondre l'enquête sur les choses avec les choses elles-mêmes.

Quelques historiens, dont l'esprit s'est un peu obscurci par la fréquentation assidue des idéologies, en oublient que les œuvres des hommes précèdent les études historiques dont elles font l'objet. Or, dans leur beauté et dans leur vérité, les œuvres témoignent bien davantage de l'Instant et du Permanent (qui sont en réalité une seule et même chose, c'est-à-dire, au sens étymologique, une seule et même cause) que de cette linéarité chronologique, qui détermine la méthode des historiens, et à laquelle certains d'entre eux voudraient contraindre les événements et les œuvres humaines et divines à se conformer. « Lorsque le cadre de l'histoire éclate, écrit Ernst Jünger, l'historiographie elle aussi doit se modifier et même faire choix d'un autre nom,- et surtout s'allier au poète qui seul est capable de venir à bout du titanisme. » Cette autre historiographie, alliée au poète, nulle mieux que l'œuvre de Henry Montaigu n'en laisse pressentir les promesses de vastitude conquise et de réconciliation spirituelle, car bien avant d'être un historien, même inspiré ou prophétique, Henry Montaigu est poète, et dans son œuvre de poète, écrivain français. Le roman légendaire et métaphysique Le Cavalier Bleu illustre à lui seul ce titre, que toute noblesse désormais se devrait de servir.
Ecrivain français, et non point, comme tant d'autres, compilateur mercenaire ivre de démagogie et de reniement, Henry Montaigu possède les droits de parler de ce dont il parle. Sa Ville miroite dans son imagination et sa plume dispose de l'art et de la résolution à faire partager son bonheur. Telle est la véritable générosité, qui ne se dispense pas en déclarations d'intentions mais en œuvres, écrites avec le sang, qui est esprit. A cette qualité d'écrivain français, l’œuvre d'Henry Montaigu ne doit pas seulement l'aisance et la grâce mais aussi le sens de la juste hiérarchie. Les principes et le Sacré ne se conçoivent que selon une logique de la Hauteur. Il est impossible d'en faire étalage. Ciels et abysses disposent notre entendement à recevoir le don de l'Ode aimée, qui est la forme immatérielle, et comme chantée, de la Ville. L'ambiguïté du mot « connaissance » suffit à nous faire comprendre en quoi cette « autre historiographie » diffère de celle à laquelle nous ont habitué certaines études universitaires soumises au « déterminisme historique ». Si la connaissance est l'accumulation des informations en vue de quelque mise en système, alors, il s'agit de tout autre chose que de connaissance au sens métaphysique et poétique du terme. En revanche, si nous entendons par « connaissance » un cheminement qui débute bien avant le labeur didactique et s'achève bien au-delà de lui, alors le terme de connaissance s'applique par excellence aux ouvrages de Henry Montaigu sur Toulouse, Reims, Rocamadour ou Paray-le-Monial.
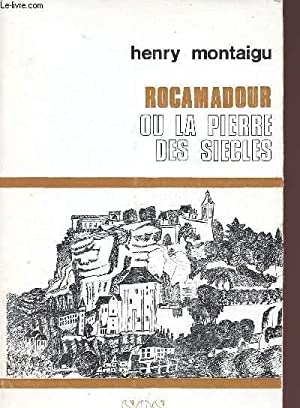 Il n'est point de connaissance sans confiance. Connaître, ce n'est point rester dans l'expectative mais devancer la preuve, en favoriser l'avènement par cette purification de l'entendement dont nous parlent les ascèses de toutes les traditions occidentales ou orientales. Nous ne connaissons jamais que ce que nous aimons. La confiance est inventive de cette Foi, que la Sapience déploie et dont la Chevalerie témoigne. Toute symbologie digne de ce nom s'accomplit en une gnose amoureuse. Rien n'est plus absurde, appliquée aux Symboles, que cette manie classificatoire qui, fidèle continuatrice de la grande platitude du positivisme du siècle dernier, méconnaît l'interdépendance des Symboles : arborescence où le bruissement des feuilles tournées par le vent tantôt vers l'ombre et vers le soleil n'est pas moins important que l'obscur trajet des racines dans l'humus.
Il n'est point de connaissance sans confiance. Connaître, ce n'est point rester dans l'expectative mais devancer la preuve, en favoriser l'avènement par cette purification de l'entendement dont nous parlent les ascèses de toutes les traditions occidentales ou orientales. Nous ne connaissons jamais que ce que nous aimons. La confiance est inventive de cette Foi, que la Sapience déploie et dont la Chevalerie témoigne. Toute symbologie digne de ce nom s'accomplit en une gnose amoureuse. Rien n'est plus absurde, appliquée aux Symboles, que cette manie classificatoire qui, fidèle continuatrice de la grande platitude du positivisme du siècle dernier, méconnaît l'interdépendance des Symboles : arborescence où le bruissement des feuilles tournées par le vent tantôt vers l'ombre et vers le soleil n'est pas moins important que l'obscur trajet des racines dans l'humus.
A cette démonie de la platitude, le génie d'Henry Montaigu oppose l'aperçu vertical se saisissant au vif de l'instant de l'éclat de l'éternité dans les apparences mêmes. Le grand malheur de la condition humaine est que cette grâce, même offerte, peut encore nous échapper, par pure inadvertance. D'où l'importance de ces œuvres de connaissance qui ne se substituent point à la Révélation, comme s'y emploient les dogmatiques modernistes, mais en prépare l'advenue imprévisible par cette prière suprême qui est le sens du recueillement intellectuel.
L'enseignement qu'il est possible, par exemple, de recevoir des Mythes et des Symboles de Toulouse dépasse la réalité même de la Ville. Enseignement initiatique par cela même qu'il est poétique et chevaleresque, il détermine aussi un moment décisif de cette guerre sainte de la verticalité contre la platitude, de l'Exception contre la médiocrité, seul véritable enjeu politique de quelque importance. L'Etat moderne, fondé sur le perfectionnement permanent du contrôle des citoyens obéit à une politique de planification, étrangère au génie politique traditionnel de la prévoyance, comme la quantité est étrangère à la qualité. Posant l'abstraction avant le fait, le planificateur méconnaît à tel point la réalité qu'il y suscite sans fin de nouveaux désastres.

Rien ne fut plus étranger à notre génie roman que cet idéal de l'Etat prussien qui, par l'entremise du philosophe Hegel, ou, plus exactement, de ses exégètes vulgarisateurs, nous imposa la morale utilitaire, selon laquelle « la fin justifie les moyens », et que nous voyons à l'œuvre en Politique, au détriment constant de la Beauté et de la Vérité. Cette morale qui « démocratiquement » s'est emparée de la politique, sans doute n'est-elle rien d'autre que le cheval de bataille du Diable, car, à séparer le Bien de son resplendissement dans la beauté sensible et métaphysique, il n'est plus que l'atroce parodie, la sempiternelle apologie du Médiocre par lui-même. A cette idéologie de la planification, la Tradition oppose donc l'éloge de la Prévoyance. Prévoit celui qui déchiffre ce qui est, car ce qui adviendra obéit aux mêmes lois que ce qui est. Le planificateur, au contraire, inverse l'ordre de la hiérarchie, conférant à son point de vue particulier une vertu d'universalité, alors que celle-ci ne peut être atteinte que par la multiplication infinie des points de vue, jusqu'à pressentir une vision de toutes parts, privilège traditionnel de la Sapience.
L'homme qui prévoit célèbre la hiérarchie des états multiples de l'être, l'homme qui planifie la bafoue. Déchiffrer les arcanes de la Ville c'est ainsi faire œuvre chevaleresque sous la double égide de la Sapience et de la Foi. Une certaine idée du Pays, du Mystère de la France, et de la liberté créatrice qui lui est particulière, est exposée, mise à l'épreuve. Le « privilège immémorial de la franchise » qui définit l'homme de France comme un homme libre, tient, pour Henry Montaigu, lieu de Norme. L'équilibre de justice qu'elle invente est des plus gracieux et sa défense est une tâche noble. En exergue à son Histoire secrète de l'Aquitaine Henry Montaigu cite l'admirable fragment de Joseph Joubert: « Le léger domine le lourd. Quand la lumière domine l'ombre, quand le fin domine l'épais, quand le clair domine l'obscur, quand l'esprit domine le corps, l'intelligence la matière, alors le beau domine le difforme et le bien domine le mal. » Lorsque le léger domine le lourd, la platitude est vaincue. La verticalité reprend ses droits, les hauteurs dans l'âme humaine s'éveillent.
« L'amour courtois, écrit Simone Weil dans un bel essai sur l'inspiration occitanienne, avait pour objet un être humain; mais il n'est pas une convoitise. Il n'est qu'une attente dirigée vers l'être aimé et qui en appelle le consentement. Le mot de merci par lequel les troubadours désignaient ce consentement est tout proche de la notion de grâce. Un tel amour dans sa plénitude est amour de Dieu à travers l'être aimé. Dans ce pays comme en Grèce, l'amour humain fut un des ponts entre l'homme et Dieu. La même inspiration resplendit dans l'art roman. L'architecture, quoique ayant empruntée une forme à Rome n'a nul souci de la puissance ni de la force, mais uniquement de l'équilibre... L'église romane est suspendue comme une balance autour de son point d'équilibre, un point d'équilibre qui ne repose que sur le vide et qui est sensible sans que rien en marque l'emplacement. C'est ce qu'il faut pour enclore cette croix qui fut une balance où le corps du Christ fut le contrepoids de l'univers. »

Ce que les mystiques persans nommaient « la science de la Balance », et qui procède de l'intuition du Juste Milieu (et dont la commune-mesure est la parodie diabolique), la Tradition, dont la ville de Toulouse est l'inspiratrice sensible, et que Henry Montaigu ressuscite sous nos yeux par la vertu poétique de phrases précises, en vérifie la juste pesée qui n'est autre que la pensée même, au sens métaphysique d'un équilibre, d'une harmonie des correspondances. Car la pensée,- l'étymologie même du mot nous l'enseigne,- est avant tout cette pesée analogique, cette recherche de la justice par la méditation des Symboles, cette quête de l'orée divinatoire entre la part visible du monde et la part invisible dont la vérité du cœur reconnaît qu'elles sont aussi légères l'une que l'autre.
Toute juste pesée allège le monde, l'élève dans le resplendissement des analogies. La spéculation métaphysique danse de reflet en reflet dans l'inaltérable apesanteur de la lumière: « Les Pythagoriciens, nous dit encore Simone Weil, disaient que l'harmonie ou la proportion est l'unité des contraires en tant que contraires. Il n'y a pas harmonie là où l'on fait violence aux contraires pour les rapprocher; non plus là où on les mélange; il faut trouver le point de leur unité. Ne jamais faire violence à sa propre âme; ne jamais chercher ni consolation ni tourment; contempler la chose, quelle qu'elle soit, qui suscite une émotion, jusqu'à ce que l'on parvienne au point secret où douleur et joie, à force d'être pures, sont une seule et même chose; c'est la vertu même de la poésie. »
Nous retrouvons là cette méditation politique qui, si mal comprise qu'elle soit, demeure l'essentielle requête chevaleresque de l'œuvre historique de Henry Montaigu. Méditation de justice, qui refuse de se soumettre à la division du monde, de dresser l'obéissance contre la liberté, ou l'inverse,- l'œuvre de Henry Montaigu retrace la généalogie des songes et des lois, avec la pertinence héraldique de ceux qui savent reconnaître, à quelques détails imperceptibles, l'effigie effacée par le Temps. Il importerait enfin de se rendre à cette évidence: plus on s'éloigne de l'origine et plus on vieillit. L'accélération propre au monde moderne est le signe de sa décrépitude. La véritable juvénilité se reconnaît à l'immensité de ses temporalités contemplatives. C'est le monde ancien qui est jeune et vieux le monde nouveau, et jamais nous n'atteindrons les secrets alchimiques du recommencement si nous oublions l'art d'être fidèle à l'antérieur.

L'œuvre de Henry Montaigu, disions-nous, est œuvre de combat, et l'on commence sans doute à entrevoir quelles sont, dans l'ordre politique et historique, les modalités de ce combat, mais cette œuvre n'en est pas moins œuvre de prière. Chacun des livres que l'auteur dispose à l'attention du lecteur est une Heure hantée d'aurores et de crépuscules sans fin où l'Ange d'entre les mondes nous adresse quelque signe de bienvenue. Prière issue de la Foi, et annonciatrice de Sapience. Toujours dans son article sur l'inspiration occitanienne, Simone Weil écrit: « Nous ne pouvons pas savoir s'il y aurait eu une science romane. En ce cas, sans doute, elle aurait été à la nôtre ce qu'est le chant grégorien à Wagner. Les Grecs, chez qui ce que nous appelons notre science est né, la regardaient comme issue d'une révélation divine et destinée à conduire l'âme vers la contemplation de Dieu. Elle s'est écartée de cette destination, non par excès mais par insuffisance d'esprit scientifique, d'exactitude et de rigueur... La science n'a pas d'autre objet que l'action du Verbe, ou, comme disaient les grecs, l'amour ordonnateur. Elle seule, et seulement dans sa plus pure rigueur, peut donner un contenu précis à la notion de Providence, et dans le domaine de la connaissance elle ne peut rien d'autre. Comme l'art, elle a pour objet la beauté. La beauté romane aurait pu resplendir aussi dans la science. »
Cette science romane dont Simone Weil déplore l'absence, nous en discernons les prémisses dans l'œuvre de Henry Montaigu. Rien désormais, ne saurait nous interdire d'en propager l'embrasement salutaire à d'autres aspects de la connaissance dont nous trouvons ici la source lumineuse de renouvellement. Au cœur de l'espace géo-symbolique réside la miséricordieuse puissance dorique du rayonnement primordial. Ce sont là des choses que l'on éprouve. « Il y a, écrit Henry Montaigu, un air de Toulouse, incomparable et puissant, que la mémoire nourrit pourtant d'histoires atroces et de fables étranges, mais qui demeure joyeux et léger comme si la certitude d'être l'emportait sur les trahisons du destin et la lourde banalisation de la cité moderne. » Cette allégresse, cette vivacité heureuse, cet élan lancé à sa propre conquête dans la spirale de son essor est sans doute de tous les mystères celui nous importe le plus car il nous engage dans le secret même de l'immatérialité, que la Tradition nomme le monde subtil: « Comme toute ville essentielle, écrit Henry Montaigu, le secret de Toulouse se situe au-delà d'un espace mesurable et d'une quelconque chronologie. Non sans doute qu'il ne s'y incarne,- mais c'est l'être intérieur qui plus qu'ailleurs ici façonne tout. »
Reconnaître en toute chose l'être subtil qui le façonne, tel pourrait être le privilège de la science romane. Les choses telles qu'elles apparaissent sont littéralement façonnées par le Ciel. Elles obéissent à l'ordonnance hautaine des nues. Celui qui marche dans la Ville marche dans le ciel. Le tracé de son cheminement, s'il s'accomplit avec ferveur, rétablit là-haut le sens des figures célestes, en réveille les pouvoirs endormis ou oubliés. La confusion et le chaos qui, dans l'ordre humain, se confondent avec la médiocrité, ne désarment jamais. C’est pourquoi toute œuvre d'art, véritablement civilisatrice, est aussi le signe commémoratif d'une victoire contre les puissances des ténèbres.

Contre la conformité de l'informe, l'Idée, c'est-à-dire au sens grec, la Forme, est la citadelle. Telle est exactement l'intelligence romane, où, ce qu'il y eut de plus mystérieux et de plus léger dans l'esprit grec s'épanouit dans l'esprit français, où le privilège immémorial de la franchise reconnaît le juste équilibre de l'obéissance et de la liberté. Ce juste équilibre, la doctrine le dit mais l'Art le prouve. Dans la perspective traditionnelle la vie est par définition un art car la liberté créatrice ne s'accomplit qu'à travers la plus rigoureuse des disciplines. La veulerie est ennemie du Beau, mais aussi du Vrai et du Bien: « Tout ce qui procède d'un véritable caractère traditionnel, écrit Henry Montaigu, est enceint, délimité, déterminé. La double action du Centre vers l'extérieur (dynamisme psychique et rayonnement spirituel) exerce une influence proportionnelle à la régularité de ses dispositions. Une muraille n'est pas d'abord un ouvrage défensif, mais un symbole, ce que prouve le fait qu'il a pu être réduit à un simple muret de pierre. Il est avant tout conçu comme une garde contre les invisibles légions de l'ombre. Une fois abritée par un rituel en quelque sorte projeté dans l'espace sous la forme d'un appareil défensif adéquat aux normes reçues par la tradition, la cité humaine, reflet de la cité céleste ou "centre des centres" après avoir aspiré les forces et les énergies, les dirige, une fois maîtrisées, à travers le chaos du monde, vers des points très précis qui situent la géographie terrestre comme image de la géographie stellaire. » Or, la ville de Toulouse active, pour ainsi dire, ces principes traditionnels avec une intensité particulière: « La grande croix solaire des comtes de Toulouse, ajoute Henry Montaigu, tracée sur le sol de la place moderne du Capitole, marque le milieu idéal de la Ville et exprime que cette Ville elle-même est le milieu d'un monde. Le signe héraldique duodénaire possède évidemment un caractère zodiacal et manifeste tous les rapports d'harmonie entre le lieu, ses constructions, et sa place dans l'univers. »
Le Symbole, dans la perspective de cette science romane dont l'œuvre de Henry Montaigu annonce la renaissance, est véritablement le « miroir de la connaissance ». Le symbole étant l'instrument de la métaphysique, il s'avère impossible de comprendre sa fonction dans un système de pensée qui exclut, de façon explicite ou implicite, la métaphysique. La prétention du matérialiste à traiter du Symbole n'a d'égale que celle du fat qui, tout en niant l'existence de la musique voudrait cependant nous informer de la fonction véritable du clavecin ou encore de celle du fou qui, tout en niant la réalité du reflet, s'acharnerait à imposer sa conviction quant à la nature réelle du miroir. On pourrait ainsi définir la science romane, qu'illustre cette approche du mystère de Toulouse, comme une science de l'interprétation infinie des aspects du visible,- interprétation à la fois mathématique, pythagoricienne, et musicale dont nous reconnaissons les lois, par exemple dans le cloître des Jacobins. Mais le livre de Henry Montaigu va encore au-delà, dans les régions plus subtiles du pressentiment où le Symbole nous délivre le message de notre prédestination ultime. « Toulouse, à cet égard, écrit Henry Montaigu, est une cité sanctuaire, où il n'est rien qui ne témoigne de la profonde mesure, divine et humaine, du Nombre d'Or. »

Au moment où tout nous abandonne, où les ténèbres se font, où « démocratiquement » s'installe le pire despotisme qui soit, celui du Médiocre, nous pouvons nous retrouver dans la ville sanctuaire, ou dans le souvenir que nous avons d'elle, pour nous recueillir, nous rendre attentif à ce cœur des mondes qui brille dans les hauteurs vertigineuses. Les pires profanations de l'Age Noir ne peuvent rien contre la forme invisible d'une ville qui est elle-même la réverbération sacrée d'une autre et plus lumineuse invisibilité: « L'axe de la grande Rue, écrit Henry Montaigu, qui part de la place et du quartier Saint-Michel, au Sud, passe par la porte Narbonnaise pour aboutir à la Place du Capitole, se transforme alors en trident régulier. La voie médiane, que commande le pivot de la vieille église du Taur, trouve en Saint-Sernin son lieu sacré, et, en quelque sorte son Nord idéal. Il y a là une référence certaine à la quête du dieu transcendant, à la Tradition Primordiale, à ce royaume de la connaissance antérieure que les grecs identifiaient avec l'Hyperborée, il ne serait pas alors impossible de voir en Toulouse une Thulée méridionale. » Refuge des héros et des clartés de l'extrême limite, nuit lumineuse: il faut s'être aventuré jusqu'à certaines orées de l'entendement pour comprendre la justesse de l'Analogie entre Toulouse et Thulé.
Sans doute la science romane est-elle véritablement la voie royale, car ce qu'elle annonce légitime l'intuition poétique la plus intense. L'intensité de la beauté échappe à toute considération esthétique: elle nous comble de pure bonté et de vérité pure. Le langage du Symbole est une oraison. Le malaise que suscitent les villes modernes, arbitraires, dont l'existence n'est déterminée que par la seule utilité immanente, montre assez le discord qui persiste entre la nature humaine et l'idéologie moderniste. Nous ne sommes pas ce que les théories de la modernité voudraient que nous fussions. Nous nous obstinons à souffrir de la laideur alors même que le sens de la beauté nous échappe. « La ville moderne, écrit Henry Montaigu, est sans mandat et sans histoire: Elle n'est en fait qu'une anti-construction. Conçue pour le citoyen matriculé et non pour l'homme, il lui est tout aussi impossible de vieillir dignement que de se renouveler.» Décentrée, elle ne peut affirmer son existence que par une surenchère titanique. Le colossal se substitue à l'harmonieux. Ecrasants sont les gratte-ciel et le mauvais goût architectural des dictatures populaires. Tout, au contraire, dans l'architecture romane,- qui est, à qui sait voir, une pure méditation sur le Centre,- nous convie à la légèreté, à l'envol : « Et qu'est-ce qu'une Capitale, écrit Henry Montaigu, sinon tout d'abord un Centre, c'est-à-dire un nœud vital et sensible où les forces telluriques et les forces célestes opèrent une fonction qui, en principe, est sans repentance pour toute la durée d'un cycle ? »

Le Centre est à la fois ce qui est en nous et au cœur du Ciel. Ce foyer ardent est le passage entre les mondes. Alors que la science titanesque ne connaît d'accomplissement que dans le règne de la quantité, du déterminisme et de l'asservissement à la chronologie, la science romane suit la voie royale de l'ascendance des Symboles vers leur source première. Il n'est rien de moins vague ni de moins hasardeux. Science, la science romane l'est de plein droit. Si la ferveur mystique est comme son émanation dans le sentiment humain, la science romane n'en demeure pas moins une mathématique de la connaissance, un art de l'exactitude qui ne s'improvise en aucune façon et dont les résultats, sans jamais prétendre à quelque interprétation définitive, n'en sont pas moins décisifs dans l'ordre intérieur comme dans l'ordre extérieur, dans l'ordre du spirituel comme dans l'ordre du politique.
La « grande politique » dont rêvait Nietzsche,- et que les nietzschéens sont bien les derniers à concevoir- sans doute est-ce dans cette science romane que nous en trouverons les prémisses. Les choses, en politique, ne sont pas aussi désespérantes que certains voudraient nous le faire croire: il suffit pour s'en convaincre d'observer cette loi des cycles dont la logique du Centre désigne l'essor, en forme de spirale ascendante. C'est ainsi que le cœur des ténèbres indique le site providentiel de l'embrasement royal des aurores. En toute nuit gît le germe du secret de l'aurora consurgens. L'ultime divulgue le secret du Principe. L'ultime Thulé nous divulgue le sens de la prime clarté. C'est au moment où les œuvres les plus belles sont menacées de disparaître dans leur réalité sensible que les arcanes de leur Forme s'offrent dans leur plénitude à l'intelligence de quelques-uns. C'est à ces rares heureux que s'adresse l'œuvre de Henry Montaigu. Miroir de l'Art, la science romane sera aux meilleurs d'entre nous une mise en demeure à nous reconnaître nous-mêmes, non certes dans la mesure d'une quelconque analyse narcissique du moi, mais dans la contemplation de ce qui nous entoure, nous dépasse de toutes parts et nous demeure inconnaissable, comme une incitation permanente, comme une herméneutique sans fin. L'inconnaissable, selon la science des titans qui proclame qu'il n'y a rien à connaître, est d'une toute autre nature. Il nous installe dans l'insolite, alors que l'inconnaissable dans la science romane nous environne d'ombres et de clartés mouvantes qui ne sont autres que les manifestations du Merveilleux.

La déambulation dans Toulouse à laquelle nous invite Henry Montaigu peut ainsi se déchiffrer comme un enseignement du Merveilleux que tout, en ce monde moderne et profanateur, conspire à nous laisser méconnaître. Retrouvailles ensoleillées et fleuries,- avec l'approche du Sens de toute chose à travers l'ordonnance des rues et leurs parcours dans l'invisible cité pythagoricienne dont Toulouse est la réverbération sensible,- le Merveilleux sacre l'instant où il advient, en révèle l'héraldique éternelle, car l'Instant est ce qui se tient, immobile, comme une île dans la mouvance des eaux. Ainsi, mieux qu'un magistral ouvrage sur l'histoire et les Symboles de nos cités, l’œuvre de Henry Montaigu apparaît comme une méditation sur le Centre, sur le Pôle lumineux de l'être, sa primordialité métaphysique sans laquelle la Tradition se réduit à son propre simulacre, sous les espèces des coutumes, convenances, et des « valeurs ». Primordiale, la Tradition se situe en amont des temps et du monde immanent lui-même. Le mot de métaphysique, trop souvent galvaudé, reprend ici sa pleine signification. La Tradition est primordiale et métaphysique car elle est issue du Centre qui est à la fois le centre de l'entendement et le centre du monde. Le lecteur est ainsi invité directement à l'expérience du suprasensible, dont seuls les Symboles et les mythes détiennent la clef, et par lesquels nous pouvons comprendre, par exemple, que l'Art et la nature sont une seule et même chose.
La nature n'est pas supérieure, ni même antérieure à l'Art: « Les Symboles et les mythes, écrit René Guénon, n'ont jamais eu pour rôle de représenter le mouvement des astres, mais la vérité est qu'on y trouve souvent des figures inspirées de celui-ci et destinées à expliquer analogiquement tout autre chose, parce que les lois de ce mouvement traduisent physiquement les principes métaphysiques dont elles dépendent. » A l'origine de l'Art comme de la nature sont les principes métaphysiques. L'accord magnifique de Toulouse et de sa Garonne témoigne de cette unité supérieure, de cette concordance avec l'ordre divin. « Dans la nature, écrit encore René Guénon, le sensible peut symboliser le suprasensible; l'ordre naturel tout entier peut, à son tour, être un symbole de l'ordre divin; et d'autre part, si l'on considère plus particulièrement l'homme, n'est-il pas légitime de dire que lui-aussi est un symbole par là même qu'il s'est créé à l'image de Dieu ? »

A cette question fondamentale de la science romane répondent les œuvres, car les œuvres sont des prières,- au même titre que les prières qui retentissent dans les tréfonds du cœur sont des œuvres au-delà de toutes nos espérances. Telles sont les promesses propres à la découverte de l'espace « géo-symbolique ». Lorsque la vision du poète rejoint l'exactitude de l'historien, toutes les espérances revivent, de celles qui nous portent en avant vers cette gloire première qui n'est autre que la victoire sur l'oubli que les grecs nommaient du beau nom d'anamnésis, la divine « ressouvenance ». Et tel est bien le sens du combat, car la menace n'est autre que cette amnésie dont les temps modernes plombent les entendements de telle sorte que nul rayon ne traverse plus les consciences et les âmes. « Toulouse, écrit Henry Montaigu, qui a l'amabilité chaude et noble des grandes créations de type solaire semble devoir mériter au plus haut degré ce vocable de "ville rose" qui serait à la lettre bien fade s'il s'agissait seulement de couleur et de fleur. A aucune autre ville de brique, il n'a été accordé ce surnom. C'est qu'aucune autre n'est aussi parfaitement conçue en mode rayonnant,- c'est qu'aucune autre n'a manifesté, sous tant d'apparences diverses, le culte mystique de la Dame. » L'exactitude du style et de la pensée n'a pas, dans l'œuvre de Henry Montaigu, pour objet de s'admirer elle-même: elle annonce, comme nous le disions aux premières lignes, un combat, mieux encore elle donne au Noble Voyageur, assez vif pour s'en saisir, un arme de noble facture. Si chaque phrase dispose de la promptitude d'une répartie, de l'éclat d'une passe d'arme, ce n'est pas en vain. Les enjeux sont la mémoire et l'Eveil.
Dans les temps uniformisateurs et charlatanesques que nous vivons où le seul salut consiste à fuir ceux qui voudraient nous donner quelque directive spirituelle, les villes demeurent en dépit de certaines atteintes beaucoup plus malignement délibérées que l'on veut bien le croire, des espaces où la tradition a disposée en notre faveur des passages entre les mondes et les différents états de l'être. L'ordonnance des rues, des édifices, en correspondance avec la géographie elle-même, obéissent à une mathématique sacrée, incitent le promeneur attentif à certains parcours, déterminent des variations dans l'entendement selon le mouvement du jour: toutes circonstances heureuses qui nous donnent accès à la transcendance. L'initiation,- c'est-à-dire la renaissance de l'entendement par la vertu infuse dans le Ciel !- est toujours plus proche qu'il ne semble. Ceux-là qui passent avec mépris sans rien voir dans leur propre ville, qui considèrent avec dégoût leur patrimoine poétique et mystique, vont s'agglutiner ensuite autour de fumeux gourous exotiques pour ânonner quelques formules incompréhensibles, pratiquer quelques mouvements gymniques et confondre leur grand vide existentiel avec l'impérieuse vacuité bouddhique ! Tout semble bon pour nous arracher à nous-mêmes, c'est-à-dire à arracher la France de nos âmes ! Les « techniques » de « spiritualité » marchande et les « spiritualités » de la Technique se partagent la tâche qui laissera nos âmes dans l'oubli de notre tradition, à la merci des plus arrogantes puissances. Puissances titaniques, car loin de s'exercer en œuvres de beauté, la seule preuve qu'elles donnent de leur empire sont des moyens de destruction et d'asservissement. Toutes les œuvres de Henry Montaigu, romans, essais historiques et symboliques, sont traversées par cette inquiétude salvatrice, cette amitié intellectuelle, ce goût aristocratique,- qui donnent à la tradition française une légitimité métaphysique à laquelle il est fort peu probable qu'un autre pays puisse aujourd'hui prétendre. Mise en demeure adressée à quelques-uns, l'œuvre de Henry Montaigu donne bien davantage qu'elle ne réclame, car ce qu'elle exige de nous est d'être simplement le récipiendaire de l'ordre immémorial du Don par excellence que nous recevons d'elle: c'est aller à l'aventure, mais non point au hasard, dans tel site particulier de notre Pays où les lignes de force de l'Autre monde et de ce monde œuvrent au même tracé de lumière.

« La fonction de toute légende, écrit Henry Montaigu, est de véhiculer une connaissance dont l'origine historique importe peu. » Il est donc juste de rendre sa précellence à la poésie. Et qu'est-elle cette poésie, à travers ces rêves et ces ivresses dont elle environne ses advenues, sinon l'alliance même par laquelle toute civilisation se fonde ? L'ivresse de la reconnaissance amoureuse de l'Heure, choisie entre toutes par les plus hautes vertus de Ciel, et le Rêve magnifique des pierres accordées à l'Idée ! Telle fut sans doute la forme immatérielle aperçue, par les Architectes, en leurs méditations théologiques et platoniciennes. Dans la déroute généralisée de l'Age Noir qui est le nôtre, il est vain de s'attarder à des coutumes, des institutions ou des convenances. Nous avons de la Tradition une idée trop haute pour l'associer à ces écorces mortes. Le contraire de la révolution n'est pas la contre-révolution mais, peut-être ces libertés conquises à l'égard de l'aspect sinistrement moralisateur de toutes les idéologies dont il importe peu, au regard de leurs conséquences également funestes, qu'elles fussent d'origine progressiste ou réactionnaire. Aux villes, quand bien même leur message est voilé, revient ce privilège d'être les ambassadrices de la pensée la plus libre des emprises de la modernité. Peu importe que les lieux soient enlaidis ou profanés: un substrat invisible demeure, comme immobilisé dans l'air et que la pensée méditante retrouve.
Car il existe des chemins d'air qui conduisent hors du Temps. Certaines de ces voies d'accès sont clairement indiquées au lecteur de l'œuvre de Henry Montaigu. Elles nous portent jusqu'à d'autres seuils qui nous invitent à la grande découverte gnostique de l’« au-delà de l'air » qu’évoque l’Epître d’Aristée, où le monde devient soudain pure transparition. « Dès que l'on connaît, écrit Jean Giono, les pertuis intérieurs de l'air, on peut s'éloigner à son gré de son temps et de ses soucis. Il ne reste plus qu'à choisir les sons, les couleurs, les odeurs qui donnent à l'air le perméable, la transparence nécessaire qui font dilater les pores du temps et on entre dans le temps comme une huile. »
A celui qui s'est approché des « pertuis intérieurs de l'air », l’œuvre de Henry Montaigu apparaîtra comme la cartographie subtile de ces espaces impondérables et royaux d'où l'âme, en se reconnaissant elle-même dans son propre élément, rayonne avec une alchimique intensité d'or. Car les pertuis secrets nous révèlent que nous sommes sortis des faux-semblants pour entrer dans la Présence divine: « Tout ce qui touchait les au-delà de l'air, écrit encore Jean Giono, je m'en sentais intimement amoureux comme d'un pays jadis habité et bien-aimé dont j'étais exilé mais vivant encore tout entier en moi, avec ses lacis de chemins, ses grands fleuves étendus à plat sur la terre comme des arbres aux longs rameaux et le moutonnement houleux d'écumantes collines où je connaissais tous les sillages... »

Dans la perspective traditionnelle, nous l'avons vu, la nature et l'Art participent d'un même hommage à l'Idée divine. Le pays « jadis habité et bien aimé » et qui vit tout entier en nous, dans son harmonie vivante, appartient de droit à ce monde intérieur qui, faut-il préciser, n'a rien de subjectif. L'homme moderne seul, qui divise tout, est parvenu à faire de l'œuvre de l'homme l'ennemie de l’œuvre de Dieu, saccageant ainsi l'une et l'autre par démesure et soumission exclusive au règne des titans. « Le monde, écrit Henry Montaigu, est une architecture. Toute disposition humaine doit être le reflet précis, exact, rigoureux de l'architecture cosmique. Tout a été établi en poids, en nombre et en mesure, dit la Bible. Pendant des millénaires, et aussi loin que porte la mémoire humaine, ces poids, ces nombres et ces mesures ont été transmis par le sacerdoce et manifestés dans le visible par des temples, des palais, et des villes sous le regard médiateur de la royauté constructrice, afin de créer des ponts, des perspectives tangibles, des identités immédiates entre la terre et le ciel, entre l'architecture divine et les maisons construites par les hommes. » Or, ajoute Henry Montaigu, telle est la profonde misère des temps modernes : « l'Idéologue s'est substitué à l'Architecte, seulement voilà: les monuments de l'Architecte sont toujours debout (seraient-ils en ruine) et gardent toute leur lisibilité sapientielle. Les productions de l'Idéologue, qui n'ont pour elles que le gigantisme des civilisations sur le déclin, se perdent dans confusion d'un univers sans structures que seule détermine la loi du nombre, au besoin contre la dignité humaine,- et dont la seule lisibilité est leur accord avec la grande massification. » Entre l'Architecte et l'Idéologue nul compromis n'est imaginable, l'Idéologue n'existant que par la destruction de l'œuvre architecturale. Face à l'outrance et au gigantisme de l'idéologue, le parti de l'Architecte est de résister au cœur invisible de ce qui perdure, envers et contre toutes les destructions matérielles. Déchiffrer le Sens, faire de son intellect le bruissement d'une herméneutique infinie, telle est la Sapience, qui est la raison d'être, le soleil de raison, de toute véritable chevalerie spirituelle.
Dans le déchiffrement,- qui obéit aux lois d'une mathématique pythagoricienne et romane, l'intelligence s'épanouit en une pensée méditante où les rues deviennent fleuves et ruisseaux, de même que les arbres et les avenues deviennent avenues et chapelles. Dans le dénombrement, qui connaît son paroxysme idéologique dans le suffrage universel, l'intelligence au contraire se démet au profit d'une logique de pure comptabilisation L'Architecte médite les rapports et les proportions de toute chose selon les principes de l'interdépendance universelle, alors que l'Idéologue comptabilise les hommes comme autant d'unités interchangeables, également au service d'une puissance qui, dans son gigantisme, ne peut se traduire qu'en de toujours plus vastes destructions. Or, ce ne sont pas des tempéraments faustiens, d'exception, qui réalisent la démesure titanesque mais les forces quantitatives des Médiocres coalisés. Celui qui compte les secondes à des fins utilitaires en accélère le cours par l'uniformité même que brutalement il leur impose,- alors qu'en vérité, en en beauté, chaque seconde est d'éternité rayonnante « dans les pertuis de l'air » ! Contre le despotisme titanique du dénombrement, notre ultime recours est l'art de l'interprétation infinie, du déchiffrement, que nous offre la mise-en-miroir du Livre et du Monde : « Au milieu de l'agonie du langage, écrit Henry Montaigu, où toute perspective intellectuelle est vouée à l'improbable parce qu'elle se trouve bafouée, dérivée et finalement détruite par son propre développement, comment retrouver le langage de l'architecture, comment retrouver l'Evidence enfouie par le moyen de son propre regard, de notre conscience éveillée, brusquement tirée d'un torrentiel charroi d'images et de mots, comment retrouver une science infiniment perdue: la lecture ? »
Dernier livre paru de Luc-Olivier d'Algange: L'Ame secrète de l'Europe, Oeuvres, mythologies, cités emblématiques, éditions de L'Harmattan, collection Théoria.
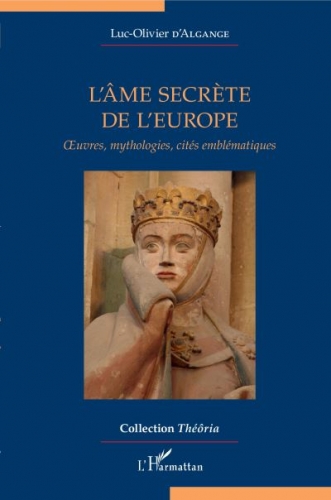
16:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : toulouse, occitanie, luc-olivier d'algange, lettres, lettres françaises, littérature française, henry montaigu |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
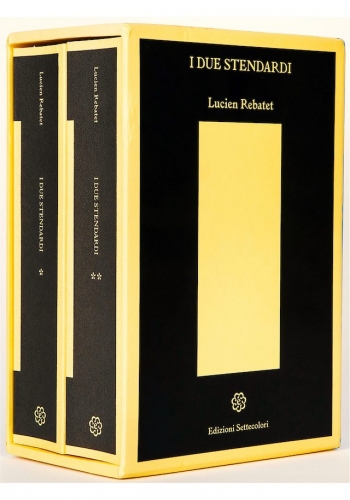
Les deux étendards, l'amour entre paganisme et christianisme
A propos de l'édition italienne des Deux Etendards de Lucien Rebatet
par Manlio Triggiani
Les Edizioni Settecolori publient un classique de la littérature française de Lucien Rebatet : il manquait en traduction italienne. Un projet qui dure depuis vingt ans...
SOURCE : https://www.barbadillo.it/102539-segnalibro-i-due-stendardi-amore-fra-paganesimo-e-cristianesimo/
Situé dans les années 1920 mais écrit entre 1943 et 1949, Les Deux Etendards est le livre culte de Lucien Rebatet. Son style, son écriture et ses thèmes montrent que l'écrivain français était un enfant de la modernité et qu'il en a représenté les sentiments et les idées de manière complète et bien ficelée. Amateur des nouveaux mouvements culturels de l'époque, du futurisme au surréalisme et au dadaïsme, il est avant tout attiré par l'expérimentation en cours dans les différents arts. Les deux étendards représente, de manièrequais plastique, le roman traditionnel, avec une structure solide pleine de références à Dostoievsky, Balzac et Stendhal mélangées à un lexique très moderne. Un roman qui se déroule sur plusieurs niveaux, offrant différentes lectures du récit, avec des registres toujours changeants autour d'un pôle narratif : la dynamique d'un triangle amoureux entre deux jeunes amis, Régis et Michel, qui aiment tous deux Anne-Marie, dix-huit ans. Michel, de Paris, est un nietzschéen, un païen ; Régis, de Lyon, aspire à être accepté dans la Compagnie de Jésus pour satisfaire son penchant mystique et spirituel. Anne-Marie est belle, séduisante, mais plus intéressée par son propre sexe que par le sexe masculin. Elle voit en Régis, un disciple de saint Ignace de Loyola, l'homme qui a peut-être trouvé le moyen de sortir de la préoccupation de la sexualité qu'elle connaît déjà. Dans cette histoire, l'issue du triangle non résolu est un entrelacement de pulsions, d'émotions, de passions, d'obsessions et le livre montre une vue en perspective de l'être et des sentiments des trois garçons. Un sondage, un approfondissement continu qui donne à la vision de ce triangle plus de clarté et plus de couleur si l'on considère que ce livre est - aussi - un hymne à la jeunesse. Un âge difficile mais aussi un âge où tout semble possible et éternel, où les sentiments tels que l'amitié et l'amour, mais aussi les choix et les aspirations, sont totaux.

Un roman des sentiments
Un roman de sentiments, de pulsions, donc, avec la jeunesse en son centre, mais, comme le souligne efficacement Stenio Solinas dans la préface, également un roman d'idéologie ou - mieux - de visions du monde opposées : le catholicisme d'un côté, le paganisme de l'autre, le Christ d'un côté, Dionysos de l'autre, le mysticisme d'un côté et la vie avec ses plaisirs et ses peines de l'autre.
Entre-temps, Rebatet, qui est né en 1903, a vécu ses années de maturité dans un climat de conflit social et, surtout, il les a vécu en pleine guerre. Il a vécu et décrit, dans des articles et des livres, la défaite de la France et analysé la décadence du peuple français, avec la grandeur raillée, et a fait son propre choix politique, à une époque où les intellectuels manifestaient résolument leur engagement.
Rebatet a choisi le fascisme et a écrit des articles et des pamphlets violents en termes non équivoques. Il s'agissait d'une décision pour "racheter sa patrie, victime de la décadence". Après l'occupation allemande, il a été emprisonné pour avoir rejoint le fascisme et pour collaborationnisme. Ses écrits ont pesé lourd dans la décision du jury de le condamner à mort. Dans sa cellule, en attendant son exécution, il luttait contre le temps, jour après jour, pour écrire et réviser Les deux étendards, sur lequel il travaillait depuis 1943. Au début, il l'a intitulé Ni Dieu ni le diable. Après quelques mois, la peine de mort est commuée en prison à vie et l'écrivain travaille à ce roman jusqu'en 1949, date à laquelle le manuscrit est remis à l'éditeur Gallimard. Il a été publié en 1951.
Peu de temps après, Rebatet a été gracié et libéré de prison grâce à la pression de l'intelligentsia française. L'histoire de la récente publication italienne de ce livre a été troublée, ce qu'explique Stenio Solinas dans la préface, avec affection.
Le rêve de Pino Grillo devient réalité
C'est le livre que le directeur de la maison d'édition Settecolori, Pino Grillo, voulait publier, mais diverses vicissitudes et complications se sont rapidement accumulées jusqu'à ce qu'une maladie emporte ce digne et généreux éditeur. Son rêve de traduire les Deux Etendards semblait s'être envolé pour de bon. Vingt ans plus tard, son fils Manuel, avec courage, n'a pas abandonné ce rêve et, relançant la maison d'édition avec quelques amis, a mené à bien ce projet. Parfois, les "histoires parallèles", même si elles sont difficiles et troublées, donnent un sens à l'existence et aux œuvres de ceux qui restent.
Manlio Triggiani
Lucien Rebatet, I due standardi, Edizioni Settecolori, (introduction de Stenio Solinas, traduction de Marco Settimini), 2 vol. pp. 700 et 728 ; euro 48. Les volumes peuvent être achetés directement auprès de la maison d'édition dirigée par Manuel Grillo.
14:14 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucien rebatet, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par Luc-Olivier d'Algange
« Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes ; mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul »
Arthur Rimbaud
De toutes les témérités, la témérité spirituelle est la plus rare. Sa rareté la hausse désormais au rang de nécessité. Nous avons faim et soif de ce qui est rare. Dans l’équilibre du noble et de l’ignoble, dans l’harmonie des ombres et des lumières, des mélodies et des timbres de l’entendement humain, l’absence absolue de témérité spirituelle équivaut à une extinction massive des pouvoirs de l’intelligence. Le téméraire n’exige point qu’on le suive. Son amour-propre se satisfait d’avoir été « en avant », comme la poésie rimbaldienne. « La poésie ne rythmera plus l’action, elle sera en avant ». En avant, c’est-à-dire aussi au-devant des insultes, des médisances, des crachats. Ainsi que l’écrivait Ernst Jünger : « On ne peut empêcher un homme de vous cracher au visage, mais on peut l’empêcher de vous mettre la main sur l’épaule. » Ainsi commence la témérité spirituelle : elle éloigne les sympathies condescendantes, les tutoiements de porcherie, les petits signes de connivence que les médiocres s’adressent entre eux et auxquels il faut répondre sous peine d’être le bouc émissaire de toutes les lâchetés collectives. La témérité spirituelle est une tournure d’esprit. Elle tient autant du caractère que de l’intelligence. Pour le spirituel téméraire, l’intelligence et le caractère sont indissociables. Les grands caractères deviennent intelligents par la force des choses ; que serait une intelligence sans caractère sinon un leurre ? Comment exercer son intelligence des êtres et des choses sans caractère ?
L’intelligence périclite à défaut d’exercices. Si nous nous aventurons en quelques pages à esquisser un éloge de la témérité spirituelle, le moins que nous puissions faire sera de nous livrer à des exercices de témérité, en formulant quelques-uns de nos désaccords avec l’immense majorité de nos contemporains. Est-ce là une déplaisante prétention à l’intelligence ? Soit ! Donnons déjà à l’adversaire cet argument, dont sans doute il surestimera le poids. La véritable témérité spirituelle est si humble et si peu vaniteuse qu’elle peut sans crainte s’avancer au milieu des huées qui la disent orgueilleuse selon l’immémoriale parabole de la paille et de la poutre. Le téméraire en esprit n’a pas même besoin de se demander ce qu’il ne faut pas dire pour le dire. L’hérésie contre la bien-pensance fleurit naturellement dans son jardin. Certes, il ne faut point être « élitiste », feignons donc de l’être, mais comme par inadvertance. D’ailleurs, comment pourrions-nous être élitistes si nous sommes l’élite ? Un Roi, s’il règne, n’a guère besoin de se dire royaliste. La témérité spirituelle serait ainsi un mouvement de la pensée qui fait l’économie de la redondance, un mouvement qui va droit au but qu’il se fixe, même dans la nuit noire, comme la flèche des archets que manient les moines- guerriers du bouddhisme zen.

C’est assez dire que le téméraire en esprit n’est point entièrement ignorant de l’art de la guerre. Comme aux échecs, il est bon de temps à autre, ainsi que le suggérait Marcel Duchamp, de lancer une attaque audacieuse, et presque incompréhensible à soi-même, pour désarçonner l’adversaire, surtout lorsque celui-ci se trouve en bien meilleure position que nous. Rien ne sert de jouer en défensive lorsque les pièces de l’adversaire ont déjà conquis notre terrain. Il existe ainsi de presque imparables coups de force de l’intelligence. Un Non franc et massif aux ignominies du temps, un refus sans ambages peuvent être le cheval de Troie d’une approbation ultérieure.
Notre époque est celle des cléricaricatures. En toute chose elle pose la marque infâme d’un sacerdotal parodique, d’une religiosité du néant, d’un ritualisme confiné aux aspects les plus dérisoires et les plus mesquins de l’existence. Tout, dans le monde moderne, est devenu « grand-messe » : le caritatif spectaculaire, les expositions auto-mobiles, n’importe quoi. Les psychanalystes pratiquent des confessions stipendiées, les chanteurs de variété s’entourent de flammèches tremblantes dans l’obscurité des salles de spectacle comme les Saints dans les Églises, lorsque les Églises s’ornent de banderoles publicitaires vert salade ou rose bonbon, sans doute pour donner à leurs architectures vénérables, mais anciennes, le ton moderne des supermarchés. Les hommes de ces temps relatifs ne cessent de communier, mais dans le lâche et le ridicule et sont parvenus à cette fin que les théocrates ne se proposaient point : la disparition de tout esprit critique.
La cléricature des Modernes n’a nul besoin de Sommes théologiques, d’arguments ou de contre-arguments, de démonstrations de l’existence de Dieu, puisque l’esprit critique auquel s’adressaient ces œuvres de Foi et de Sapience a disparu. Dévote d’elle-même, contre toute bonne foi et toute raison, la modernité s’adore sans arguments ni retenue avec cette indécence vertueuse et puritaine qui lui est propre. Grenouilles de bénitiers, mais pratiquant exclusivement dans l’ersatz, nos intellectuels modernes « consensuels » eurent ainsi le mérite insigne de nous redonner le goût de nier, d’exalter en nous de munificentes négations. À charge de revanche, nous ne témoignerons jamais assez de gratitude à ces béni-oui-oui de nous avoir redonnés ce sens juvénile du Non qui scelle en lui, comme un secret admirablement gardé, un Grand Midi d’affirmations souveraines !

Cette belle époque libérale, tolérante, individualiste et « démocratique » tolère tout, sauf la vérité, laissant, par voie de conséquence, la vérité qu’ils insultent et bafouent sauve de leurs atteintes, secrète comme la lettre volée d’Edgar Poe, dissimulée par excellence d’être exposée à vue de tous. Les niaiseries les plus abominables, les considérations les plus mesquines et les plus perverses sont tolérées sous la condition qu’elles n’engagent que l’individu qui les formule. Les auteurs seraient ainsi conviés aux grandes fêtes d’une subjectivité enfin libérée des « formes », des Idées platoniciennes et des Principes théologiques. Dégagées des hiérarchies, des styles et des autorités anciennes, l’individu serait appelé à manifester son « originalité » et son « droit à la différence »... Le problème, c’est que de l’originalité, on n’en voit guère. Avec la disparition des formes anciennes, c’est bien l’informe qui règne, ce comble de l’uniformité. Rien n’est plus uniforme que l’informe. Et les cléricaricatures modernes sont là pour en être les garde-chiourmes obtus et féroces.
La technique n’est jamais que l’expression d’un vœu secret, d’un agir, dirait Heidegger, dont l’essence n’a pas été interrogée. Ainsi le clonage physique succède à un clonage mental déjà réalisé. Il est vain comme le font les « comités d’éthique » – fétus de pailles édictant des règles à l’ouragan ! – de vouloir contester à la Technique son évident pouvoir de planification et de contrôle, comme sont vains, et d’une vanité sans borne, ces adeptes du Démos qui prétendent s’opposer aux dictatures qui, sans le règne du Démos dont elles sont issues, seraient restés de sombres et absurdes fantasmagories emprisonnées en des subjectivités heureusement jugulées. L’histoire intellectuelle de ces dernières décennies a été faite et refaite, c’est-à-dire grugée entièrement par ces imbéciles, parfois d’une odieuse componction, souvent dégoulinants de bons sentiments et de « révoltes » tarifées. Jamais la charité ne fut aussi profanée qu’en ces temps qui ont vu l’interdiction théorique de la vérité.
Que disent nos lieux communs de la vérité ? « Chacun a la sienne » car, bien sûr, « tout est relatif ». L’uniformisation ayant fait en sorte que cette non-vérité de chacun soit, par surcroît, dans le grégarisme triomphant, la même que celle du voisin, le seul scandale, le seul interdit, la seule hérésie porte sur la vérité, et, par voie de conséquence, sur la beauté où elle resplendit. L’étalage du laid, du vulgaire et de l’ignoble est devenu si général qu’il ne suscite plus même le dégoût ou l’horreur. Que cette laideur fût le véhicule du mensonge, nul ne s’en avise, l’interdiction de la vérité ayant été concomitante de la disparition de l’esprit critique. Comment, alors, prendre la mesure de notre abandon ?
Les mesures de notre déchéance pourtant ne manquent pas : ce sont tous nos écrivains, arpenteurs de châteaux kafkaïens, auteurs par vertu d’auctoritas, maîtres des rapports et des proportions, stylistes pour tout dire, que, il est vrai, presque plus personne ne lit et dont on s’efforce, par « modernisations » successives, de faire disparaître jusqu’au souvenir dans le brouet culturel des « créatifs » et autres « concepteurs », après diverses manœuvres d’embaumements ou de feintes commémorations . Je recommande cet exercice aux quelques hérésiarques des cléricaricatures, mes amis : saisissez le monde moderne par l’œil de Montaigne ou de Molière, nourrissez-vous de la colère de Léon Bloy ou de Bernanos, ouvrez vos entendements aux vastitudes de Saint-John Perse ou d’André Suarès, aiguisez votre désespoir aux flammes froides et courtoises d’Albert Caraco, armez votre désinvolture « dans les trains de luxe à travers l’Europe illuminée » avec Valery Larbaud, soyez sébastianistes avec Pessoa et Dominique de Roux, et retrouvons-nous enfin à la fontaine claire de la Sagesse du Roi Dormant d’Henry Montaigu ! La fausseté s’en dissipera comme nuées, après la foudre et le vent.

Les Églises, les Dogmes, les Rites et les Symboles vidés de leur substance, devenus écorces mortes, mensonges, dérisoire « moraline » comme l’écrivit Nietzsche, c’est toute la société, ce Gros Animal, qui est devenue cléricale, despotique, inquisitoriale, s’adorant elle-même sous le nom de « Démocratie », insatiable de louanges, d’or, de vénérations et de crimes d’une ampleur dont aucun Empereur fou n’eût osé rêver ! Dans sa fange de hideurs médiatiques et de communication de masse, le Gros Animal se repaît de ses « vérités » digérées depuis longtemps. Tout est relatif, bien sûr, sauf lui, sauf son aptitude infinie à faire ses cellules à sa ressemblance. Qui, après Albert Cohen, saura reprendre la description de la « babouinerie » foncière de l’homme moderne, aussi policé qu’il se veuille, dans ses conseils d’administration, dans ses dîners, non moins que dans les stades, ou les boîtes de nuits, ces cavernes pour pithécanthropes énervés?
Que l’on s’avise de vouloir désabuser une seconde ses contemporains de leur illusion « moderne » : ils vous fusillent. « Les ratés ne vous rateront pas », sachez-le bien ! Comme disait Manet : « Ils vous fusillent et vous font les poches ». Hors de l’adoration unanime du Gros Animal nommé, pour la circonstance, « Démocratie », point de salut ! Le Démos est sacré, toutes ses erreurs deviennent la Vérité, qui, l’on sait, « est relative »... L’absolutisation du relatif, voilà bien la grande trouvaille imparable du Démos et de ses adorateurs. Que dit exactement le « nous » du Démos ? La réponse est chez Rimbaud, dans son poème précisément intitulé Démocratie :
« Aux centres nous alimenterons les plus cyniques prostitutions. Nous massacrerons les révoltes logiques... Aux pays poivrés et détrempés ! – au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires. Au revoir, ici, n’importe où. Conscrits du bon vouloir, nous aurons la philosophie féroce ; ignorants pour la science, roués pour le confort ; la crevaison pour le monde qui va. C’est la vraie marche. En avant, route ! »

« Conscrit du bon vouloir », le « démocrate » moderne n’en finit plus de célébrer la liberté qu’il abandonna à la société de contrôle et « au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires ». Tout lui va, et sa philosophie féroce, sa haine de toute Sapience, ira, sans états d’âme, faire les poches d’Arthur Rimbaud en personne pour en repeindre son ciel publicitaire, avec de bonnes intentions. « Roué pour le confort », on ne saurait mieux dire, tant il est vrai que le Moderne passe allègrement sur toutes les abominations, génocides, massacres, bombes atomiques du XXème siècle qui lui paraît, tout de même, bien aimable de lui avoir prodigué le four à micro-ondes et la voiture individuelle ! C’est bien : « la crevaison pour le monde qui va ». Je ne sais plus quel polémiste avait accusé les jeunes gens d’Action française d’être de ceux qui sont prêts à abattre une forêt pour se faire une badine. Le Moderne bien-pensant, lui, est prêt à consentir à l’extermination de peuples entiers, de préférence « archaïques », pour l’incalculable satisfaction que lui procurent ses nourritures congelées, ses gadgets technologiques, son chauffage tempéré, son cercueil de tôle puant, sa télévision et son ordinateur qui le relient en permanence à toutes les immondices du temps. Comment dire? « C’est la vraie marche » !
Je ne vois d’autre destination à cette marche que la disparition de la France. L’exercice permanent de contrition, d’autocritique, de dénigrement de soi-même auquel se livrent les intellectuels français, au point de ne plus tolérer dans le monde des lettres que le traduidu, fût-il directement écrit en français, relève, quand bien même il se targue d’être « de gauche », de cette vieille logique pétainiste selon laquelle les Français devaient expier leurs péchés en supportant la présence chez eux des Allemands. Le relativisme faisait aussi en ces temps-là ses ravages. Pourquoi être Français plutôt qu’Allemand ? L’exercice de contrition se poursuit de nos jours. Pourquoi être Français plutôt qu’Européen ou Américain ? Pour être, tout simplement, si le non-être nous ouvre ses bras pour disparaître délicieusement dans la consommation pure et simple des êtres et des choses ! Ce nihilisme est d’essence collaborationniste. Il invoque l’état de fait, la modernité, le réalisme comme autant d’instance auxquelles il est impossible de ne pas céder, il accable la France de tous les maux, lui dénie toute légitimité, l’écrase sous des fautes supposées ou réelles, se dresse en procureur ou en inquisiteur contre toutes les figures ayant incarné une part de notre tradition, de notre style et de notre liberté pour les ravaler plus bas que terre, les ridiculiser ou les bannir. Il n’est point d’auteur, de Prince, de chef d’État qui échappe à ces révisions dépréciatrices. Tout l’effort de nos intellectuels de ces dernières décennies semble avoir été porté par ce révisionnisme prétendument « démystificateur ». Ni Hugo, ni Baudelaire, ni Flaubert, ni Stendhal, ni Péguy, ni Malraux n’ont échappé à ces éreintages systé-matiques formulés en traduidu par des semi-illettrés bouffis de vanité. Les temps où l’on trouvait encore les œuvres complètes de La Fontaine, de Victor Hugo et d’Aragon dans les bibliothèques municipales est révolu. Place aux journalistes et aux présentateurs de télévision ! Même les auteurs chéris de la Gauche, cultivatrice avisée de la mauvaise conscience française, pour autant qu’ils étaient redevables à quelques grands ancêtres, sentent désormais le soufre pour les narines pincées des nouvelles cléricaricatures. Ni Breton, avec son style Grand Siècle, ni Gide, cet hédoniste protestant, ni Foucault, ni Deleuze, ces lettrés nietzschéens, ni même Sartre, épigone de Heideg-ger ou de Husserl, ne trouvent plus grâce dans ce nouvel ordre moral subjugué par l’idée enivrante de la disparition pure et simple de la France.
L’écrivain français, quel qu’il soit, on l’aura compris, est un empêcheur de penser en rond. Aussi bien, les cléricaricatures voudraient-elles en finir une fois pour toute avec ces survivances déplorables. L’abaissement du roman français de consommation courante ayant rompu toutes les amarres avec l’espace littéraire, on en finit presque par regretter Robbe-Grillet, artisan consciencieux de dédales à la syntaxe parfaite. La langue française ne serait-elle plus qu’une branche sèche, une substance lyophilisée à l’usage des pharmacopées universitaires ? Notre avenir littéraire n’est-il plus que dans la considération à peine nostalgique d’un alignement de bocaux étiquetés ? Soyons la preuve du contraire ! Les feuillages des Contemplations bruissent dans nos âmes, et la baudelairienne plongée dans l’inconnu ne laisse point d’exalter nos sens en tissages synesthésiques dans l’espace incandescent de notre entendement. Ce que nos auteurs éveillent en nous, ce n’est point l’hybris du glossateur, ou l’outrecuidance de l’historiographe, c’est un prodigieusement complexe sentiment de reconnaissance.

La reconnaissance certes est gratitude, mais cette gratitude se hausse jusqu’à la paramnésie. Ces paysages nous sont mystérieusement familiers et pourtant ils restent à découvrir. Les œuvres nous invitent ainsi à des missions de reconnaissance. Lorsque toutes les vérités sont détruites, nos Patries deviennent intérieures. Elles ne sont plus que de Ciel et de Mer, comme sont de Ciel, les pierres des chapelles romanes, et de Mer, les champs à perte de vue dans l’or du temps que récite Charles Péguy, chantre de Notre Dame. Connaître, c’est reconnaître et renaître à nouveau dans la mort immortalisante du Logos. Ces phrases que nous lisons, ne leur donnons-nous point une nouvelle vie ? Dans ce passage fulgurant du signe écrit à l’image de la pensée, n’est-ce point tout le mystère de la résurrection qui, à chaque fois, se joue ?
Comment ne pas comprendre, alors, que la volonté politique qui consiste à nous exiler de notre langue et de nos œuvres n’est autre qu’une volonté contre le Logos, contre le Verbe, un Dédire fanatique opposé au Dire des merveilles et des inquiétudes ? Comment ne pas comprendre que l’arasement de nos singularités porteuses de Formes signifie non seulement la destruction de la culture « élitiste », mais l’extinction des possibilités les plus inattendues de la vie magnifique ? Comment définir la « culture de masse », en dehors de ses caractéristiques de facilité et d’ignominie sinon par son caractère prévisible ? L’homme devant son poste de télévision ne s’annihile si considérablement que parce que toute sa satisfaction réside dans la prévisibilité absolue de ce qu’il va voir. Ce qu’il voit, il l’a déjà vu, et cette certitude lui permet de voir sans porter aucune attention à ce qu’il voit. Ainsi œuvre le Dédire, en défaisant peu à peu en nous cette faculté éminente de l’intelligence humaine : l’attention.
L’aversion de plus en plus ostensible que suscitent les œuvres littéraire trouve son origine dans l’attention qu’elles exigent. En perdant l’intelligence des œuvres, ce ne sont pas seulement les auteurs, ces hommes de bonne compagnie, qui s’éloignent de nous, c’est l’intelligence même du monde qui nous est ôtée à dessein. Ce qui se substitue au grand art littéraire, poétique et métaphysique n’est point une autre culture, que l’on voudrait orale ou imagée, mais l’omniprésence de l’écran publicitaire. Celui qui n’entend plus le chant du poète, comment entendrait-il le chant du monde ?

À parler ainsi du chant du monde, les modernes auront beau jeu de nous réduire à quelque lyrisme obsolète. Il ne s’agit pas seulement du chant, mais aussi de la vision, de la nuance, de la conversation, de l’attention pure et simple à la complexité rayonnante des choses. Il ne s’agit pas seulement de divaguer dans l’essor des voix, mais aussi de faire silence, d’entendre les qualités du silence, de l’attente. Il s’agit d’être à la pointe de l’attention, à l’entrecroisement fabuleux des synchronicités, à la fine pointe de l’esprit. Or, toutes ces merveilles, qui nous furent données, et qui justifient les prières de louange et de gratitude de toutes les religions, peuvent aussi nous être ôtées, non par la mort dont nous ne savons rien mais par l’inattention, le déclin de l’entendement. Dans ce combat, notre seule arme est le Logos, et la manifestation la plus immédiate et la plus humaine du Logos est notre langue, et notre langue est française.
Sitôt avons-nous énoncé cette évidence que les plus aimables de nos contemporains nous traitent de « souverainistes » et, pour les plus vindicatifs, de « nationalistes », voire de « fascistes » ! Quels temps étranges, vraiment, où la simple évidence, la vérité pure et simple fait de nous, pour d’autres qui prétendent ne croire en rien, des hommes de parti-pris, des réactionnaires et, pourquoi pas ? des « ennemis du Peuple ». Alors que nous n’avons d’autre parti que de nous déprendre, de laisser agir en nous à sa guise le génie d’une langue qui ordonne et dissémine nos pensées, nous voici soupçonnés d’être pris, et même d’être pris sur le fait. Le propre des ennemis du Logos n’est-il pas de ne rien entendre, d’être sourds aux arguments comme aux effusions de la beauté ? Aussi bien nous ne leur parlons pas : nous mettons simplement en garde ceux qui entendent contre ceux qui ne veulent rien entendre. Nous mettons en garde les esprits libres contre ceux qui n’aiment que la servitude, nous leur montrons où sont les armes de résistance et les instruments de connaissance. Aussi avancée – comme on le dit d’une viande avariée – que soit notre société, aussi perfectible que soit la planification, il suffit de quelques esprits pour se rendre victorieux des plus colossales négations de l’Esprit. L’Esprit, c’est là toute notre force, ne se mesure point en terme quantitatif. L’erreur indéfiniment propagée demeure impuissante contre la vérité la plus secrète, pourvu que quelques intelligences la redisent dans le secret du cœur. Selon Joseph de Maistre les adeptes de l’erreur se contredisent même lorsqu’ils mentent. Le plus titanesque amoncellement d’erreurs variées et de mensonges n’a pas plus de poids, dans les balances augurales de l’Esprit que la « montagne vide » des taoïstes. Le vide du mensonge revient à « rien », alors que le vide lumineux du Tao revient au Tout comme à sa source désempierrée. Le Logos est cette source qui désempierre les sources de l’âme, et, dans son frémissement immédiatement sensible, cette source, pour nous, est française. Pour le monde comme il va, pour cette marche, pour cette crevaison moderne, nous serons comme les Tarahumaras d’Antonin Artaud : nous refuserons d’avancer, nous nous rassemblerons autour de notre plus illustre bretteur, notre poète-guerrier, Cyrano de Bergerac, pour un voyage dans les empires de la Lune et du Soleil.
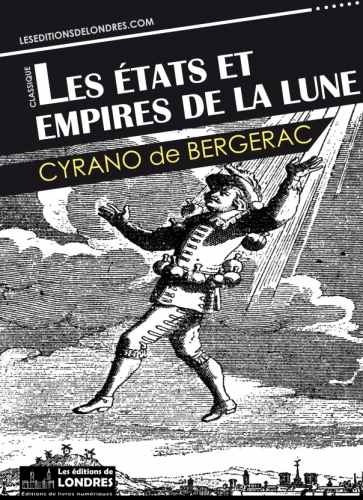
Soyons, comme Cyrano, téméraire. Cet au-delà du courage – que l’on répute parfois inconscient alors qu’il n’est peut-être qu’une conscience extrême consumée dans son propre feu de lumière – fait la force de nos désinvoltures charmantes. Les temps de la témérité spirituelle sont revenus, comme les cerisiers en fleurs. Soyons téméraires d’aimer notre langue et notre Patrie, soyons téméraires d’aimer ce qui nous enchante et nous allège ! Soyons téméraires d’envols et d’intelligences retrouvées avec nos Maîtres d’armes et de mots. Soyons téméraires à devancer nos grandes Idées, qui nous suivent, comme le disait Nietzsche « sur des pattes de colombe ». Soyons téméraires, car nous savons, de science certaine et aiguë, que nous avons tout à perdre et rien à gagner. Voici bien deux siècles que nous avons laissé gagner nos ennemis et ceux-ci pourrissent dans leur gain ou vont dans le sens de l’histoire, comme des animaux morts au fil de l’eau. Voici bien deux siècles, ou deux millénaires, que notre témérité de perdants éperdus nous tient en la faveur des Anges et des dieux.
Pour le téméraire, le temps ne compte pas, ni le décompte des secondes qui nous rapprochent de la mort, mais le vif de l’instant, dénombrement perpétuel de l’infini. Par « la preuve par neuf des neuf Muses », dont parlait Jean Cocteau, nous sommes assurés de retrouver le nombre exact de nos syllabes et de nos amis : ceux qui nous aiment dans les prosodies du temps qui passe. L’innocence du devenir nous convainc de la pérennité de l’être. Ne déméritons point de notre seule témérité d’être ! Rédimons les dieux bafoués par les temps moroses, les dieux qui dorment en nous, éveillons l’Ange de la fleur du cerisier, dans l’œcuménisme des racines, des branches, des fleurs, des parfums et des essences ! Éveillons l’Ange de la pierre et l’Ange du regard. Éveillons témérairement l’Archange de la France !

Il nous importe peu d’avoir contre nous l’Opinion majoritaire. Les majorités sont trompées, ou trompeuses. Une foule est toujours inférieure aux personnes qui la composent. Peut-on parler de l’intelligence d’une foule ou de son instinct ? Une foule ne pense pas davantage qu’une amibe. Régler sa pensée sur l’Opinion, c’est renoncer purement et simplement à la pensée. La première témérité spirituelle consiste à penser contre la foule, c’est-à-dire à penser. Ce que l’on nomme la transcendance n’est autre que cet instant où la pensée se dégage de l’Opinion. Cette pensée n’est point naturelle. Ce dont elle témoigne, aux risques et périls de celui qui s’en fait l’ambassadeur, est bien d’ordre surnaturel. Les philosophes de l’Antiquité ou du Moyen-Âge, qui croyaient en la divinité du Logos, portaient en leur croyance cette certitude pieuse et audacieuse d’une appartenance surnaturelle. N’être point soumis au Gros Animal, c’est être un Unique pour un Unique. Aussi bien la France dont nous parlons, dont nous chantons les Sacres et les prestiges, dont nous méditions la disposition providentielle, n’est point la nation, ni le peuple, concepts encore trop naturalistes à notre goût, mais une Idée, une Forme.
Cette Idée ou cette Forme sont l’espace de notre liberté sans cesse reconquise sur l’Opinion, le Gros Animal, le Démos, la Foule, la Quantité. Sans cesse, disons-nous, car sans fin est la bataille qui se déroule entre la perpétuité de la nature et l’éternité de la Surnature, entre l’immanence ourouborique et la transcendance sise dans l’Instant, entre le déroulement sans fin des temps et la présence immédiate de l’éternité. Nous ne célébrons point l’individu réduit à lui-même dans un monde « mondialisé » car cet individu ne serait qu’un atome interchangeable dans l’uniformité générale. Seule une Forme peut se rendre victorieuse de l’uniforme confusion des formes.
Les progrès de l’individualisme uniformisateur furent tels, ces derniers temps, que la nature même des hommes semble en avoir été changée. Détachée de la Sur-nature, la nature elle- même se soumet à l’uniformité industrielle. Les hommes de notre temps, comme les objets naguère artisanaux et devenu industriels, se ressemblent de plus en plus. Les voix, les intonations, les gestes, les situations des corps dans l’espace, les habillements, les complexions psycho-physiologiques, les dramaturgies intérieures deviennent de plus en plus identiques et méconnaissables. De cet étiolement des singularités témoigne aussi bien le spectacle de la rue, la lecture des premiers romans, les papiers des folliculaires que l’art cinématographique et le jeu des acteurs. Les singularités extrêmes de Louis Jouvet, de Michel Simon, de Sacha Guitry laissent la place à des voix, des élocutions, des discours, des présences, et mêmes des visages aux expressions de moins en moins dissemblables. Loin d’avoir libérés ou accrus les caractères propres des individus, l’individualisme moderne paraît avoir cédé à une codification de plus en plus stricte des comportements. Par un paradoxe que nos philosophes feraient bien de méditer, la disparition des types s’avère concomitante de celle des singularités.
On ne saurait trop surestimer les enjeux de la volonté générale. La prétendue « émancipation » du vouloir humain des Formes, des sagesses et des civilités antérieures, nous laisse avec une volonté de conformité sans exemple dans toute l’histoire humaine : les Formes traditionnelles étaient bien davantage les gardiennes de nos singularités par l’établissement dans un réseau d’appartenances, différent pour chacun. Dans les limites qu’elles prescrivaient, elles nous donnaient une chance d’être dissemblables et uniques. Les pédagogies anciennes si normatives, avec leur insistance sur la grammaire, la rhétorique, l’histoire enseignée comme la chronique d’une communauté de destin formaient des individus infiniment divers dans leurs goûts, leurs préférences, leurs styles et leurs allures, alors que les pédagogies modernes, où le professeur n’est plus qu’enseignant, où les cours magistraux sont bannis, où la « spontanéité » est considérée comme une valeur, nous donnent des générations de clones qui remâchent les mêmes idiomes, s’asservissent aux mêmes songes publicitaires et craignent par-dessus tout de paraître original le moins du monde. Il y eut, paraît-il, d’étranges temps heureux où l’inclination pour l’originalité, la distinction, le refus du conformisme, furent des signes de juvénilité. Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous n’en sommes plus là. Ce monde nouveau est bien vieux. Si nous n’avions gardé souvenir de ces jeunes vieillards que furent Ernst Jünger ou Gustave Thibon, nous serions tenté de croire, au vu et su de ce qui nous entoure, que le propre de la nature humaine est d’être cacochyme du berceau à la tombe !
La témérité spirituelle nous enseignera qu’il n’est jamais trop tard pour devenir jeune, et qu’il n’est point d’uniformité qui ne puisse être vaincue par les ressources d’une singularité puisée aux profondeurs de la Tradition. Encore faut-il des sourciers qui nous indiquent le cours des sources profondes.
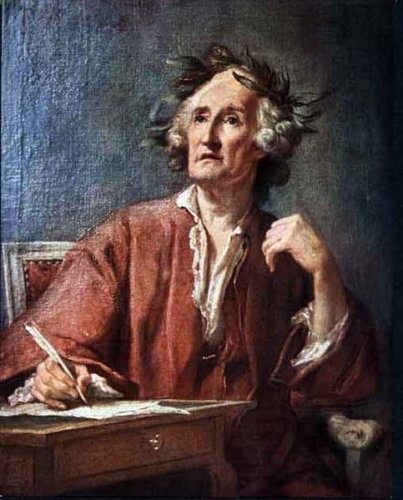
Les poètes sont nos sourciers. Il serait bien vain de chercher les preuves étincelantes de la témérité spirituelle chez les idéologues, les politiciens, même lors-qu’ils apparaissent comme des têtes brûlées, des instigateurs de chaos ou des terroristes, lorsque les temps que nous vivons sont déjà intégralement chaotiques et terroristes, lorsque de toute forme d’esprit il ne reste que des écorces de cendre. La tragédie dérisoire des nihilistes tient de cette évidence : l’époque où ils se manifestent est déjà plus nihiliste qu’eux. Leurs bombes, leurs vociférations, leurs « actes gratuits », la dégradation des valeurs, à laquelle ils s’appliquent méthodiquement, sont déjà en retard sur leur temps. En ces confins de l’Âge sombre où nous nous trouvons, le nihilisme actif ne passe plus qu’à travers des portes largement ouvertes. Les « démons » de Dostoïevski n’ont plus même affaire à des simulacres de valeurs, c’est le simulacre même de la négation des valeurs qui s’est érigé en valeur. La non-valeur règne théocratiquement, si bien que le nihilisme, pour âpre qu’il se veuille, fait désormais figure de passéiste. La « récupération » publicitaire des contestations n’est que la part la plus visible de ce phénomène. Lorsque l’espèce humaine en tant que telle, revêtue de la pourpre des suprêmes autorités travaille sans relâche à l’anéantissement de l’esprit humain, les révoltes contre l’esprit sont remises à leur place. Lorsque le nihilisme et l’anarchie sont généralisés, le nihiliste et l’anarchiste sont suprêmement conformistes, lorsque la négation de l’autorité est devenue le pouvoir incontesté, l’autorité seule devient l’expression de la véritable témérité spirituelle.
Les poètes sont nos sourciers, c’est assez dire qu’ils recueillent en eux des prérogatives immémoriales. Il n’y a point de grande différence de nature entre un vrai poète de notre siècle et Virgile ou Homère. Au meilleur de sa forme, le poète contemporain entre dans les pas de ces prédécesseurs. C’est toujours la célébration du beau cosmos miroitant, les exaltations de l’âme, les courants obscurs ou lumineux de la conscience, la fine pointe de l’intelligence qui font l’honneur de la poésie. La musique et l’architecture s’accordent toujours avec « l’âme de la danse » dont parlait Valéry. L’invisible et le visible s’entre-tissent toujours à la faveur de l’éclairement du langage humain lorsqu’il s’interroge sur la source silencieuse dont il provient. Le poète ne change ni de nature, ni de dessein. La bouche d’Ombre et les voix des ancêtres parlèrent à Victor Hugo comme aux temps les plus anciens de l’humanité, Antonin Artaud n’a rien à envier aux brutales ruptures de conscience provoquées autrefois par les chamanes, ni Mallarmé aux Mages égyptiens tels que les imaginèrent les philosophes néoplatoniciens. Saint-John Perse, Paul Claudel ou Ezra Pound établissent le Logos dans l’immémoriale vastitude épique ; l’effulgence des émanations plotiniennes frémit dans les prosodies de Shelley et les proses de Saint-Pol-Roux. Francis Ponge lui-même, qui tente de nous donner une poésie « matérialiste », se relie directement à Lucrèce. Quant aux Surréalistes, ils s’efforcèrent bravement de divaguer à l’exemple des Pythies.

Il n’est pas étonnant que le plus durable effort de la didactique moderne eût été d’en finir avec ce que Pierre Boutang nomme, à propos de Catherine Pozzi, « l’intention chrétienne » dans la poésie. En finir avec l’intention chrétienne, c’était aussi en finir avec l’intention païenne, platonicienne et plus généralement, avec le recours ultime et premier au langage comme processus de renaissance immortalisante. « Que le langage sauve l’existence, écrit Pierre Boutang, la retienne dans l’être, que de la pouvoir retenir soit comme une première preuve qui en appelle d’autres, et réfute le conseil désespéré des harpies et des oiseaux de nuit, Maurras n’en douta jamais ». Nous reviendrons une autre fois à Maurras ; laissons pour le moment chanter en nous l’idée téméraire du refus d’écouter le conseil des harpies. Qu’importe alors que l’intention soit chrétienne ou antérieure au christianisme si, en effet, toutes les merveilles ultérieures portent en elles les sapiences antérieures. L’interdiction, édictée par les sinistres satrapes de la « modernité poétique » de nommer le Christ ou Apollon, de confiner le grand art de la prosodie à de ridicules manipulations, témoigne assez que ni les Dieux, ni le Fils de Dieu n’ont plus leur place dans le Règne de la Quantité. Les poètes naguère encore ordonnés aux Muses, requis par l’impersonnalité active des visions et des Symboles, ou par la seule beauté fugitive en apparence des instants, furent enrôlés dans ces assez fastidieux travaux de démantèlement du langage, de déstructuration, de déconstruction, où la cuistrerie voisine avec l’ignorance pour mieux confirmer l’établissement déjà généralement acquis du néant du langage et de l’existence, et l’étrange décret du salut impossible.

Alors que la poésie fut, et demeure, dans son essence rendue hors d’atteinte, sauf, aux élus – précisément les poètes du Vrai et Beau ! – le chant des possibles, on voulut l’asservir à la seule tâche de se rendre impossible à elle-même, de s’exclure du possible salut, et du monde lui-même. « Il y a, écrit encore Pierre Boutang, une piété naturelle, ni chrétienne ni païenne exclusivement, liée à l’homme et à sa croyance que tout finalement est divin, reflète une transcendance et quelque influence plus qu’humaine. Ce qui n’est pas humain, c’est de ne croire qu’en l’homme, et prétendre que la nature, ce n’est que la nature. » Cette inhumanité foncière de l’homme ne croyant qu’en lui-même, il n’est que de parcourir les annales du XXème siècle qui vient de finir pour se convaincre qu’elle ne fut rien moins qu’abstraite. L’homme qui ne croit qu’en l’homme tient en piètre estime la vie de ses semblables et, sitôt ne distingue-t-il plus dans la nature l’émanation de la Surnature, qu’il s’autorise un pillage sans limite. Si le Moderne est enclin à l’éloge de l’infini, c’est avant tout cet infini du pillage qui lui plaît, avec la certitude, la seule qui lui reste, de ne plus jamais être redevable de rien. Si l’homme n’est que l’homme, si la nature n’est que la nature, toute exaction est permise, et l’on a beau dire que cette permission doit être mesurée, elle n’en demeure pas moins sans limites.
La poésie seule connaît le secret de la Mesure. Le paradoxe du temps est que cette Mesure est devenue hors d’atteinte et que la limite, la limite sacrée, semble perdue de vue. La nécessaire recouvrance de l’humilité tient désormais à la témérité spirituelle. L’infini moderne est l’infini du prisonnier, du maniaque, du disque rayé. On tourne en effet infiniment dans la cour de sa prison. Les ombres sur les murs de la caverne demeurent infiniment des ombres. La servitude se nourrit infiniment du nihilisme qu’elle croit opposer à sa propre conscience malheureuse. À la différence de la philosophie et de la médecine paracelsienne, qui préconisait de faire du mal un remède, et de changer ainsi le plomb en or, le Moderne excelle à faire du remède un mal et à changer l’or en plomb. À ce monde plombé, lourd et opaque, seule la témérité spirituelle du poète oppose une fin de non-recevoir. Cette fin, cette limite, est contenue dans le secret de la Mesure et dans le secret, plus profond encore, qui donne la Mesure. Dans le mouvement et l’immobilité du poème, le poète reçoit le don de la Mesure.
Transcendante, verticale, brisant le cercle de l’infini ourouborique, la Mesure s’établit dans un chant qui éveille toutes les vertus bienheureuses du silence. Par la Mesure, l’Intellect devient musique, les nombres se font incantation, et la prosodie art suprême de l’entendement. De même que les nihilistes étaient les retardataires du nihilisme de l’époque, l’arrière-garde se prenant, par une illusion touchante, pour l’avant-garde, les irrationalistes modernes s’acharnèrent sur une Raison déjà détruite, s’instaurèrent « déconstructeurs » de décombres sans comprendre que la raison qui ne veut être que raisonnable, oublieuse de sa profonde connivence avec le Mystère, n’est que pure déraison. Tel fut sans doute le sens du fruit biblique détaché de l’arbre de la connaissance. Ce n’est point la Connaissance qui nous perd, ni même le fruit de la connaissance, mais bien d’être un fruit détaché, réduit à la consommation ou à la mort.
Le poème, dont la nécessaire témérité spirituelle révèle en nous la sainte humilité est l’Arbre tout entier dont nous parlions, avec ses racines, ses branches, ses fruits, ses bruissements, et même les oiseaux qui viennent s’y poser et nous parlent la langue des Oiseaux. Sachons entendre ce qui nous est dit dans le silence du recueillement, sachons dire ce qui ne se dédit point, dans la fidélité lumineuse de la plus haute branche qui vague dans le vent. Les dieux sont d’air et de soleil, le Christ est Roi et l’Esprit-Saint veille, par sa présence versicolore, sur notre nuit humaine.
Luc-Olivier d'Algange.
17:22 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, luc-olivier d'algange, philosophie, témérité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

par Luc-Olivier d'Algange
« Mais que, s’ils reconnaissent dans le sensible
l’imitation de quelque chose qui se trouve dans la pensée,
ils sont comme frappés de stupeur
et sont conduits à se ressouvenir de la réalité véritable –
et certes à partir de cette émotion s’éveillent aussi les amours »
« Ainsi l’âme ne s’encombre pas de beaucoup de choses,
mais elle est légère, elle n’est qu’elle-même »
Plotin
Chaque philosophe qui parle d’un autre est livré à deux tentations égotistes. L’une consiste à montrer en quoi l’œuvre de son prédécesseur est dépassée ; l’autre, plus subtile, cède à la prétention d’apporter sur l’œuvre du passé un « éclairage nouveau ». Ces deux tentations témoignent de la farouche « néolâtrie » qui est le propre des Modernes. Seul le « nouveau » trouve grâce à leurs yeux. La déclaration d’intention novatrice se trouve être cependant, dans bien des cas, un peu vaine – d’autant plus que répétée de générations en générations, elle psittacise et cède, au moins autant que l’humilité traditionnelle, et souvent bien plus, à la redite.
Nietzsche lui-même, le plus radical et le plus prophétique des « novateurs » ne cesse d’engager avec ses prédécesseurs des joutes nuptiales dont le perpétuel recommencement montre assez que l’idée d’un « dépassement » des philosophies antérieures demeure à tout le moins problématique.
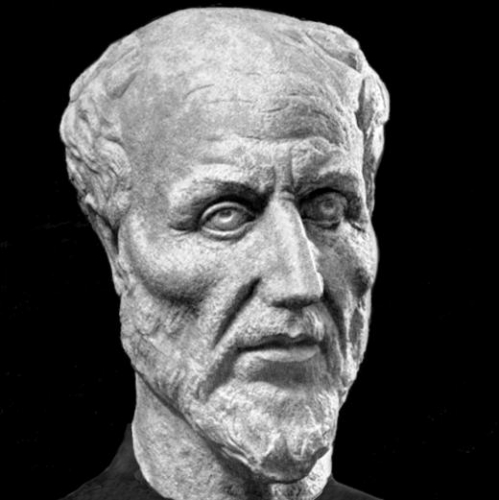
L’œuvre de Plotin se distingue des œuvres philosophiques modernes en ce que la notion de nouveauté n’y tient aucune place. Plotin ne se soucie point d’être nouveau, mais d’être vrai. Quand bien même il invente, innove, et souvent de façon décisive, sa pensée se veut celle d’un disciple, et ses plus grandes audaces se réclament encore de l’autorité de ses maîtres. Pour Plotin, il ne s’agit point d’imposer sa vérité, sa vue du monde, mais de laisser transparaître, par la fidélité au Logos, une vérité qui n’appartient à personne et dont la « transparition », en sa bouleversante luminosité, demeure hors de toute atteinte. Loin de se limiter à l’exposé didactique, au jeu du concept, voire à la morale ou à la politique, la philosophie pour Plotin est un mode de vie, une expérience métaphysique, autant qu’un savoir méditant sur lui-même.
La spéculation et l’oraison, l’aventure intellectuelle et l’aventure visionnaire, la raison et la prière participent d’une même ascèse. Pierre Hadot, dans son livre, Plotin ou la simplicité du regard, montre bien qu’il faut, dans le cheminement plotinien, donner au mot ascèse un sens sensiblement différent de celui qui prévaut communément de nos jours où ce que l’on nomme « l’idéal ascétique », généralement décrié, est perçu comme une austérité abusive, une contrition, voire comme une « auto-punition », pour user de la terminologie psychanalytique.
Rien de tel dans l’œuvre ni dans la vie de Plotin où le don de soi à une vérité et à une beauté qui nous dépassent, certes dispose à certaines épreuves, mais sans pathos outrancier, rhétorique ou théâtralité. Ce dont il s’agit, dans l’œuvre de Plotin, c’est d’aller vers Dieu, tant et si bien que ce voyage vers Dieu devient un voyage en Dieu. Or, voyager en Dieu, ce n’est point s’arracher à la nature ou à la terre, mais reconnaître en la nature le signe de la surnature et dans la terre une terre céleste.
La sempiternelle accusation formulée contre les néoplatoniciens de dévaloriser le monde sensible, d’exécrer la chair et de ne vénérer que d’immobiles idées détachées du monde ne résiste pas à la simple lecture des textes. Certes, l’idée, pour Plotin comme pour tous les platoniciens, est supérieure à la matière, en ce qu’elle est plus proche de l’être et de l’Un, mais c’est ne rien comprendre à cette idée que de ne pas voir qu’elle est d’abord, et étymologiquement, la Forme, et c’est ne rien comprendre à la Forme que de la juger abstraite, détachée du monde.
La Forme est précisément ce qui s’offre à notre appréhension sensible. Le monde sensible est peuplé de formes et c’est la matière qui est abstraite, puisque nous ne pouvons l’appréhender, la percevoir que par l’entremise d’une Forme. La philosophie néoplatonicienne est ainsi, de toutes les philosophies qui jalonnent d’histoire humaine, celle qui est la moins encline à l’abstraction, la plus rétive à se fonder sur une expérience médiate, la moins portée à éloigner l’expérience de la présence pure dans une représentation. Le matérialiste, croyant réfuter le platonisme adore la Matière – qui devient pour lui l’autre nom du « tout » – comme une abstraction, car nous avons beau la chercher, cette matière qui serait en dehors de la Forme, elle nous échappe toujours, elle n’est jamais là et toujours se dérobe à l’expérience.

La matière ne se dérobe pas au langage, puisque nous la nommons, ni à l’adoration, le matérialisme moderne étant la forme sécularisée du culte de la Magna Mater, mais bien à l’expérience immédiate qui ne nous offre que des formes, qu’elles soient vivantes ou inanimées, êtres et choses qui n’existent, ne se distinguent, ne se reconnaissent, ne se nomment, ne se goûtent, ne s’éprouvent que par leurs formes. La pensée néoplatonicienne – et c’est en quoi elle peut, elle la négatrice de toute nouveauté, nous sembler nouvelle, est une tentative prodigieuse de nous arracher à l’abstraction, de nous restituer au monde divers, chatoyant des formes, à cette multiplicité qui est la manifestation de l’Un.
La multiplicité des formes témoigne de la souveraineté de l’Un. Si l’Un n’était point l’acte d’être de toutes les formes du monde, la dissemblance ne régnerait point, comme elle règne, bienheureusement, en ce monde. Là encore, l’expérience immédiate confirme la pertinence de la méditation plotinienne. Les formes sont le principe de la dissemblance. Non seulement il n’est aucun cheval qui se puisse confondre avec un chat ou avec un renard, mais il n’est aucun cheval qui ne soit exactement semblable à un autre cheval, fussent-ils de la même race, aucune rose exactement semblable à une autre rose, fussent-elles du même bouquet ou du même buisson.
L’œuvre de Plotin est une invitation à la luminosité. Cette invitation, il nous plaît de savoir que nous ne sommes pas les premiers à y répondre. Depuis l’édition des Ennéades établie par Porphyre, qui fera l’objet au XXème siècle, de contestations plus ou moins justifiées – portant d’ailleurs davantage sur l’ordre des traités que sur leur texte –, l’œuvre de Plotin exerça une influence considérable dont il n’est pas certain que nous mesurions encore l’ampleur.
Le plotinisme oriental, théologique et théophanique, en particulier celui de Sohravardî, des ismaéliens et des soufis, échappe encore en partie à nos investigations, un grand nombre de textes ismaéliens demeurant hors d’atteinte, protégés par leurs héritiers, par le « secret de l’arcane » si bien que les chercheurs ne les connaissent que par ouï-dire. Nous sommes informés de l’influence de la pensée de Plotin sur les philosophes, tels que Marsile Ficin ou Pic de la Mirandole, mais nous sous-estimons encore son influence sur les poètes modernes, tels que Shelley, Wilde,, Rilke, Stefan George ou Saint-Pol-Roux. Il n’est pas impossible que les songeries héliaques du premier Camus, celui de Noces, aient été influencées par l’auteur des Ennéades auquel Camus, en ses jeunes années, consacra sa thèse de philosophie.
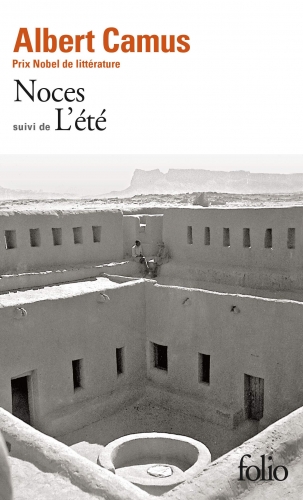
Dans le domaine de l’Art, hormis les Symbolistes et les Préraphaélites, largement influencés par le néoplatonisme, nous voyons un Kandinsky retrouver dans la définition qu’il donne du Beau une pure formulation plotinienne : « Est beau ce qui procède d’une nécessité intérieure de l’âme. Est beau ce qui est beau intérieurement. »
De tous les philosophes, Plotin est sans doute, avec Nietzsche, mais pour des raisons semble-t-il diamétralement opposées, celui qui s’accorde le plus immédiatement à une sensibilité artistique. L’idée, qui est cette « nécessité intérieure », n’est en effet nullement une abstraction. Le mot de « concret » lui convient parfaitement pour peu que notre audace herméneutique nous porte à imaginer un « supra-sensible » concret et à ne point limiter le « concret » aux objets qui s’offrent directement à nos sens. La distinction entre l’idée et l’abstraction est ici essentielle. La pensée de Plotin n’est pas seulement une pensée de la pensée ; elle n’est point « abstraite » des êtres et des choses. Elle hiérarchise, gradue, distingue, mais ne sépare point. Pour Plotin, philosopher, ce n’est point s’abstraire de la multiplicité, mais s’intégrer dans une unité supérieure. Il ne s’agit point de quitter un monde pour un autre, de se séparer des êtres et des choses, mais de s’élever et d’élever ces êtres et ces choses à une unificence divine qui les délivre de la fausseté et de l’inexistence pour les restituer à elles-mêmes, c’est-à-dire à leur réalité qui est vraie et à leur vérité qui est réelle. L’idée du beau n’est pas en dehors des beautés diverses, sensibles et intelligibles du monde, mais en elles. C’est à ce titre qu’il est légitime de dire, de l’idée plotinienne, qu’elle est une transcendance immanente, un supra-sensible concret qui échappe à nos seuls sens comme elle échappe à l’intelligence abstraite.
Schopenhauer, dans Le Monde comme Volonté et Représentation, souligne l’importance de cette distinction nécessaire et fondatrice entre l’Idée et le concept abstrait : « L’Idée, c’est l’unité qui se transforme en pluralité par le moyen de l’espace et du temps, formes de notre aperception intuitive ; le concept au contraire, c’est l’unité extraite de la pluralité au moyen de l’abstraction qui est un procédé de notre entendement ; le concept peut être appelé unitas post rem, l’Idée unitas ante rem. Indiquons enfin une comparaison qui exprime bien la différence entre concept et Idée ; le concept ressemble à un récipient inanimé ; ce qu’on y dépose reste bien placé dans le même ordre ; mais on n’en peut tirer, par des jugements analytiques, rien de plus que ce qu’on y a mis (par la réflexion synthétique) ; l’Idée, au contraire révèle à celui qui l’a conçue des représentations toutes nouvelles au point de vue du concept du même nom ; elle est comme un organisme vivant, croissant et prolifique capable en un mot de produire ce que l’on n’y avait pas introduit. »
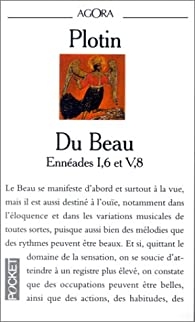 L’idée est antérieure, en amont, elle est avant la chose, et avant même la « cause », au sens logico-déductif. Elle est, au sens propre, instauratrice. Alors que le concept peut se réduire à sa propre définition, et qu’il n’offre à l’entendement dont il est issu aucun obstacle, aucun voile, aucun mystère, l’idée échappe à la connaissance totale que nous voudrions en avoir ; elle se propose à nous à travers le voile de ses manifestations, de ses émanations et déroute la perception directe que nous voudrions en avoir par la multiplicité de ses apparences. « Le concept, écrit encore Schopenhauer, est abstrait et discursif, complètement indéterminé quant à son contenu, rien n’est précis en lui que ses limites ; l’entendement suffit pour le comprendre et pour le concevoir ; les mots sans autre intermédiaire suffisent à l’exprimer ; sa propre définition enfin, l’épuise tout entier. L’Idée au contraire […] est absolument concrète ; elle a beau représenter une infi-nité de choses particulières, elle n’en est pas moins déterminée sur toutes ses faces ; l’individu en tant qu’individu ne peut jamais la connaître ; il faut pour la concevoir se dépouiller de toute volonté, de toute individualité et s’élever à l’état de sujet connaissant pur. »
L’idée est antérieure, en amont, elle est avant la chose, et avant même la « cause », au sens logico-déductif. Elle est, au sens propre, instauratrice. Alors que le concept peut se réduire à sa propre définition, et qu’il n’offre à l’entendement dont il est issu aucun obstacle, aucun voile, aucun mystère, l’idée échappe à la connaissance totale que nous voudrions en avoir ; elle se propose à nous à travers le voile de ses manifestations, de ses émanations et déroute la perception directe que nous voudrions en avoir par la multiplicité de ses apparences. « Le concept, écrit encore Schopenhauer, est abstrait et discursif, complètement indéterminé quant à son contenu, rien n’est précis en lui que ses limites ; l’entendement suffit pour le comprendre et pour le concevoir ; les mots sans autre intermédiaire suffisent à l’exprimer ; sa propre définition enfin, l’épuise tout entier. L’Idée au contraire […] est absolument concrète ; elle a beau représenter une infi-nité de choses particulières, elle n’en est pas moins déterminée sur toutes ses faces ; l’individu en tant qu’individu ne peut jamais la connaître ; il faut pour la concevoir se dépouiller de toute volonté, de toute individualité et s’élever à l’état de sujet connaissant pur. »
On ne philosophe jamais seul. Toute philosophie est une conversation. Est-il possible aujourd’hui de philosopher avec Plotin, de susciter, avec les Ennéades, un entretien dont les résonances s’approfondiraient de tout ce que nous éprouvons hic et nunc, de tout ce que cet « hic et nunc » nous donne à penser et à éprouver ? Notre dialogue intérieur, certes, sera différent de celui que Porphyre, Sohravardî ou Marsile Ficin eurent avec Plotin. Considérons alors l’espace-temps – incluant les différences historiques, religieuses et linguistiques – comme un prisme qui divise, en couleurs diverses, l’éclat d’une même clarté. Cette clarté nous ne pouvons l’atteindre d’emblée, nous ne pouvons en avoir la connaissance absolue dans l’immédiat. Notre lecture passe par le prisme de l’espace-temps tel qu’il se présente à nous. Est-ce à dire que cette clarté nous est plus lointaine qu’à Marsile Ficin ou Sohravardî et que, par cet éloignement, nous dussions nous contenter de considérer l’œuvre de Plotin comme un document concernant des temps définitivement révolus ? Ce serait ignorer, déjà, que le révolu est précisément ce qui revient ; ce serait surtout méconnaître ou refuser de voir ce que nous dit l’œuvre de Plotin, ce serait refuser le don de l’œuvre, ce qu’elle nous donne à penser et qui, explicite-ment, se donne par-delà les contingences de l’espace et du temps.
Lisons donc, tentons de lire à tout le moins, ces traités comme s’ils avaient été écrits ce jour même . Leur premier abord, ingénu, offre-t-il d’ailleurs de si grandes difficultés ? Les phrases de Plotin nous semblent-elles si obscures que nous dussions les traiter comme des documents anthropologiques et non comme une parole qui nous est adressée, comme un murmure au creux de l’oreille ? Combien d’œuvres de la littérature moderne ou contemporaine nous sont plus opaques, mieux défendues, plus rigoureusement barricadées dans leur idiome, dans leur singularité extrême ? Alors que les critiques sont loin encore d’avoir même une vague idée des références à l’œuvre dans le Finnegan’s Wake de Joyce ou dans les Cantos de Pound, les références de Plotin nous sont d’emblée presque toutes connues avant même que nous abordions l’œuvre pour peu que nous eussions été préalablement un lecteur de Platon. Ce dont il parle ne saurait nous être étranger puisqu’il s’agit du Bien, du Beau et du Vrai et que chacun d’entre nous ne cesse de considérer les actes, les œuvres, les sciences selon un rapport avec le bien, le beau et le vrai.
Enfin, la philosophie de Plotin étant un élan de dégagement de la contingence historique et sociale, celle-ci ne l’informe que par le biais et fort peu, si bien que notre relative méconnaissance de la société du temps de Plotin ne nous interdit nullement d’entendre ce qu’il nous dit. Disons : bien relative méconnaissance, car, à celui qui s’y attache, les données sont peut-être offertes en plus grand nombre, en l’occurrence, que sur d’autres régions, dont il est le contemporain et peut-être le voisin ; les différences de classe, de quartier induisent de nos jours des disparités de langage peut-être plus réelles et plus profondes que celles qui séparent un lettré moderne d’un lettré de la période hellénistique.
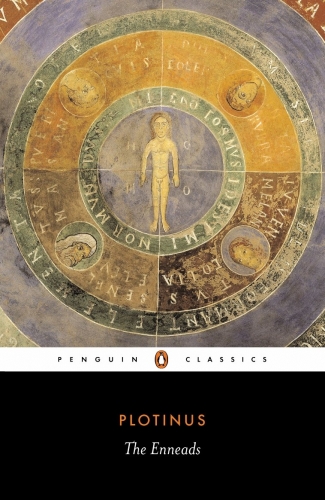
Ce qu’il y a de plus essentiel dans une œuvre se laisse comprendre à partir de ce qui semble être un paradoxe. En marge de la doxa, c’est-à-dire de la croyance commune, le paradoxe est l’antichambre ou le frontispice de la gnosis, de la connaissance. Il y a du point de vue des croyances et des philosophies modernes de nombreux paradoxes dans l’œuvre de Plotin. La grande erreur des Modernes est d’attribuer à l’Idée plotinienne les caractéristiques propres à leurs concepts. Cette abstraction figée, despotique, séparée du sensible, ce mépris de la diversité heureuse ou tragique du Réel, ce dualisme qui scinde en deux mondes séparés ce qui est perceptible et ce qui est compris, ce qui relève de l’émotion esthétique et ce qui s’ordonne à la raison, n’appartiennent nulle-ment à l’œuvre de Plotin, ni à celle de Platon. À ce titre, il n’est pas illégitime de retourner contre les « anti-platoniciens », leurs propres arguments.
Les « intellectuels » modernes, dont on ne sait s’ils s’arrogent cette appellation par prétention vaine, par antiphrase ou par défaut – leur croyance la plus commune consistant à nier l’existence même de l’Intellect – propagent volontiers l’idée que leur époque est celle de la diversité, du foisonnement, de l’éclatement « festif » et « jubilatoire », voire, lorsqu’ils se piquent de culture classique, d’un « rebroussement vers le dionysiaque » qui nous délivrerait enfin du carcan des époques classiques, médiévales ou antiques, si « normatives » et « dogmatiques ».
À celui qui dispose de la faculté rare de s’abstraire de son temps, à celui qui sait voir de haut et de loin les configurations historiques, religieuses ou morales et ne serait point dépourvu, par surcroît, de la faculté, propre aux oiseaux de proie, de fondre sur les paysages des temps contemporains ou révolus jusqu’à en éprouver la présence réelle, une réalité tout autre apparaît. Cette modernité, qu’on lui vante chatoyante, lui apparaîtra tristement uniforme et grisâtre, et ces temps anciens réputés sévères surgiront devant son regard comme des blasons ou des vitraux, ou mieux encore, comme des forêts blasonnées de soleils et de nuits dont les figures suscitent et soulignent les oppositions chromatiques. Les philosophies modernes, se révéleront à lui d’autant moins diverses que chacune d’elles, comme dressée sur ses ergots, n’aura cessé de prétendre à « l’originalité », à la « rupture », à la « nouveauté ».
En philosophie, non moins que dans nos mœurs, l’individualisme systématique devient un individualisme de masse et la prétention à la singularité ne tarde pas à donner l’impression d’une grande uniformité. Ce qui distingue Lucrèce de Pythagore, Héraclite de Parménide ou encore Saint Augustin de Maître Eckhart brille d’un éclat beaucoup plus certain, d’une force de différenciation beaucoup plus puissante que tous les discords et disparates que l’on souligne habituellement chez les Modernes. Dans l’outrecuidance des singularités et des jargons, les dialogues n’ont plus lieu, chacun s’en tient à son idiome et les disciples, lorsqu’il s’en présente, ne sont que les gardiens des mots, les vigiles du vocabulaire, les idolâtres de la lettre morte.
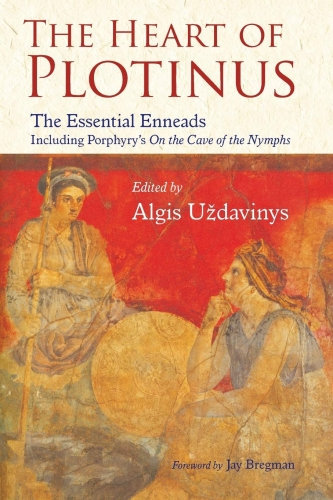
Il semblerait que les philosophes modernes soient d’autant plus soucieux de se distinguer par leur vocabulaire qu’ils se sont plus uniformément dévoués au même dessein, à savoir « renverser » ou « déconstruire » ce qu’ils nomment « le platonisme ». Chacun y va de sa méthode, de ses sophismes, de sa prétention, de ses ressentiments ou de ses approximations pour tenter d’en finir avec ce qu’il croit être la pensée ou le « système » platoniciens. Derrida traque les survivances platoniciennes dans la distinction du signifié et du signifiant. Deleuze, plus subtil et plus aventureux, propose le « rhizome » susceptible de déjouer la prétendue opposition de l’Un et du Multiple. Sartre croit vaincre la métaphysique, considérée comme une ennemie, en affirmant la précellence de l’existence sur l’être. Ces belles intelligences suscitèrent d’innombrables épigones, tous plus acharnés les uns que les autres à affirmer la « matérialité » du texte au détriment du Sens et la primauté du « corps » sur l’Esprit.
Cet unisson à la fois anti-platonicien et anti-métaphysique ne donne cependant de la pensée contre laquelle il se fonde et par laquelle il existe qu’une image caricaturale. Le lecteur attentif, dégagé des ambitions novatrices, cherchera en vain dans les dialogues de Platon le « système » dénoncé. Les textes contredisent ce qui prétend les contredire. On discerne mal dans le magnifique entre-tissage d’arguments et de contre-arguments des Dialogues, cette pensée qu’il serait si aisé de « renverser » ou ce « système » qu’il faudrait « déconstruire ». Ce qui, en l’occurrence, se trouve renversé ou déconstruit n’est qu’un résumé scolaire, un schéma arbitraire, une hypothèse mal étayée.
Nos philosophes qui se croient novateurs alors qu’ils ne sont que modernes, c’est-à-dire plagiaires ingrats, ne renversent et ne déconstruisent que ce qu’ils ont eux-mêmes édifié et construit pour les besoins de leur démonstration. Leur volonté est certaine : en finir avec l’Idée, le Logos, le Sens, la Vox cordis, mais les instruments de leurs démonstrations sont défaillants et leurs arguments sont fallacieux. L’exposé des idées qu’ils combattent est trompeur, tant il se trouve subordonné à leur argumentaire et, pour ainsi dire, fabriqué de toutes pièces pour les besoins de la cause. Platon ne dit pas, ou ne dit pas seulement ce qu’ils envisagent, non sans vanité, de contredire, et la logique même de leur contradiction, soumise à l’arbitraire de celui qui fait à la fois les questions et les réponses, masque difficilement l’envie de celui qui dénigre une audace intellectuelle qu’il pressent demeurer hors de sa portée. Il lui faudra donc, avant même d’engager les hostilités, réduire l’adversaire à sa mesure, le portraiturer à son image.

Anti-platonicienne, la doxa moderne est aussi, de la sorte, caricaturalement platonicienne. Elle suppose que tous les ouvrages de Platon se résument à l’opposition de l’Idée et du monde sensible, à une sorte de dualisme, aisément réfutable, entre deux mondes, alors même que Platon unit ce qu’il distingue par une gradation infinie. Ce système dualiste qui oppose le corps et l’esprit, l’intelligible et le sensible, l’Un et le Multiple, et auquel les Modernes prétendent s’opposer, c’est le leur. Lorsque Platon et les platoniciens unissent ce qu’ils distinguent, comme le sceau invisible et l’empreinte visible, nos Modernes s’en tiennent à l’opposition, au dualisme, en marquant seulement – ce qu’ils imaginent être une faramineuse nouveauté ! – leur préférence pour le corps, pour le sensible, pour le multiple, autrement dit pour l’empreinte, en toute ignorance de la cause et du sceau. Dualistes, ces chantres de la primauté du corps le sont éperdument puisqu’ils l’opposent à l’Esprit et leur éloge du Multiple n’est jamais que l’envers outrecuidant de la célébration de l’Un. Ce qui manque à ces gens-là, ce n’est point la dialectique – encore que ! – c’est bien le sens platonicien de la gradation infinie.
Je m’étonne que personne jusqu’à présent n’ait esquissé une physiologie de l’anti-platonicien ou ne se soit aventuré à interroger précisément, et selon l’art généalogique, les origines de cette hostilité à l’Esprit et au Logos. Que cache ce repli sur le corps et la matière conçus comme le « négatif » de l’Esprit nié ? Quelle est la nature du ressentiment dans l’affirmation du corps et de la matière comme « réalités premières » dont toutes les autres, métaphysiques ou « idéales », ne seraient que les épiphénomènes ? À quelles rancœurs obscures obéissent ces sempiternelles redites ? Quelle image du monde proposent-elles ? Si les mots gardent un sens où rayonnent encore leurs vérités étymologiques, force est de reconnaître que ces philosophes d’obédience anti-platonicienne font ici figure de réactionnaires. Niant l’Idée, qui leur apparaît coupable d’intemporalité et d’immatérialité, ils en viennent tout naturellement à opposer la matière et le temps à l’Esprit et à l’Éternité dont elles sont, selon Platon, la forme et l’image mobile. Or, dans la langue grecque, dont Platon use avec un bonheur propre à susciter la rage des consciences malheureuses, la forme et l’Idée se rejoignent en un seul mot : idéa.
Cette idée qui est la Forme et cette forme qui est l’Idée apparaissent, pour des raisons qu’il s’agit d’éclaircir, comme insoutenables à la pensée exclusive-ment réactive des Modernes, qui préfèrent rendre la pensée impossible ou la déclarer telle, plutôt que de reconnaître le monde comme ordonné par le Logos ou par le Verbe. Ce refus de reconnaissance, cette ingratitude foncière, cette vindicte incessante, cette accusation insistante, le Moderne voudra l’ennoblir sous les appellations de « contestation » ou de « subversion », lesquelles, nous dit-on, sont au principe du « progrès » et des conquêtes de la « démocratie » et de la « raison ». Ces pieux mensonges satisfont à la raison de celui qui n’en use guère, mais laisse dubitatif l’intelligence distante, dont nous parlions plus haut, par laquelle ce corps, cette multiplicité idolâtrée demandent encore à être interprétés dans le jeu inépuisable de leurs manifestations. Nos matérialistes de choc qui, en bons consommateurs, ne se refusent rien, ne se sont pas privés d’enrôler Nietzsche dans leurs douteuses campagnes. Nietzsche, qui, soit dit en passant, ne croyait nullement en l’existence de la matière, se trouve ainsi réduit au rôle de magasin d’accessoires pour les « philosophes » éperdus à trouver quelques justifications présentables à leur ruée vers le bas. Seulement, l’accessoire le plus usité, à savoir la critique que Nietzsche fait des arrière-mondes et du ressentiment, se retourne contre eux, car, à vanter le corps au détriment de l’Esprit, la lettre et le « fonctionnement du texte » au détriment du Logos et de son magnifique cœur de silence, nos Modernes illustrent à la perfection la parabole de la paille et de la poutre. Ce corps, cette matière auxquels ils veulent restituer la primauté ne sont pour eux que des réalités abstraites, qui n’existent que par l’abstraction ou l’ablation, pour ainsi dire chirurgicale, de l’Esprit.
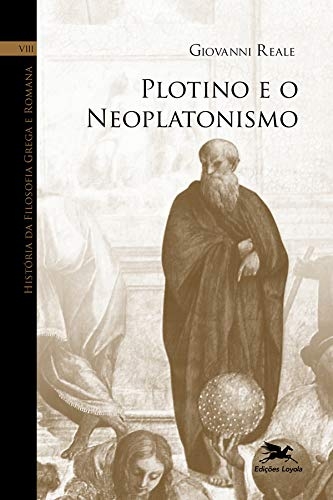
Le Moderne veut que le corps soit, en lui-même, que la matière soit, en elle- même, en même temps qu’il dénie à l’âme, à l’Esprit – gardons l’insolence et l’ingénuité de la majuscule – et même au cœur, toute possibilité de prétendre à cette réalité « en soi ». Ce platonisme inverti prétend nous emprisonner à jamais dans la représentation subalterne, seconde, de la pensée qu’il parodie en l’inversant. Alors que les œuvres de Platon, de Plotin, de Proclus – comme celle de tous les philosophes dignes de ce nom, qui aiment la sagesse, c’est-à-dire le mouvement de leur pensée vers la vérité dont elle naît – nous enseignent à nous délivrer d’elles-mêmes, à devenir ce que nous sommes, nos anti-platoniciens de service – qui sont, la plupart du temps, des fonctionnaires d’un État qu’ils dénigrent – n’existent qu’en réaction à ce qui pourrait se détacher de leurs systèmes, échapper à leur pouvoir, et vaguer à sa guise, qui est celle de l’Esprit, qui souffle où il veut.
Le corps qu’ils idolâtrent, et dont ils font une abstraction d’autant plus revendiquée qu’elle est, par définition, moins éprouvée, loin d’être le principe d’une relation au monde, et donc, d’une pérégrination du Logos, n’est, au mieux, que le site d’une expérimentation refermée sur ses propres conditions. Philosophes, ou mieux vaudrait dire idéologues du Non, du refus de la relation, le corps et la matière, qu’ils installent en médiocres métaphysiciens croyant ne l’être plus à la place de Dieu, ne valent que par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Une philosophie de l’assentiment, une philosophie du Oui resplendissant de toute chose, et de toute cause, cette philosophie, que l’on trouve au cœur même de la pensée Héraclite, de Maître Eckhart et de Nietzsche, leur est la plus étrangère, la plus inaccessible. Le corps qu’ils vantent abstraitement et dont ils n’éprouvent point la nature spirituelle n’est pour eux qu’une arme contre l’Esprit. L’« idéal » de ces anti-idéalistes est de peupler le monde de corps sans esprit, c’est-à-dire de corps pesants, fermés sur eux-mêmes, réduits à leurs plus petits dénominateurs communs, en un mot des « corps-machines ». La science, qui suit l’idéologie bien plus qu’elle ne la précède, s’applique aujourd’hui à déconstruire et à parfaire ces mécanismes, non sans cultiver quelque nostalgie d’immortalité, mais d’une immortalité réduite aux dérisoires procédures californiennes de la survie prolongée, voire de l’acharnement thérapeutique.
La distinction platonicienne du sensible et de l’intelligible ouvre à celui qui la médite des perspectives à perte de vue, où la « vérité » n’est point acquise, mais à conquérir dans l’espace même de l’aporie, de la perplexité, de la suspension de jugement. La hâte à juger, à réduire la pensée à une opinion, l’empressement à déclarer caduques, mensongères, hors d’usage, des pensées et des œuvres dont le propre est de nous inquiéter, de nous dérouter – et, par un paradoxe admirable, de nous contraindre à une liberté plus grande – sont, en ces temps qui adorent le temps linéaire et la fuite en avant, les pires conseil-lères. Elles abondent dans nos facilités, nos prétentions indues, nos paresses. Elles nous invitent à voir court. Elles nous prescrivent le mépris du Lointain, elles nous enclosent dans un corps abstrait, c’est-à-dire dans un corps mécanique, sans humeurs ni mystères. Le propre de ce corps abstrait est d’être transparent à lui-même et opaque au monde. Il se perçoit lui-même comme corps, un corps qui serait un « moi », en oubliant qu’il n’est d’abord, et sans doute rien d’autre, qu’un instrument de perception.

L’œil, l’oreille, la bouche, la peau, les bras qui nous donnent à saisir et à embrasser et les jambes qui nous permettent de cheminer dans le monde, sans oublier les mains, créatrices, devineresses, travailleuses et caressantes, et les sexes, en pointes ou en creux, sont d’abord des instruments de perception. Notre corps n’existe qu’en fonction de ce qu’il perçoit et de ce qu’il dit, par les regards, les gestes et les paroles. Or, ce qu’il perçoit est de l’ordre du langage qui est, lui, radicalement immatériel, car il ne se situe ni dans le corps, en tant que réalité matérielle, ni dans le monde, mais entre eux. Le corps n’existe pas davantage « en soi » que l’instrument de musique n’existe en dehors de la musique qui le suscite et à laquelle il obéit. Un instrument de musique dont on se servirait comme d’une massue cesse, par cela même, d’être un instrument de musique, un corps qui n’est qu’un corps « en soi », et dont les œuvres de l’Esprit ne seraient que les épiphénomènes, serait également méconnu.
La méconnaissance du corps se laisse constater par la singulière restriction de nos perceptions ordinaires. Le Moderne qui idolâtre le corps « en soi » réduit à l’extrême l’empire de ce qu’il perçoit. La réduction des perceptions s’accélère encore par l’oubli, caractéristique de notre temps, d’une science empirique du percevoir qui fut, naguère encore, la profonde raison d’être de l’Art sous toutes ses formes. Le corps ne dit point « je suis un corps », formule abstraite, s’il en est, le corps dit « je suis ce que je perçois ». Je est un autre. Sitôt nous sommes-nous délivrés du ressentiment qui prétend venger le corps des prétendues autorités abusives de l’Esprit, sitôt se déploient en nous les gradations qui n’ont jamais cessé d’être, mais dont nous étions exclus par un retrait arbitraire, voici qu’un assentiment magnifique nous saisit, au cœur même de nos perceptions, à cette étrangeté si familière du monde.
Cette énigme de l’écorce rugueuse sous nos doigts, ce mystère de la voûte parcourue du discours magnifique des météores, ce bruissement des feuilles, cette pesanteur douce, sans cesse vaincue et retrouvée de nos pas sur la terre ou l’asphalte ne cessent de nous faire savoir que nous sommes faits pour le monde que nous traversons et qui nous traverse. Qu’en est-il alors du « moi » ? Sinon à l’intersection de ces deux traverses, il faut bien reconnaître qu’il ne se trouve nulle part. Notre œil n’existe que par la lumière étrangère et sur-prenante qui le frappe et dont notre intelligence se fera l’éminente métaphore. Le discours entre le monde et nous-mêmes ne résiste pas davantage à l’interprétation qu’à la contemplation. Seuls peuvent le perpétuer et lui donner une apparence de vérité notre ressentiment contre l’Esprit et notre aveuglement aux signes, intersignes et synchronicités, qui, sans cesse, en vagues de plus en plus pressantes, s’offrent à nous avec munificence. Le déni de l’Esprit et de l’âme et l’affirmation pathétique du corps en tant que réalité ultime et première ne reposent que sur notre crainte, sur notre attachement craintif, effarouché, à ce que nous croyons être notre « identité » et qui n’est, et ne peut être, qu’un moment de notre traversée. L’interprétation infinie à laquelle nous invite l’Esprit nous effraie. Nous nous raccrochons désespérément, quitte à nous refermer sur nous-mêmes comme un cercueil, à ce corps qui, pour être éphémère, nous semble certain, et nous préférons cette certitude éphémère à l’éternité incertaine de l’Esprit.

Alors qu’aux temps de Nietzsche, si proches et si lointains, le ressentiment se figurait sous les espèces d’un idéalisme scolaire, taillant la part du lion à la redite, notre époque timorée et pathétique s’est constitué un matérialisme vulgaire aux ordres de ce même ressentiment qui semble être passé d’une idéologie à l’autre, à l’instar de la police politique tsariste recyclée avec les mêmes hommes et les mêmes méthodes au service de la police stalinienne.
L’homme derrière ses écrans, ne jetant plus un regard aux nues que pour planifier son week-end, l’homme calculateur, tout appliqué à « gérer » les conditions de son esclavage et ourdissant, aux avant-gardes, de sinistres projets eugénistes d’amélioration de l’espèce – venus se substituer aux anciens idéaux, stoïciens, ou théologiques, du perfectionnement de soi –, l’homme pathétique et dérisoire des « temps modernes » se trouve désormais si peu aventureux, si narcissiquement contenté, si piteusement restreint à sa fonction édictée par le « Gros Animal » social, dont parlaient Platon et Simone Weil, que l’idée même d’un mouvement, d’une âme, d’une métamorphose obéissant à une loi impalpable et incalculable lui paraît une offense atroce à ses certitudes chèrement acquises.
Le cercle vicieux est parfait. Le Moderne tient d’autant plus à sa servitude ; sa servitude est d’autant plus volontaire, et même volontariste, que la liberté sacrifiée est plus grande. L’esprit de vengeance contre les œuvres qui témoignent de « la liberté grande » n’en sera que plus radical, jusqu’au ridicule. Il suffit, pour s’en persuader, de lire les ouvrages de biographie et de critique littéraire qui parurent ces dernières décennies alors que se mettaient en place les procédures draconiennes de réduction de l’homme au « corps-machine », sinistre héritage du prétendu « Siècle des Lumières ». Entre les biographies qui s’appliquent consciencieusement à ramener des destinées hors pair à quelques dénominations connues d’ordre sociologique ou psychologique – « expliquant » ainsi l’exception par la règle, et le supérieur par l’inférieur – et les critiques formalistes se fermant délibérément à toute sollicitation et à toute relation avec les œuvres pour n’en étudier que le « fonctionnement » à la manière d’un horloger si obnubilé à démonter et à remonter ses montres qu’il en oublie qu’elles ont aussi pour fonction de donner l’heure, la littérature secondaire, critique et universitaire, apparaît rétrospectivement pour ce qu’elle est : une propagande dépréciatrice dont les ruses plus ou moins grossières ne sont plus en mesure de tromper personne, sinon quant à leur destination : la ruine du Logos.

Au corps qui ne serait « que le corps », au texte qui ne serait « que le texte », à la vie qui ne serait « que la vie », il importe désormais d’opposer, en cette « grande guerre sainte » dont parlait René Daumal, le corps comme intercession de l’Esprit – c’est-à-dire passage des perceptions, des intersignes et des heures –, le texte comme témoin du Logos, empreinte visible d’un sceau invisible et la vie comme promesse, comme preuve de l’existence de l’âme. Cette guerre n’a rien d’abstrait, elle est bien sainte, selon la définition que sut en donner René Daumal dans un poème admirable, car loin de définir un ennemi extérieur, par la race, la classe, la religion, ou d’autres catégories, plus vagues encore, cette guerre intérieure, sainte, cet appel à l’inquiétude de l’être ne connaît d’autre ennemi que le dédire. Chaque homme est à la fois le servant et le pire ennemi du Logos, du Verbe. Celui qui peut dire peut dédire, de même que celui qui chante peut déchanter. Le monde moderne, s’il fallait en définir la nature dans une formule, pourrait être défini comme l’Adversaire résolu du Verbe, ou du Logos – nous tenons en effet, à tout le moins dans leur résistance au dédire moderne, le Verbe créateur de la Bible et le Logos invaincu de la philosophie platonicienne pour équivalents, sinon similaires.
Le monde moderne ne semble être là, avec ses théories, ses politiques, ses blagues et ses méthodes de lavage des cerveaux, de mieux en mieux éprouvées, que pour mieux récuser la possibilité même du Verbe. La réalité du monde moderne ne semble tenir qu’au ressentiment de la créature contre ce qu’il suppose être son créateur et dont sa vanité lui prescrit de s’affranchir. D’où, en effet, l’irréalité croissante de ce monde, sa nature de plus en plus virtuelle et évanescente, mais aussi cauchemardesque. Ce monde où rien ne peut se dire est aussi un monde où rien ne peut être éprouvé. La réduction de notre vocabulaire, de nos tournures grammaticales est corrélative de la restriction de nos sensations et de nos sentiments. Le déni de la Surnature nous ôte le senti-ment de la nature et le refus de la métaphysique nous exile du monde physique. La guerre contre le Logos, guerre d’images, de signifiants réduits à eux-mêmes est à la fois une guerre contre toute forme d’autorité et contre toute forme de relation. L’antipathie instinctive que suscite chez les Modernes le déploiement heureux de la parole humaine est un signe parmi d’autres de leur soumission au nihilisme, également hostile à la raison et au chant. Loin de s’exclure, d’être ces adversaires perpétuels livrés à un combat qui ne connaîtrait que de rares et surprenantes accalmies, la raison et le chant, pour celui qui pense à la source du Logos, sont bien de la même eau castalienne, ou du même feu.

Sans céder à l’outrecuidance historiciste qui consisterait à lui trouver une date précise, il est permis de situer le premier signe d’une déchéance qui se poursuivra jusqu’au triomphe du nihilisme moderne à ce moment fatidique où la raison, se disjoignant du chant, l’un et l’autre furent livrés aux incertitudes respectives de leurs spécialisations. Cette scission fatale, ourdie par « Celui Qui Divise », incontestablement la première étape du déclin de notre culture – les forces de la raison s’opposant désormais aux puissances de la poésie, s’épuisant dans leurs contradictions aveugles, au lieu d’étinceler en joutes amoureuses – fut à l’origine de ce double mensonge qu’est le dualisme théorique où la rationalité folle se retourne contre la raison et où la poésie, anarchique et confuse, devient l’ennemie du chant.
Réduite à la logique marchande et technologique, la raison, oublieuse de ses questions essentielles, de ce nécessaire retour sur elle-même qui s’interroge sur « la raison de la raison », laissa la poésie au service de la publicité et de l’expression lassante, voire quelque peu répugnante, des subjectivités abandonnées à elles-mêmes et n’ayant plus d’autres motifs qu’elles-mêmes. Le poisson, dit-on, pourrit par la tête. Mais il faut croire que nous n’en sommes plus là. La doxa populaire reproduit désormais exactement les sophismes diserts de ceux qui furent, naguère, des nihilistes de pointe. Le « tout est relatif » du café du commerce par lequel on entend sans doute nous faire entrer dans la tête, et si possible une fois pour toute, qu’il n’existe aucune clef de voûte au jeu des relations et que toute « vérité » vaut n’importe quelle autre – « chacun a la sienne », ce qui ne fâche personne... – entre en parfaite résonance avec les sophismes des intellectuels qui se croient énigmatiquement mandatés pour « déconstruire » et « démystifier », le premier terme leur convenant à ceci près qu’ils déconstruisent surtout pour rebâtir – avec les pierres dérobées aux édifices vénérables – des cachots modernes, le second relevant de la pure vantardise, ou de l’antiphrase, car ils furent, lâchant leurs proses jargonnesques comme les sèches leur encre, ces éminent mystificateurs dont le monde moderne avait besoin pour dissimuler la froide monstruosité de ses machinations.
Rationalistes contre la raison, de même que les publicitaires sont « créatifs » contre la création, qu’ils entendent nous vendre universellement après étiquetage, les Modernes, qui se donnent encore la peine, non sans ringardise, de justifier leurs dévotions ineptes par des arguments, n’ont plus désormais pour tâche, dans leur guerre contre le Logos, que de nous rendre impossible l’accès aux œuvres, soit par le dénigrement terroriste, soit par l’accumulation glossatrice. Les plus « humanistes », ceux qui osent encore se revendiquer de cette appellation délicieusement désuète, ne considèrent plus les œuvres qu’en tant que témoins de « valeurs », cédant ainsi, quoi qu’ils en veuillent, à une forme particulièrement mesquine de la morale : la « moraline » dont parlait Nietzsche et qu’illustra – si l’on ose dire, car il y eut là bien peu de lumière – le sinistre épisode pétainiste qui ne vanta les « valeurs » du travail, de la famille et de la patrie qu’au détriment du Principe qui seul peut, en certaines circonstances rares et heureuses, délivrer ces « valeurs » de leur nature domestique et de leurs caractéristiques souvent ignominieuses.

Ainsi nous trouvons-nous en un pays et une époque où les œuvres, ces songes de grandeur et d’espérance, lorsqu’elles ne sont point mises en pièces par les cuistres « déconstructeurs » sont jaugées à l’aune d’une morale inerte, dépourvue de toute ressouvenance divine. Une morale sans transcendance, une morale qui n’oppose plus à l’infantilisme et à la bestialité de la nature humaine le refus surnaturel ne saurait être qu’un ersatz, une caricature. Tels sont nos modernes moralisateurs, à quelque bord qu’ils appartiennent : les uns, idolâtres du Démos et du Progrès, trouvent l’incarnation du Mal en tout esprit libre qui s’autorise à douter du bien-fondé systématique de l’opinion majoritaire et considère avec scepticisme l’ordalie électorale, tandis que les autres fourvoient et profanent leur intransigeance en d’infimes combats pour « l’ordre moral » au-dessous de la ceinture. Aux uns comme aux autres, le Logos est inutile et même hostile. Ces moralisateurs sans morale, plus soucieux de leur conformité à la bien-pensance, à l’approbation de la secte dont ils sont les débiteurs, que de la vérité qu’ils défendent avec une sorte de mollesse hargneuse sont aux antipodes de Nietzsche et de Bernanos qui nous enseignent à penser contre nous-mêmes et les nôtres.
Tout engagement digne des belles exigences du fanatisme éclairé se devra poser, en préalable à ses mouvements, ce propos de Bernanos : « Je crois toujours qu’on ne saurait réellement servir, au sens traditionnel de ce mot magnifique, qu’en gardant vis-à-vis de ce que l’on sert une indépendance de jugement absolue. C’est la règle des fidélités sans conformisme, c’est-à-dire des fidélités vivantes. » Le Verbe est le principe de cette fidélité nécessaire, car au-delà des formes qu’il engendre, il porte ceux qui le servent au cœur du silence embrasé dont toute parole vraie témoignera. Que les querelles intellectuelles ne soient plus aujourd’hui que des querelles de vocabulaire et les « intellectuels » – par antiphrase – des babouins se jetant au visage l’écorce vide des mots idolâtrés nous laisserait au désespoir si nous ne savions de source sûre, de la source même de Mnémosyne, qu’il n’en fut pas toujours ainsi.
Et s’il n’en fut pas toujours ainsi, il y a de fortes chances qu’il n’en sera pas toujours ainsi : patientia pauperum non péribit in aeternum. Et s’il n’en fut pas toujours ainsi, peut-être est-ce précisément parce qu’il n’en sera pas tou-jours ainsi.
« Le temps n’existant pas pour Dieu, écrit Léon Bloy, l’inexplicable victoire de la Marne a pu être décidée par la prière très-humble d’une petite fille qui ne naîtra pas avant deux siècles. » Les ennemis du Verbe ne s’évertuent si bien à nous ramener au temps linéaire que pour donner à leur refus d’interprétation l’apparence d’une vérité absolue et préalable. Une raison médiocrement exercée peut s’y laisser prendre, mais non le chant dont l’ingénuité porte en elle la vox cordis et la très humble prière.
Luc-Olivier d'Algange
13:41 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : plotin, néoplatonisme, luc-olivier d'algange, philosophie, grèce antique, antiquité grecque, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Luc-Olivier d'Algange
Intempestiva sapientia 2
Depuis la Révolution française, les meilleurs écrivains sont des héros. Tant d’efforts pour perdre la considération sociale, pour se déclasser, devenir pauvre, se faire insulter par les cuistres et les bien-pensants. Le monde moderne est ordonné de telle sorte à récompenser l’incompétence, la vilenie, - et par dessus tout l’ennui et la soumission. Rien d’étonnant à ce qu’une civilisation périclite en accéléré.
La Monarchie était sensiblement mieux une république que ne le sont nos démocraties. Plus nos démocraties liquident l’héritage royal et plus elles s’éloignent de la res publica : on s’afflige d’avoir à énoncer, contre l’opinion générale, de pareilles évidences.
Ce qu’il est devenu presque impossible d’être, dans la disparition de la Geste française : Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan. Alexandre Dumas, à présent, serait interviouvé, à longueur d’émissions « culturelles » sur ses origines ethniques, sur sa difficulté à s’intégrer dans la culture française, sur son « droit à la différence ». En perdant la France, nous ne perdons pas seulement une nation, une subjectivité collective mais l’espace d’une façon d’être illustrée par ces héros de roman. Rabougrissement de l’entendement humain lorsque l’argent, le chiffre, la quantité prennent la place des Saints, des héros et des légendes. La raison s’étiole en même temps que le merveilleux.
Les Modernes délogent en coupe réglée les lieux qu’ils s’approprient en expropriant leurs hôtes légitimes. Tout ce qui tombe en leur pouvoir devient fantomatique, anonyme, désorienté. Le reste est laissé à sa fonction de décor pour touristes, monuments historiques ravalés, tristes muséologies. Il n’est pas dit cependant que nous serons submergés par ce nulle part. Nous reprendrons tout au début, à l’instant de l’arc-en-ciel, de l’apparition, nous inventerons n’importe où l’espace à notre mesure. Ce que le monde désacralise, rien, sinon une mauvaise timidité, ne nous interdit de le sanctifier.
En ces temps utilitaires, chacun considère autrui exactement selon l’utilité qu’il peut avoir pour lui. S’ensuit un régime d’exploitation, de bétaillisation et d’extermination.
Les humains qui pensent qu’être humain est la vertu suprême me semblent frôler un certain ridicule dans le narcissisme.
L’hybris à modifier son environnement, à changer les choses de place, avant précisément qu’elles prennent leur place, voici la planification contre l’harmonie, le néant qui outrecuide au détriment de l’être.
Ma chance est étroitement liée à mon risque. Tout ce qui me fut offert d’heureux, jusqu’aux degrés où le bonheur semble presque irréel, que nous n’y pouvons croire, me fut toujours donné à mes risques et périls. C’est aussi une question d’instinct : prendre la tangente sitôt que l’on voudra vous installer dans un de ces contextes propices au suicide que le monde moderne s’ingénie à multiplier au grand bénéfice de la communication générale. Au regard des conditions qui sont faites à la vie, on s’étonne que les gens ne se suicident pas davantage. Un nerf les tient, un vice, une habitude. Tout être doué d’une minimale compassion humaine devrait rendre au vice, qui tient en vie les malheureux, un sincère hommage. Les moralisateurs s’exposent à être jugés moralement comme des êtres sans compassion ni bonté. Ce qu’ils sont d’ailleurs, de toute évidence ; envieux, par surcroît, jusqu’à la folie, des plaisirs qu’ils se refusent.

Ce début d’automne est d’une douceur profondément érotique. Chaque heure est douce et fraîche comme une blonde peau d’amoureuse. La saison et mon corps s’effleurent avec bienveillance ; nous nous voulons du bien.
Les démons arpentent désormais le monde en tous sens, et à grande vitesse, en « messageries instantanées ». Plus le temps de les voir venir ni de frontières sacrées pour les contenir. De même pour les barbares ; l’arme du barbare moderne étant la haute technologie. La technique comme vecteur de la magie noire, de l’obscurantisme, de la destruction de la raison.
A la magie noire s’oppose la magie blanche. Blancheur frémissante de toutes les couleurs. Couleurs de la république Larbaud, je vous aime : jaune, bleu, blanc, plages parfaites, terres tournées vers la mer ou l’océan. Portugal, visage de l’Europe découpé sur l’infini et recevant la puissance du Grand Large. D’un « rien qui est tout » comme disait Pessoa, nous saisissons soudain qu’il est impossible d’être plus heureux que nous le sommes à cet instant.
On trouve moins de vérité dans l’exégèse du malheur que dans celle du bonheur, d’autant que l’exégèse tourne souvent à l’éloge, sinon à l’apologie.
Si pleine de vertus incalculables, calmes, vives, iridescentes, voyantes, chaque heure se propose et nous en disposons pour le pire ou le meilleur. On se pose, le monde s’anime. On s’agite, le monde se fige. Les plus agités ont la vue du monde la plus figée, la plus schématique. Les contemplatifs voient tourner le monde, orbes entre l’intérieur et l’extérieur, le visible et l’invisible. L’illusion néfaste d’agir sur le monde alors que c’est toujours le monde qui agit sur lui-même, avec toutes sortes d’intercessions, dont la nôtre. L’action unilatérale sur le monde et sur autrui ne peut être que de destruction. Les plus ivres de pouvoir le savent : détruire est leur seul pouvoir ; ils s’y acharnent jusqu’à leur propre destruction. Le nihilisme ne serait ainsi qu’une mauvaise volonté de puissance, une subjectivité outrée, un refus de recevoir des influences. (Ces imbéciles qui se refusent à lire Proust, Musil ou Hamsun parce qu’ils veulent, eux, écrire un roman et ne pas subir d’influence !).
L’utilitarisme obtus et parcellaire du religieux (son fondamentalisme) est certes odieux mais il n’est jamais qu’un aspect de l’utilitarisme global du monde profané qui donne à chacun cette mauvaise foi et ce bon droit usurpé. Aux uns le narcissisme collectif. Aux autre la devise : « Je ne lègue rien, je consomme ». Aux uns et aux autres, l’impiété.
Rendre à la fidélité, à l’honneur, à la ferveur, à la piété, puissances invisibles, leur solennité légère.
Mot à la mode : « respect ». Dans respect, il y a crainte. Plus que jamais les hommes ne respectent que ce qu’ils craignent, ou dont ils attendent des faveurs, dont la principale est l’argent. La force même s’est entièrement liquidifiée. Argent, force liquide. La civilisation dégouline. Sentiments dégoulinants, flaques répandues de la puissance financière. Le monde moderne s’étale. Règne des étalages.

Entre le bredouillis et la vocifération, de nouvelles générations tentent l’impossible retour à l’animalité sous l’œil bienveillant des clercs qui discernent là une nouvelle « culture urbaine ». Tout cela est immédiatement commercialisé avec l’aval des démagogues, les dates de péremption jouxtant au plus près celles de la production.
L’érotique de la belle phrase, chez Gautier, Pierre Louÿs, les Parnassiens, certes, mais aussi, bien en amont, dans l’histoire de la littérature française. Vivacités, suavités, forces, - toute une beauté qui semble superflue à la communication, comme sont inutiles à la reproduction la plupart des gestes érotiques. D’où cette puritaine défiance pour la beauté de la phrase que l’on trouve chez les militants, les idéologues : en littérature, ils sont adeptes de la position du missionnaire. Surtout pas d’extravagances. Réduction du vocabulaire, restriction de la syntaxe, la plupart des critiques littéraire, dans l’esprit du temps, puritain, sont devenus gardes-chiourme. Pour eux, les écrivains sont trop écrivains, la littérature trop littéraire, les phrases sont trop des phrases. Tout cela devrait être réduit à des « messages » qui s’abolissent dans ce qu’ils communiquent. Mais qu’en est-il alors du vent qui souffle sous les étoiles ?
Arrogance du Médiocre imbu de sa médiocrité, et du nombre qu’elle représente, comme aucun homme ne le fut jamais de son génie et de son œuvre. Joie de l’avilissement et de la mort. Ceux qui veulent gagner en ce monde prendront inévitablement le parti de la mort, ultime gagnante. D’où leur acharnement à nier la surnature et l’immortalité de l’âme. Leur ambition ici-bas : que la vie soit déjà à la ressemblance de la mort telle qu’ils l’imaginent.
On dit que l’enfer est pavé de bonnes intentions, mais en réalité, une seule seconde d’attention suffit à nous montrer que ces intentions étaient déjà mauvaises au départ. L’égalitarisme engendre le conflit, non seulement avec les hiérarchies (qui, en général cèdent la place avec une facilité déconcertante) mais surtout, une fois installé, entre les plus ou moins nivelés, qui auront toujours les dents découvertes, non pour rire, mais pour mordre. La hiérarchie est seule également pacificatrice et bienveillante pour le supérieur et l’inférieur. Il y a dans l’égalitarisme un mauvais infini qui demeure toujours altéré d’un pouvoir qu’il n’a pas. Soif inextinguible : d’où les extrêmes disparités de fortune et de pouvoir que l’on constate dans les démocraties libérales ou, naguère, « populaires » dont la vocation fut d’empêcher le bonheur de l’intelligence et les formes de vie supérieure qui sont, ontologiquement, offertes à chacun.

La plupart des sceptiques modernes qui déclarent ne croire en rien, en réalité croient à n’importe quoi, selon la mode, et ce n’importe quoi est, finalement, toujours la même chose.
Pensée la plus courte : « Je crois en l’homme ».
Tant de croyances interchangeables dans le monde comme il va, que l’on commence à comprendre à quel point le scepticisme est un art difficile et probablement réservé aux théologiens apophatiques. Celui qui ne croit pas, c’est, en général, toujours au nom de quelque chose. Qu’est-ce qui nous permet de ne pas croire, sinon Dieu ?
La méthode commerciale, style « force de vente » appliquée à l’art, l’amour, la pensée, est une façon de se « libérer » de l’art, de l’amour et de la pensée pour se donner tout entier à l’avilissement, là où plus rien ne se distingue. La confusion générale est l’antipode de l’Inconditionné. Entre les deux, des nuances, des destinées humaines, des défaites et des victoires. La mystique de la confusion est pouvoir. La métaphysique de l’Inconditionné est autorité.
Le propre de la bêtise est de se constituer en meutes dont chaque membre est susceptible de devenir la victime des autres.
Toutes les idéologies sont de table rase ; les unes avec plus d’hypocrisie que les autres, la muséologie y remplace la destruction, le gel s’y substitue au ravage. La création poétique est mémoire, présence du passé, présence, éternité, flèche du temps, mais verticale. Ce qui est au centre est en haut.
Les hommes qui ne se hiérarchisent pas s’épuisent dans l’idolâtrie et dans la haine. Ils sont à plat. Rien n’y peut fleurir en beauté et en bonté. Ces prétendus philanthropes, optimistes déçus, finissent dans l’exécration du genre humain, ou, pire encore, dans l’exécration de tel ou tel sous-ensemble, de classe, de race ou de religion, du genre humain.
L’idée royale fut longtemps, et bien au-delà de son institution politique, la sauvegarde, pour chacun, d’une souveraineté intérieure. Il en demeure, ici et là, des places royales : celles de nos sagesses, de nos amours, irrécusables épiphanies qui s’enracinent dans le ciel comme les branches d’un éclair.
La seule égalité souhaitable est l’égalité d’humeur. L’équanimité et la politesse suscitent dans l’enfer social d’inexpugnables places pour le colloque paradisiaque des âmes heureuses. Ici et là, une rencontre, une conversation, suffisent à sauver le monde, ou, mieux encore, à le justifier.

Dans la comédie sociale, seuls se font entendre les singes hurleurs. Une page écrite est laissée à la voix de celui qui la lit : préséance accordée à l’hôte.
Vouloir se faire entendre, c’est déjà consentir au malentendu. S’éloigner peu à peu du désir de convaincre, se délester du pouvoir que l’on a de persuader : long chemin de solitude qui va de la conviction à la pensée, et de celle-ci à l’impondérable de la « montagne vide ».
La plupart de gens qui apprennent que vous avez publié un livre, avant même de vous demander de quoi il parle, vous demandent sous la couverture de quel éditeur il a été publié. Pour ceux-là, il y a primauté de l’emballage sur le contenu.
Nous ne reprochons pas à la vulgarité d’être vulgaire, mais d’être totalitaire, et de répandre partout « un vacarme silencieux comme la mort ». Une vulgarité à sa place serait presque rafraîchissante. On en viendrait à l’aimer de ne s’exercer que dans l’espace qui lui est dévolu. Elle se laisserait visiter avec un léger plaisir comme une contrée exotique. Hypothèses, rêveries… La réalité est un armée noire qui marche sur nous, dotées de toutes les puissances modernes, et ne trouvera en face d’elle que les rêveurs, armés de fleurets, disposés à mourir pour la beauté du geste.
Toutes les causes sont historiquement perdues, sauf celle de l’avilissement. Mais la plus perdue de toutes les causes perdues est aussi celle qui s’approche le plus de la victoire surnaturelle. Victoire essentielle et immédiate : lorsque la fin ne justifie plus les moyens. Les causes perdues sont un peu moins perdues qu’on nous le voudrait faire croire.
Le fabuleux, le mystérieux, l’enchanteur, l’extraordinaire sont dans le regard bien davantage que dans les choses regardées. A certains, tout est ennuyeux et banal. Ils traversent le monde de long en large, en touristes blasés. Leurs sens sont émoussés en conséquence de l’inertie de leur pensée.
Vie moderne : chercher des réponses à des questions ineptes ou mal posées et trouver des solutions à des problèmes qui n’existent pas. Le Moderne se gargarise de « problématiques » précisément parce qu’il est le moins apte à saisir la nature problématique de la vie (jadis figurée par les épopées, les mythes, les tragédies).
Chaque jour me propose ses raisons de vivre absolues et particulières. Je n’attends pas d’une abstraction ou d’une nécessité la force de me mouvoir.

Les êtres et les choses ont pour point commun d’être uniques. Les jours se ressemblent par leur diversité. Il en va de même des heures et des minutes, et des secondes. Si vous vous ennuyez, n’accusez que vous, ou le monde ennuyeux auquel vous collaborez.
Seuls sont à l’honneur de Dieu, et de l’infini de sa création, les actes gratuits. L’immense gratuité de la création inquiète et scandalise les calculateurs, les impies. Une religiosité utilitaire obture sa source. Le reproche moralisateur adressé à l’inutilité est une négation du bien, de la bonté même qui agit sans contreparties ; sans quoi elle ne serait que calcul. L’inutile est l’Essentiel.
L’efficacité à court terme est au détriment du rayonnement. Les œuvres qui trouvent immédiatement leur place dans leur temps disparaissent avec lui. Le rayonnement d’une pensée, d’un acte, d’une œuvre, d’un moment, tient à la conception du temps, non plus linéaire mais sphérique. Ce qui rayonne ne poursuit pas un but mais va d’un point central à tous les points proches ou lointains dans une communion essentielle, pour la seule gloire. La logique, si dénigrée en cet temps d’émotions faciles, opère, elle aussi, en mode rayonnant. Au cœur est le silence du Logos, ou du Verbe, que l’on rejoint, en partant d’une quelconque périphérie.
On distinguera deux façons de voyager. L’une moderne, touristique, fuyante, qui va vers la périphérie, le lointain, l’exotique et l’exotérique. L’autre, initiatique, qui va, quittant la périphérie, vers le centre.
Les humains, en proie à leurs ressassements utilitaires, passent à côté les uns des autres comme ils passent à côté des paysages et des œuvres. On comprend que les misérables soient accablés par la gestion de leur quotidien, on le comprend moins de la part des repus.
Nous ne cherchons pas à convaincre. Nous allons en paix. Il est trop tard pour nous faire taire. Nous vivons dans l’amitié de la lumière changeante. Ce sont les changements de la lumière qui écrivent à travers nous.
Je n’aime pas le passé ; j’aime ce qui est présent du passé ; vertus claires, immémoriales, fidélités, droitures, mais aussi ombrages et secrets.

Prendre chaque jour un moment pour prendre le diapason, - c’est-à-dire la mesure de sa fragilité et de la fragilité de tout. La valeur des êtres tient à ce qu’ils peuvent succomber à tout moment.
La frugalité est un principe hédoniste. La quantité est toujours restrictive. Le bourrage moderne (d’informations, de biens de consommation) suscite non seulement le dégoût mais exerce une action directement privative. Exemple : plus il y a d’êtres humains réunis en un seul lieu et moins ils échangent. Plus nombreux sont nos interlocuteurs et moins nous recevons d’eux, et inversement, moins ils reçoivent de nous. Communication de masse : assommoir.
Quelques politiciens auto-déclarés « libéraux » se firent une idéologie de ce mot d’ordre inepte : « Gérer la France comme une entreprise » alors que cette formule est une parfaite définition du communisme appliqué et l’expression même de l’abus des prérogatives de l’Etat. La France a été tant et si bien gérée comme une entreprise, qu’elle se trouve ruinée, et pas seulement d’un point de vue économique. Nous voici dans ce cas de figure où ce qui est utile à la « société » (conçue de plus en plus comme société anonyme) est en réalité nuisible au Pays. Mais il se trouve hélas de moins en moins de politiciens pour faire encore la différence entre la société et le Pays, moins encore pour concevoir une fidélité à leur pays qui dût être hiérarchiquement supérieure au service de la société.
Un pays : une réalité historique, sensible et intelligible, une poétique de l’espace, des légendes, une tradition. La société est une abstraction anonyme, aux agissements obscurs. La société conduit une guerre civile impitoyable contre le pays. Tout pays est un royaume.
L’utilitarisme économique est le siphon où disparaissent toutes les formes élémentaires de la dignité, de l’honneur, de la grandeur d’âme, et avec elles, la nature elle-même ; comme il est parfaitement logique que la nature soit souillée à la suite de la spoliation de la surnature.
Lorsque l’on considère, en logique « sociale » que certains hommes sont plus utiles morts que vivants, on les tue. Dans les sociétés moins ingénues, plus retorses, on commence par les réduire à la misère et leur ôter la parole. Donner comme horizon d’espérance la « croissance économique », c’est non seulement ôter toute espérance, c’est le faire d’une façon particulièrement insultante.
Une société soumise à l’utilitarisme économique s’évertue non à s’enrichir mais à créer les conditions où chacun se trouvera contraint et forcé à ne penser qu’à s’enrichir. Ce qui implique la réduction de tous les espaces d’autarcie, de luxe, de liberté et de bonheur. L’intelligence humaine s’en trouve extraordinairement rétrécie.

La disparition de certaines facultés de l’entendement humain a ceci de fatal qu’une fois disparues, nul ne se souvient qu’elles furent naguère exercées. Nous assistons à l’installation progressive d’une infirmité normative. La logique décline en même temps que la perception sensible. Tout se ramasse en des émotions primaires (peur, convoitise) dont les politiciens et les publicitaires indistincts usent à loisir. La réduction du spectre du sensible et de l’intelligible rapproche l’homme de la machine dont il convoite les pouvoirs.
La haine des nuances est au principe de l’utilitarisme : haine des nuances qui ralentissent l’action, ouvrent sur la contemplation « des nuages, là-bas, là-bas, les merveilleux nuages ». Dans le monde moderne, toute homme de nuance, de tradition, est un « extraordinaire étranger ». On peut encore différencier quelque peu les sociétés selon l’accueil qu’elles réservent à cette sorte d’étrangers, dont l’étrangeté est d’autant plus radicale qu’ils n’ont pas quitté leur pays ; c’est leur pays qui a été chassé autour d’eux, et ils en demeurent les ultime témoins.
Toute la difficulté consiste alors à ne pas dramatiser la situation, à garder sa désinvolture comme l’un de ses biens impondérables.
Etre équanime est parfois, pour la pensée et pour l’âme, une simple question de survie.
Lorsque le dévergondage du pathos et de l’outrance envahissent le politique, les temps sont venus de rejoindre « l’ermitage aux buissons blancs » dont parlait Ernst Jünger. Le désengagement s’avère être un engagement supérieur. L’intelligence, le calme, la beauté, disposent l’âme à des noces plus ardentes.
Deux pôles politiques se dégagent peu à peu du chaos. L’un va vers la société anonyme, l’autre vers le Royaume. Le choix nous appartient. Ne cédons pas à la ruse la plus éventée des idéologues qui consiste à nous faire croire que ce qu’ils souhaitent est déterminé, et qu’il ne nous reste plus qu’à suivre, bon gré mal gré, le courant « comme un chien mort au fil de l’eau ». Le déterminisme est une coquecigrue d’irresponsable.
Le monde moderne est entièrement voulu. Ce qui fait sa force et sa faiblesse. Rien en lui ne correspond à l’ordre des êtres et des choses. La discordance ne domine l’harmonie qu’un temps donné.
Le pathos agrège, abolit les distances et les déférences. Or toute civilisation se mesure aux distances qu’elle instaure entre les individus. La « communication » qui abolit les distances est une barbarie. Intrusion, promiscuité, grégarisme, meutes, pogroms. Les hommes partagent plus communément leurs haines et leurs craintes que leurs bonheurs. Quant à l’intelligence et à la sapience, elles ne se communiquent pas, elles se transmettent.

Etre distant : condition de la dignité réciproquement reconnue. En-decà d’une certaine distance, le regard ne s’ajuste plus, autrui ne nous apparaît plus que d’une façon troublée, partielle, dans un « gros plan » monstrueux.
S’éloigner, rendre hommage au lointain du monde en nous-mêmes et dans la rencontre. L’échange des regards, des lointains qui se croisent, intersections d’infinis, ténèbres antérieures de la pupille qui se souvient, pour l’accueillir, d’un « avant » de la lumière, d’un « fiat lux » en amont de toutes les temporalités.
Etre présent, c’est venir, advenir du lointain infini de la présence. Adsum, me voici, dans le moment présent, comme un éclat d’écume, une promesse.
« Je ne peux rien vous promettre », formule de banquier, d’agent immobilier. A l’inverse, les politiciens abusent de la promesse. Ne sont dites que les promesses dont chacun sait qu’elles ne seront pas tenues. On ne tient bien que les promesses non-formulées. Celui qui tient une telle promesse entre déjà, d’un pas victorieux, dans le monde surnaturel.
Venir de loin, pour apporter une provende scintillante, et repartir avant d’être remercié.
L’optimiste croit que le monde de l’avenir vaudra mieux que ceux du passé ou du présent qu’il fera disparaître. Le pessimiste croit que les mondes disparus valaient mieux que ne vaudront les mondes futurs, mais avec l’avantage logique que ce qui existe, ne fût-ce que dans la mémoire, vaut mieux que ce qui n’existe pas, et mérite davantage notre déférence. L’un et l’autre, cependant, n’en demeurent pas moins des nihilistes, et non des fondateurs.
La raison d’être du Politique, au noble sens du terme, est de disposer le monde en faveur de la poésie. Les règles politiques, lorsque la politique n’est pas subjuguée par l’économie, sont de l’ordre de la prosodie. Il appartient ensuite au génie des individus ou des peuples d’exalter cette prosodie en poésie. Les subtiles règles du sonnet, certes, valent ce qu’en font les poètes ; mais ce qu’ils en font est irrigué par les puissances du langage lui-même dont la trame se révèle dans la poétique apprise ou transmise. La beauté créée est un tout supérieur aux parties qui la composent. L’auteur, la science de la langue, le monde conjurent au resplendissement d’une vérité qui les outrepasse.
D’où la vanité d’avoir quelques aperçus pertinents sur une œuvre à partir de considérations psychologiques ou sociologiques concernant l’auteur. Vanité et même aberration, dès lors que l’on réduit le coquetèle à l’une de ses composantes.
Imbécillité, par définition, des spécialistes, des experts. S’étonner de leur imbécillité, c’est encore ne rien avoir compris à la question. Mesurer le désastre du monde qui leur est confié. Notre chance est qu’ils se contredisent et que leurs expertises s’annulent.

Tout est si parfaitement organisé pour nous rendre fous et possédés que la seule survivance de quelques individus débonnaires et aimables suffit à nous combler d’un sentiment de victoire. La puissance de certaines vertus se mesure aux forces adverses, auxquelles elles résistent. La simple politesse nous laisse croire en l’héroïsme, la simple bonne foi révèle la grandeur d’âme. Un seul geste de bonté, ignoré de tous, sauve le monde.
Dans la société anonyme, plus nous gravissons les échelons et moins nous sommes tenus pour responsables de ceux qui sont sous nos semelles.
Le luxe dans la frugalité : nous ne jouissons que de ce dont nous pourrions nous passer.
L’idéologue moyen voudrait nous regarder de haut, mais il ne peut que nous regarder de travers.
Je n’écris pas pour mon compte.
Lorsqu’il y a trop de raisons de se tirer une balle dans la tête, l’acte n’en vaut plus la peine.
Nos ennemis nous veulent à leur ressemblance : pleins de rancœur, rongés par cet « ulcère de l’âme », l’envie. Ils nous taquinent en espérant susciter en nous le même sentiment de grief qu’ils éprouvent pour nous, et qui les ronge. La fascination que nous exerçons sur ceux qui nous haïssent voudrait une réciprocité, une contrepartie. Ceux qui n’ont presque plus de raison veulent nous la faire perdre : prosélytisme de toxicomane, - ce qui rend tout prosélytisme suspect. Veut-on nous faire partager un bienfait ou une tare ?
Dans le prosélytisme religieux, idéologique, la pression morale s’exerce presque toujours pour nous faire renoncer à un plaisir des sens ou de l’intelligence, et perdre notre désinvolture. La joie est, chez ces gens-là un argument contre. Plus honnêtes hommes sont les écrivains qui racontent, pensent, poétisent, suspendent leurs jugements et font de leurs tristesses mêmes le principe d’intenses joies artistiques.
L’époque moderne, prétendument « éclatée », festive, libérée est la mieux étouffée par un prosélytisme maniaque, lancinant et sinistre dont les saturnales elles-mêmes ne sont plus que l’expression commerciale et bien-pensante.
Entre la fête dionysiaque antique ou médiévale et la fête moderne, la différence est que l’une était en contrepartie de l’ordre apollinien ou théologique, un suspens, alors que l’autre est l’expression bruyante de l’ordre établi.
Le totalitarisme advient lorsque les saturnales ne sont plus retournement de l’ordre mais son prolongement, lorsque l’ordre est plat, pure planification, sans avers ni envers. Idéologie dominatrice, sous les aspects divers, en apparence contradictoires ; extraordinaire puissance des sucs gastriques pour dissoudre et digérer les subversions, et qui ne trouvera, en face, d’elle que de calmes adeptes des causes perdues. Nous soulignons le calme car tout énervement nous prive de notre nerf, de notre force nerveuse et nous fait glisser en tous sens sur des surfaces planes disposées à cet escient : faire de nous des êtres de nulle part dans un relativisme général. Le plan, au demeurant, est incliné. Il nous verse dans une indistinction semblable à la mort.
Les merveilleuses croyances où les hommes continuent à être distingués après leur mort apparaissent comme une riposte à la toujours menaçante indifférenciation des vivants. Si nous ne sommes pas interchangeables après la mort, l’honneur de la vie est sauf.

Quand bien même ne penserions-nous jamais à la postérité, il n’en demeure pas moins qu’une pensée écrite est sauvée du périssable de notre carcasse. Elle ne l’est pas lointainement, mais tout de suite. Ecrite, ou dite, à quelqu’un qui s’en souviendra, une pensée instaure une autre temporalité, ou, plus exactement, elle révèle une profondeur du temps, une réverbération d’éternité. Cette éternité est toute vive, jeune et frémissante, une apogée de l’Eros, exercée par le Logos.
Après avoir traversé un certain nombre de pays, en flâneur et contemplateur, et non en touriste, après avoir rencontré, en chair et en esprit, maintes personnes dans les milieux les plus divers, il reste que la lecture de certains livres me fut une belle et grande aventure, et je plains ceux qui sont passés à côté.
Logique du règne de la consommation : ne laisser aucun héritage, et si, possible, détruire tout héritage, y compris l’héritage naturel. Le discours bourdieusien contre les « héritiers » conduit à l’apologie du règne de la consommation. S’il n’est plus aucune supériorité héritée, il appartiendra à l’argent de donner à chacun sa place. L’héritage implique des devoirs. La fortune faite se croit tous les droits, jusqu’à la plus infâme goujaterie.
Il suffit d’une seule génération amnésique pour perdre l’héritage de plusieurs millénaires de civilisation.
A la « haine du secret » dont parlait René Guénon, s’ajoute la haine de la complexité, des espaces libres, éclairés ou ombreux. Notre inclination à la servitude volontaire répugne à tous les exercices que ces espaces rendent possibles. C’est ainsi que la servitude préfère vivre dans une société plutôt que dans un pays, peuplés de noms de pays, de libertés et de franchises héritées. Cependant, ne nous crispons pas sur notre dû. Laissons les formes s’évanouir, les richesses prendre d’autres formes. Notre fief, notre château tournoyant est là où nous sommes droits, là où le temps profane entre en intersection avec le temps sacré.
La raison d’être n’a rien de rationnel : elle est une immédiate épiphanie (étant entendu que le rationalisme fut toujours le principal ennemi de la logique).
Musiques d’ambiance, écrans, bruitages, bavardage, despotisme affectif et économique, architecture de masse, - laideurs. Tout est matériellement mis en œuvre pour éloigner les épiphanies ou les rendre indiscernables. Cet immense chantier quantitatif est vain. L’épiphanie est une qualité qui s’adresse à une qualité.

Nouvelle censure : non plus brûler les livres ou les interdire, mais faire en sorte que nul ne puisse plus les comprendre. Tâche titanesque, que nous voyons à l’œuvre, mais tout aussi vaine. Il suffit d’un seul pour faire la différence entre ce qui est ce qui n’est pas.
Preuve de l’irresponsabilité des politiques et des journalistes : ils instillent la peur qui réduit les facultés intellectuelles et morales, favorise l’agressivité et nous réduit à vivre en bêtes traquées. Toute acte de bonté est presque toujours une victoire remportée sur la peur, de même que toute vilenie en est la défaite. L’adage est juste, la peur est contagieuse. Elle s’en trouve être le principal moteur du grégarisme, des mouvements de foule. La meute des chiens qui ont peur est d’autant plus dangereuse que nous nous en laissons davantage effrayer. C’est en de telles circonstances qu’il faut éviter de fuir ou d’attaquer.
Mais plus encore qu’à la bonté, la victoire sur la peur ouvre sur la surnature. Encore faut-il que cette victoire ne soit pas seulement une précipitation vers le danger (qui peut être, elle-même, poussée par la peur). Vaincre la peur, ce n’est pas se raidir, c’est apprivoiser tout ce qui se trouve autour de son objet ou de sa cause.
Se mettre en danger, c’est parfois trouver la sente merveilleuse et incertaine qui nous sauve des pires dangers : ceux-là qui participent de nos habitudes et de notre confort.
Pour une âme civilisée par une tradition d’honneur, de fidélité et de bon-goût, la crainte de la mort vient au second plan. Toute vie qui ne peut se sacrifier ne vaut d’être vécue. Il est probable que toute vie soit sacrifiée, toujours et pour chacun, y compris aux raisons les plus futiles, aux illusions les plus funestes. L’égocentrique sacrifie sa vie à son ego, de façon aussi radicale que le patriote sacrifie sa vie à la patrie ou le poète, à son œuvre. La différence est dans la nature du feu sacrificiel, la beauté des flammes, et le parfum des essences. Les vies sacrifiées à la cupidité puent et crapotent. D’autres flammes, plus hautes, éclairent et embaument. Quoiqu’il advienne, nous serons sacrifiés, mais nous revient la liberté souveraine de choisir notre sacrifice.
Tout profaner pour éviter ce choix, c’est se précipiter dans le vide par crainte de l’abîme et choisir finalement « l’ abîme de la nuit » contre « l’abîme du jour », pour reprendre la distinction de Raymond Abellio. La règle des ricaneurs, à cet égard, est aussi rigoureuse que celle de Saint-Ignace de Loyola : ils obéissent comme des cadavres à la mort qui est leur seul horizon. Ceux qui ricanent de tout vivent dans un monde d’une effrayante tristesse.
La vie humaine, une alternance de combats et d’épiphanies : le reste est faux-semblants.
14:22 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
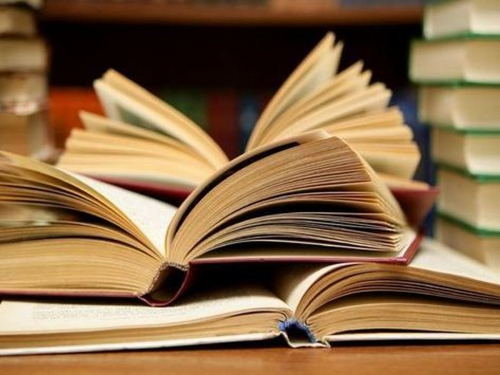
Trois notes de lecture de Daniel Cologne
Jean Rogissart : une saga ardennaise
par Daniel COLOGNE
Il y a le cycle des Rougon-Macquart d’Émile Zola, celui des Salavins de Georges Duhamel, des Thibault de Roger Martin du Gard. La littérature française est traversée par un courant romanesque où l’objectif de l’écrivain est d’embrasser l’histoire d’une famille sur plusieurs générations. On en trouve une trace jusque dans les lettres françaises de Belgique, avec Les temps inquiets de Constant Burniaux (1892 – 1975), romancier et poète injustement oublié.
 Jean Rogissart n’est pas totalement méconnu et l’étude universitaire qui lui a été consacrée, à Dijon, en 2014, pourrait être le point de départ d’une reconnaissance posthume bien méritée.
Jean Rogissart n’est pas totalement méconnu et l’étude universitaire qui lui a été consacrée, à Dijon, en 2014, pourrait être le point de départ d’une reconnaissance posthume bien méritée.
L’élection des premiers députés socialistes à Charleville et Sedan vers 1900 inspirent à l’auteur de pertinentes réflexions sur « certaines manœuvres politiciennes » et sur « les dérives bourgeoises survenant même parmi les forces de gauche ».
Tout au long des quatre générations dont Jean Rogissart déroule le parcours, revient le problème « de l’engagement face à ce qui pèse sur l’homme : injustices sociales, guerres », l’obsédante interrogation sur l’attitude qu’il faut opposer aux malheurs qui accablent l’humanité.
Dans le sixième tome intitulé L’orage de la Saint-Jean, Rogissart évoque l’offensive allemande de mai 1940. « Vers minuit on frappe à notre porte; on frappait à toutes les portes. C’était lugubre ces chocs sourds dans le silence. Accompagné du secrétaire de mairie, le garde-champêtre avertissait les habitants. Par ordre supérieur nous devions quitter le village avant cinq heures du matin. Tous les ponts de la Meuse sauteraient alors que les retardataires seraient bloqués sur la rive droite. »
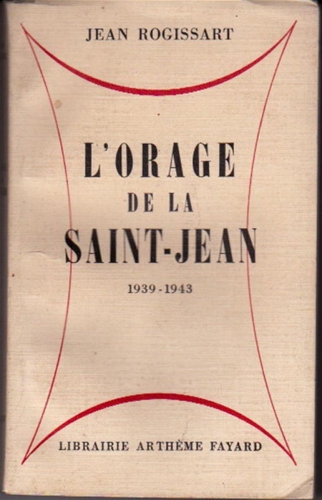
Du point de vue idéologique, le point culminant de cette saga familiale ardennaise se situe dans le deuxième volume, dont le titre Le temps des cerises se réfère à la chanson que Jean-Baptiste Clément aurait composé sur les barricades de la Commune de Paris. Ce dernier est de passage dans la région ardennaise. Mythe ou réalité ? Peu importe, car le socialisme qu’il y propage ne considère pas la religion comme un « opium du peuple ». La croyance en Dieu y est présentée comme l’aboutissement du processus par lequel « l’homme rompt ses chaînes millénaires » et abolit l’esclavage…
C’est à cette condition que la Providence divine devient crédible et le message philosophique de Jean Rogissart couronne une œuvre s’inscrivant dans une des plus riches veines du roman français.
Les trois patries de Louis Quièvreux
par Daniel COLOGNE
Originaire du Hainaut, le militaire de carrière et capitaine – commandant d’infanterie Joseph Quièvreux épouse Marie-Josèphe Vandenotelaar, une corsetière de la banlieue Ouest de Bruxelles. De leur union naît un fils prénommé Louis, le 15 mai 1902. Louis Quièvreux obtient son diplôme d’instituteur à l’école normale Charles-Buis, un établissement bruxellois réputé pour la formation des enseignants de niveau primaire.
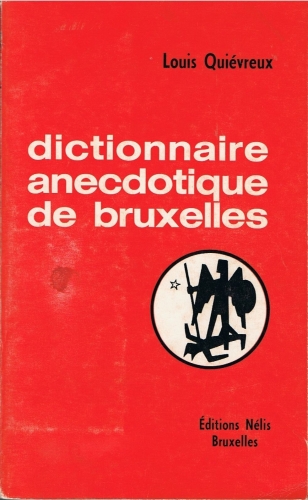
Dès 1924, Louis Quièvreux abandonne l’enseignement et se dirige vers le journalisme où l’attend une fructueuse carrière sous son patronyme et sous le nom d’emprunt de Pierre Novelier. À la faveur d’une place obtenue dans un concours organisé par La Dernière Heure, Louis Quièvreux est enrôlé par le quotidien bruxellois. Il y signe ses premiers billets, où il touche les sujets les plus divers, d’une campagne contre la vivisection à des comptes-rendus de procès retentissants en passant par des notes sur la vie bruxelloise. À partir de 1925, il devient un collectionneur acharné de tout ce qui se rapporte à l’histoire et au folklore de la capitale.
En 1946, Louis Quièvreux est embauché par La Lanterne (aujourd’hui La Capitale), autre quotidien bruxellois pour lequel il recense le procès de Nuremberg. Durant de nombreuses années, les lecteurs de La Lanterne se régalent de la chronique journalière que Louis Quièvreux intitule « Ce jour qui passe » et où il évoque, dans un style mêlant harmonieusement l’humour, la nostalgie et le pittoresque, les multiples facettes du patrimoine populaire bruxellois.
Germaniste polyglotte maîtrisant le néerlandais et l’anglais, Louis Quièvreux donne des conférences sur les ondes de Radio Munich, devient le correspondant européen de plusieurs journaux britanniques et travaille en qualité d’« European reporter », pour la National Broadcasting Corporation de New York (1937 – 1940).
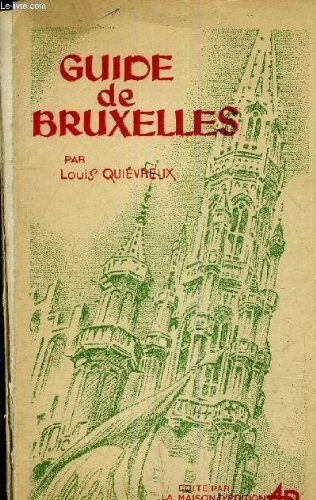 Sa connaissance de la langue de Shakespeare, dont il compile un certain nombre d’extraits, s’accompagne d’une spécialisation, dans l’univers institutionnel britannique, auquel il consacre un de ses premiers ouvrages. Son inlassable curiosité intellectuelle le plonge dans les traditions artistiques d’Espagne. Il se taille une réputation d’érudit en matière de guitare et de flamenco.
Sa connaissance de la langue de Shakespeare, dont il compile un certain nombre d’extraits, s’accompagne d’une spécialisation, dans l’univers institutionnel britannique, auquel il consacre un de ses premiers ouvrages. Son inlassable curiosité intellectuelle le plonge dans les traditions artistiques d’Espagne. Il se taille une réputation d’érudit en matière de guitare et de flamenco.
Louis Quièvreux passe les vingt dernières années de sa trop brève existence à Uccle, rue Henry-van-Zuylen, dans un chalet suisse du XIXe siècle. Il cherche son inspiration au pied de l’impressionnant tilleul qui se dresse au milieu du jardin. Mais une autre maison est aussi chère à son cœur que le Mont des Arts au cœur de Bruxelles, pour reprendre le titre d’un de ses meilleurs livres. C’est la fermette ancestrale de Frasnes-les-Buissenal, le village hennuyer de sa famille. Rongé par la maladie, Louis Quièvreux lui rend une ultime visite vers la mi-octobre 1969. Ce dernier pèlerinage lui inspire un « billet poignant » dans Le Peuple du 22 octobre 1969. « Au revoir, petite maison » paraît sous la plume de Pierre Novelier, dans Le Soir, au lendemain de son décès.
Louis Quièvreux s’en est allé le 19 octobre 1969, avec sa coutumière discrétion, par un beau dimanche ensoleillé où l’inexorable déclin de la nature n’était perceptible qu’au travers d’un léger vent d’automne.
Louis Quièvreux symbolise une quête identitaire citadine (certains quartiers spécifiques de Bruxelles) et revendique en même temps une appartenance à une Europe inscrite dans un triangle géographique pointé sur les Îles britanniques, la Bavière et l’Andalousie. Il illustre l’opulence méconnue du patrimoine littéraire de l’Ouest bruxellois. Bruxelles, la Belgique et l’Europe : telles sont les trois patries (charnelle, historique et idéale) de Louis Quièvreux.
Après s’être illustré dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, Louis Quièvreux entame un quart de siècle d’intense production littéraire, dont voici un aperçu: Flandricismes et wallonismes dans la langue française, L’île anglaise et ses institutions, The Best Extracts from Shakespeare, Guide de Bruxelles, Recueil d’histoires sur le folklore bruxellois, Dictionnaire des dialectes bruxellois, Histoire des enseignes bruxelloises, La belle commune d’Uccle, Les impasses de Bruxelles (en collaboration avec Robert Desart), Anthologie de Couroble, Marolles, cœur de Bruxelles, Le Mont des Arts cher à nos cœurs, Des mille et un Bruxelles, Bruxelles notre capitale.
Bernard Baritaud : le gaullisme en héritage
par Daniel COLOGNE
Né en 1938 à Angoulême, Bernard Baritaud fréquente l’université de Poitiers, la ville où résident ses parents. Il y étudie les lettres classiques, notamment avec le professeur Bardon, dont j’ai moi-même entendu parler en 1966 par un de ses collègues latinistes bruxellois.

Bernard Baritaud vit d’ailleurs actuellement dans la capitale flamande, belge et européenne. Il a toujours entretenu des relations avec la Belgique. Il a publié ses premiers poèmes dans la revue bruxelloise Le Taureau. Il a enseigné à l’école européenne de Mol (Limbourg), un établissement réservé aux enfants des fonctionnaires de la CEE (Communauté économique européenne), selon la dénomination de l’époque. Cette année 1964 marque le début de nombreuses pérégrinations professionnelles qui le conduiront en Grèce et au Sri Lanka.
 Co-auteur de trois romans policiers, Bernard Baritaud peut s’enorgueillir d’une opulente bibliographie où figurent cinq recueils poétiques, des journaux intimes, des livres de souvenirs et un ouvrage de critique littéraire consacré à Pierre Mac Orlan aux éditions Pardès dans la collection « Qui suis-je ? » dont il est un incontestable spécialiste. Balzac, Drieu la Rochelle et Paul Morand garnissent sa riche galerie d’écrivains préférés, sans oublier Stendhal dont Lucien Leuwen est selon lui le chef-d’œuvre.
Co-auteur de trois romans policiers, Bernard Baritaud peut s’enorgueillir d’une opulente bibliographie où figurent cinq recueils poétiques, des journaux intimes, des livres de souvenirs et un ouvrage de critique littéraire consacré à Pierre Mac Orlan aux éditions Pardès dans la collection « Qui suis-je ? » dont il est un incontestable spécialiste. Balzac, Drieu la Rochelle et Paul Morand garnissent sa riche galerie d’écrivains préférés, sans oublier Stendhal dont Lucien Leuwen est selon lui le chef-d’œuvre.
Bernard Baritaud laisse un testament politique paru en 2018 aux éditions du Bretteur. Je me souviens du Général évoque l’exercice du pouvoir de Charles De Gaulle, dont le solde lui paraît « grandement positif », à l’exception du printemps 1962, de la fin tragique de la guerre d’Algérie, du « train fou s’emballant jusqu’à la catastrophe finale pour les Pieds-Noirs ».
Il salue aussi en De Gaulle un « mémorialiste de haute tenue » et il se souvient que lorsqu’il était étudiant à Poitiers, il avait fait encadrer et placer la photo du Général au-dessus de son bureau. Il garde enfin « le souvenir ébloui de la mer des Antilles » et de Pointe-à-Pitre, où il fit son « service militaire adapté », une alternance d’enseignement en civil et de prestation en uniforme, le tout étalé sur une période de vingt-deux mois.
Le style de Bernard Baritaud se colore de lyrisme exotique lorsque revient à sa mémoire le « jaillissement des poissons volants, traits de lumière rasant les vagues aussitôt aspirés par l’écume ».
11:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniel cologne, littérature, littérature française, lettres françaises, lettres, jean rogissart, louis quièvreux, bernard baritaud, folklore bruxellois, bruxelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Luc-Olivier d’Algange
Intempestiva sapientia 1 - pour se déprendre du nihilisme
Dans le monde tel qu’il va, à ce moment particulier de la rotation des castes, nos plus belles vertus se retournent contre nous. Celui qui a confiance sera trahi ; le généreux sera dépouillé ; l’homme poli sera insulté ; le magnanime sera la proie des cupides et des mesquins ; l’équanime sera attaqué par des nuées d’hystériques ; le courageux servira de chair à canon ; le fort sera agenouillé par la coalition des faibles. Les beaux mouvements de l’âme n’en perdent pas pour autant leur raison d’être qui sera la raison d’être de ceux qu’ils animent, leur vérité ontologique, leur vrai, leur beau et leur bien.
Edicter le « droit au bonheur », c’est en ôter à tous, la chance magnifique, la beauté inespérée.
Fausseté, ou obsolescence des théories bourdieusiennes : la haute culture européenne est désormais l’apanage des castes dominées, expropriées, insultées. Le plus subtil, le plus fervent, le plus lumineux lecteur d’ Homère est un gueux.
Le perfectionnisme du Moderne. Son incapacité physiologique à supporter le contretemps, l’usure du temps, son goût du lisse, du neuf, du planifié, de l’inodore et de l’incolore. Il voudrait que la vie soit aussi peu surprenante que la mort (telle qu’il l’imagine dans son agnosticisme confortable). Par absence de sens des nuances, le Moderne vit dans l’alternative de l’ordre policier et du désordre établi. Il ne comprend pas que certaines choses doivent être laissées au désordre, qui est leur ordre naturel, et que d’autres s’ordonnent naturellement par le haut, c’est à dire par la surnature, en décantations et gradations successives.

Le bonheur n’est pas un état. A chaque instant nous avons le choix de saisir ou non tel aspect du resplendissement universel.
« Avoir de la culture », - formule qui tombe de la bouche de ceux qui, généralement, n’en ont pas. Le mot « culture » est devenu presque inutilisable, sauf à raviver son étymologie végétale. Laissons à leurs illusions sociologiques ceux qui lisent « pour se cultiver ». Seules importent les œuvres, ces rencontres manquées ou décisives. J’aime un livre, j’entre en conversation avec un esprit. Celui-ci m’enchante, m’irrite ou m’éclaire ; il me fait entrer dans un monde, il change ma perception du temps. Quelle insulte faite à ce présent magnifique si je ne le lisais que pour « l’avoir lu », pour « avoir de la culture » !
Si peu de gens savent lire parce que si peu de gens savent céder la parole. Devise du Moderne : « Pourquoi s’intéresser à telle œuvre d’il y a un ou vingt siècles : l’auteur ne pensera jamais rien de nous, nous lui sommes, tard venus, à jamais indifférents »
Il faut, en général, quelques décennies pour apprendre à lire, c’est-à-dire à ne pas seulement compulser, piller ou utiliser un écrit à des fins dérisoires, journalistiques, universitaires ou idéologiques. Quelques décennies pour retrouver le juste plaisir que nous avions, enfant, à lire les aventures d’Arsène Lupin ou Les Voyages Extraordinaires.
Un bon lecteur doit savoir se taire, attendre, être attentif, disposer d’une certaine faculté de disparaître dans ce qu’il lit, pour se retrouver ailleurs, comme après avoir été porté par un courant invisible. L’attention doit n’être pas seulement analytique et déductive, mais aussi analogique, en figure rayonnante, rosace.
Preuve de la perte du sens harmonique, de la « musique intérieure » dans notre langue natale : les nouvelles traductions (entre autres de Joseph Conrad) comparées aux plus anciennes. Les phrases veulent dire à peu près la même chose, mais les unes disaient ce que les autres bafouillent dans un amas d’imprécisions, de lourdeurs, de confusions et d’impropriétés. Enfin, nous ne voyons plus ce que l’auteur voulait nous faire voir. Ces nouvelles traductions pèchent autant par méconnaissance de la langue de destination que par incapacité à entrer dans le vif du sujet, dans la pensée et dans la vision de l’auteur. La superstition du mot à mot oublie que chaque langue dispose de sa mosaïque propre et que l’interprétation est, en traduction, aussi nécessaire que dans le déchiffrement d’une partition musicale.

Deux bonnes raisons d’écrire. L’une majeure : la gratitude pour la beauté du monde, la louange. L’autre mineure : résister aux forces adverses qui s’évertuent à nous faire taire et à maintenir notre entendement en deçà des possibilités du Logos.
C’est par mon enracinement dans la culture française que je peux comprendre la culture européenne, et par celle-ci, l’Orient proche ou lointain.
Ne pas avoir besoin de penser à Dieu, laisser le divin se penser librement en nous. La Théologie capitule dès lors qu’elle tente d’apporter la preuve de l’existence de Dieu. Les athées qui veulent apporter le preuve de l’inexistence de Dieu sont les ultimes héritiers de cette capitulation scolastique.
On peut passer sa vie à n’entendre en soi qu’un ressassement domestique et user toute son énergie et son ingéniosité à « gérer » et à planifier sa vie quotidienne. Châtiment terrible qu’amène l’illusion de la sécurité. Nous oublions que nous allons mourir et que ces brèves durées qui nous sont offertes, il faut les vivre !
Entre ne servir que ses intérêts et se faire kamikaze, il y a tout de même un presque infini de gradations. L’époque nuance peu. Entre ces deux obscurantismes, l’utilitaire profane et le sacrificiel aveugle, dont l’un appelle et justifie l’autre, ce qui demeure de la civilité européenne est pris en tenaille.
Hypnotisme, vacarme, distraction, machinisme, vitesse, communication, - autant d’expropriations de l’intellect. Nous perdons l’esprit, l’âme s’extravase dans le néant, le corps devient un objet.
Emotions courtes, surgies du manque de maîtrise de soi et aussitôt dissipées dans la vanité de l’air du temps. L’argument imbécile et mégalomaniaque contre un livre ou un film : « Je n’ai pas été ému ». Comme si votre émotion, Madame ou Monsieur, devait être le critère d’excellence des œuvres de l’esprit ! Nul cuistre, si cuirassé de certitudes soit-il, ne pourra jamais atteindre à une si faramineuse prétention.

Promiscuité moderne, distance moderne. Entassés devant les rames du métro, séparés par l’infini du « virtuel » devant leurs écrans. « Solidarité » à tous les étages de la « communication » et crevaison esseulée dans la rue ou dans les taudis. Se demander aussi pourquoi les Modernes se réunissent de préférence en des endroits où, sous la déferlante de musiques assourdissantes, ils ne peuvent plus s’entendre parler.
L’égocentrique irresponsable apprivoise fort bien l’autocritique, voire l’auto-accusation. Ses actes nuisibles ou vains, il en attribue la cause à ses « défauts » qui, étant parties constituantes de son « moi » le délivrent de l’effort de faire mieux. Sans compter que la vanité se satisfait tout autant à la considération complaisante de ses défauts et de ses vices que de ses qualités et de ses vertus. A l’inverse, quelques hommes de grand talent reconnaissent ingénument la qualité de leurs œuvres, sans être le moins du monde égocentriques ou imbus d’eux-mêmes.
Nous sommes des créatures météorologiques autant que sociales, et peut-être davantage. Le cosmos nous entoure plus continûment et plus étroitement que nos semblables.
Les disputes théologiques sont infinies car l’acception du mot Dieu varie infiniment selon les individus et selon les castes. Ce point le plus haut, le plus noble, ce principe suprême à partir duquel nous trouvons notre raison d’être sera pour les uns, le meurtre et la vengeance, pour d’autres, l’amour et le pardon, pour d’autres encore l’équanimité et la paix de l’âme. Les hommes sentimentaux y trouveront l’essence de leur sentiment dominant, les hommes d’esprit et d’espérance, l’Intellect qui sauve de la confusion morose. Certains y trouveront un recours à leur ressentiment, d’autres une louange universelle. Les athées, quant à eux, manquent à définir à quel dieu ils se refusent de croire. De ce fait, leurs théories sont des nuées lancées contre des nuées.
Ne pas oublier que toute démocratie tend naturellement au totalitarisme. « Transparence » et « communication » veut dire contrôle omniscient. L’époque n’est plus sous le signe de Prométhée, et pas encore sous le signe d’Hermès. Nous vivons un assez sinistre intermède sous le signe du docteur Mabuse.

Le comique involontaire de certains universitaires qui dissertent de « l’échec » de Proust ou de Musil, alors que chaque paragraphe, voire chaque phrase de la Recherche ou de L’Homme sans qualités est une irrécusable victoire sur la bêtise, la confusion, la lourdeur et la vulgarité. (Victoire dont on conçoit bien qu’elle n’est pas une bonne nouvelle pour ceux qui, par démagogie, luttent du côté des forces adverses !)
Ecrivains mozartiens : Jean-Paul Richter, E.T.A. Hoffmann. « Trop de mots » disent les imbéciles ; la phrase en voltes et virevoltes, l’ivresse intelligente, le fabuleux ironique, la danse. Les esprits lourds, qui ne savent sur quel pied danser, ne s’y retrouvent pas. La profondeur légère, le farfelu initiatique. La déroute de l’esprit de sérieux, mais, la nature haïssant le vide, celui-ci est aussitôt comblé d’innombrables bienfaits d’humour et de sagesse.
Les grands efforts naissent des grands repos, houles de fonds.
Nous mesurons à quel point l’esprit français, héritier de la logique grecque et des nuances chrétiennes, nous a sauvé, et pourrait encore nous sauver quelque peu, de l’abrutissement et de la folie. Cette considération n’a rien de partial. J’ai maintes fois constaté que, livrés à des familles ou des communautés obscures ou ineptes, qui les eussent réduits à la servitude ou au désespoir, des esprits furent sauvés, rendus à ce qu’il y a de meilleurs en eux-mêmes, par la compagnie de Rabelais, de Montaigne, de Corneille ou de Dumas et quelques bonnes conversations.
Distinguons l’esprit régional de la mentalité communautariste. Le premier est une distinction, en résonance avec le paysage, la légende et l’histoire ; il concerne les hommes « de chair et de sang » dont parle Mighel de Unamuno. Le second est replis sur « l’identité », autrement dit une soumission à l’abstrait. Les traditions existent ; les identités sont des fictions administratives. Les régions ont un esprit, qui souffle dans les feuillages, éveille les cœurs et les saveurs. Sapide sapience. « Nous habitons en poète » disait Hölderlin. Faunes et flores, sources sacrées, pierres sanctifiées, promenades, formes et forces de l’air, de l’eau, du feu et de la terre. Toute habitation, au sens hölderlinien, ouvre, par son enracinement même, sur l’universel.

Le fameux « langage du corps », de nos jours tant vanté, est beaucoup plus mensonger et artificieux que celui des mots. Les hommes peuvent mentir avec leur vocabulaire, et encore, mais leur syntaxe révèle immédiatement l’ordre ou la confusion qui règne et eux, et même leur humeur du moment.
Il y a mille façons de bien écrire qui se résument à une seule : suivre exactement le mouvement de sa pensée. Syntaxe simple ou complexe, vocabulaire élémentaire ou prodigue, sécheresse ou ébullition, lignes droites ou arborescentes, phrases calmes ou effervescentes, c’est selon ce que nous avons à dire, et qui invente la langue appropriée à son dessein. Les Modernes qui s’efforcent de bien écrire donnent souvent l’impression de traîner aux chevilles les chaînes et les boulets du condamné. Aucune aisance, aucune audace, ils s’appliquent ; on les devine inquiets de chaque mot qu’ils écrivent, non pour mieux servir leur vision mais par souci du qu’en dira-t-on. Le politiquement correct ajoute à leur terreur ; les voici compassés, notaires de province, bagnards de la convenance.
Nous ferons dans notre vie, en un peu plus grand, exactement ce que nous faisons en une journée.
Le péril est grand, à chaque instant, de perdre son esprit, son âme et d’avoir le cœur soulevé. Vaincre en soi le dégoût, le récrimination, le grief. Le pardon est la diététique nécessaire au combattant. La haine que l’on porte en soi est toujours à l’avantage de l’ennemi.
La patience présume la fulgurance du trait juste. Ceux qui ne savent pas attendre sont invariablement englués dans la lourdeur et dans l’inertie.
Limites du roman psychologique ou sociologique. Ne passer à s’observer soi-même et les autres qu’un temps donné. Aller au plus bref, là où brûle d’un feu clair l’interaction de l’observateur et de l’observé.
L’information quotidienne : despotisme de l’irrelié. Pensées en amas, ensevelissement. A partir de là, on se forme des opinions qui sont autant de refus de penser. En démocratie, ces refus de penser ordonnent jusqu’aux décisions politiques.

Saisir le moment juste, kairos, ne serait qu’un opportunisme si nous n’étions saisis en même temps que saisissants. Obéir à une instance plus haute, imprévisible, savoir la reconnaître… Lors que l’opportuniste suit simplement le courant. Le moment juste n’incline pas exclusivement à une action : il peut aussi être la corolle d’une gnose, d’une sapience. Le juste moment du non-agir : Tao.
Trop agir équivaut à s’enferrer, encombrer. Le monde est encombré d’activistes et d’affairistes de toutes sortes.
Les Modernes ne peuvent plus ni dire, ni penser le Mal comme défaillance du Bien. Aussi bien les voici à inventer des incongruités telles que le « crime contre l’humanité », comme s’il y avait d’un côté le crime, et de l’autre, l’humanité. Rien n’est plus humain dans sa défaillance que le « crime contre l’humanité ». Cessons de mentir.
Odieux mensonge encore qui voudrait nous faire croire que la vérité de la souffrance est supérieure à la vérité de la joie. Refuser de croire en sa souffrance. C’est déjà assez de souffrir, pour qu’il soit nécessaire d’y ajouter foi ! Voyez dans ce mensonge la propagande nihiliste, - celle qui tient à vous convaincre, contre toutes les évidences délicieuses, que vous ne pouvez pas être heureux. Et pourtant, vous l’êtes, heureux, inexplicablement, sachant que vous perdrez tout, que vous allez mourir, que le monde court au désastre. Vous êtes heureux précisément par cette science là.
Pour vivre simplement la beauté d’une heure, pour déjouer la propagande nihiliste, il faut une intelligence extraordinairement affûtée. Pour déjouer la peur : le sens des nuances et gradations. Quitte à passer pour un esthète, un joueur, un dandy, un superficiel. Le pire histrion est celui qui se représente lui-même comme un être « authentique », « naturel », « simple et sincère ». Ces gens là sont sur tous les écrans à nous enduire de leurs vaniteuses bonnes intentions, dans leurs bavardages filmés, entre la maquilleuse et le passage à la caisse. Ecologistes, pacifistes, « mutins de Panurge » selon la formule de Philippe Muray. Si l’on coupe le son, on entend quand même leurs phrases, toujours les mêmes. Si l’on ose les contredire, par l’usage courtois de la raison, aussitôt la riposte : le chantage à l’émotion.

Les Modernes peuvent se complaire dans une culture « trash » ou « porno-chic », ils restent d’effroyables puritains, moralisateurs, vindicatifs, revendicatifs, inquisitoriaux, persuadés d’incarner le Bien contre de méchants élitistes, raisonneurs, héritiers de la culture européenne antique ou médiévale. Mentalités crispées, sur la défensive contre ce qui pourrait les délier, leur rendre la juste mesure et « la simple dignité des êtres et des choses ».
Chez les "libres penseurs" associés, qui s’en font une idéologie, la raison devient une superstition servie par une cléricature hargneuse et jalouse. La pensée libre est une pensée solitaire. Mais un homme seul peut être l’héritier excellent d’une tradition, la porter à travers le temps, en fines pointes. La vérité vibrante et musicienne, l’étincelante beauté, la bonté qui bruit et obombre, comme un feuillage sur le front, incombe à chacun.
L’esprit prophétique dit la présence du souffle qui anime la phrase au moment où nous l’écrivons. En ce sens, il abolit le temps en une résolution qui justifie le « tout est écrit ». Encore fallut-il l’écrire et notre libre-arbitre, qui se forme à notre dessein, demeure souverain, comme le sera, comme l’est déjà, au-delà du temps, la phrase que nous écrivons. Le « tout est écrit » et le libre-arbitre n’entrent en contradiction que dans une conception linéaire et usuraire du temps, parfaitement étrangère tant à pensée traditionnelle qu’aux dernières avancées de la physique. Cette conception linéaire n’est plus accréditée que par les banques et le « gros animal » qui voudraient nous voir travailler pour notre plan de retraite : illusion largement entamée.
Ayant fondé toute morale sur l’utilitaire, et celui-ci s’effondrant dans son propre triomphe, nos contemporains seront sauvés par la persistance d’anciennes grammaires ou bien deviendront fous, hébétés ou fanatiques. La langue française fut longtemps cet ultime recours d’un ordre léger contre la pesanteur confuse, une façon de se détacher, d’échapper à la glue. Que peut une langue pour un esprit ?
Esprit prophétique : le souffle qui anime les mots, invitation à la virevolte heureuse, aux passages de l’air, au murmure des abeilles d’Aristée… L’inspir et l’expir et l’inspir. Le mouvement ternaire de la vague, de l’eau et de l’air que vient sacrer la lumière. Beauté baptismale. La parole est souffle, esprit. Ceux qui s’en privent ou en usent mesquinement seront étouffés : cadavres vivants, bouche béante, langue violette dans le cauchemar climatisé.
Une certaine désinvolture n’empêche nullement de mesurer les forces en présence, d’apercevoir l’armée noire qui vient sur nous, d’évaluer les conséquences du saccage, la fragilité de la beauté intelligente. Ne pas voir en face de soi cette ténébreuse ennemie, c’est se condamner à de faux combats, se complaire en de fausses tristesses. Entre le moment où nous savons que tout est perdu et le moment même de la perdition, il y a toujours, quelle qu‘en soit la durée mesurable, des éternités chatoyantes, des mondes d’extases, d’inconnues flammes claires d’écumes rieuses, des beautés anadyomènes. Rien ne peut empêcher la joie d’avoir été, - c’est-à-dire d’être, et mieux encore, dans le creuset du possible, un acte d’être, une ontologie à l’impératif : Esto !

L’immortalité de l’âme est une évidence. Ce qui anime s’engendre infiniment dans son propre mouvement.
Puritanisme et pornographie, avers et envers d’une époque sans âme, hostile par définition, restriction mentale et rétrécissement de l’entendement, à l’Eros comme au Logos. Que sera-t-il laissé à notre bon plaisir ? Le choix de nos funérailles ?
L’égalité devenue idéologie méconnaît la chance offerte à chacun d’être plus généreux que son voisin. Egalitarisme et pingrerie : tout vaut tout, autant ne rien donner à personne.
La beauté et la raison ne peuvent pas davantage contre la vengeance de la lourdeur et de la laideur que le plus beau vase chinois contre la main qui veut le briser. Nos plus honorables vertu sont à la merci.
« Les Forts, les Sereins, les Légers ». C’est ainsi que Stefan George nomme les poètes et les fondateurs, inventeurs d’une civilité à la fois immémoriale et nouvelle. Là tout est nommé de ce qui nous manque, à nous qui vivons au milieu des Faibles, des Excités et des Lourds dont l’activisme pollue le monde d’un vacarme nauséeux. Que cela fasse un peu silence, aussitôt surgissent les enchantements, les « paroles ailées ». Nos corps se délient, se dénouent, s’enlacent aux mouvements de l’air, à la chorégraphie universelle de tout, à la musique de l’âme du monde. C’est sans effort, avec une énergie librement disponible, au bon plaisir, que la force revient dans le calme, dansante.
Déjouer en soi le pathos du contre-nihilisme qui obéit au nihilisme, en reçoit les ordres en croyant s’y opposer. (On songe à l’admirable Mishima qui se tue pour s’opposer à la décomposition).
Courir plus vite que le nihilisme ? Se retourner pour lui faire face ? Ou bien, s’écarter et le laisser passer ?
L’homme de la tradition lègue, le Moderne consomme, ayant placé sa planète en viager à son seul profit. Générosité et mesquinerie ne produisent pas les mêmes effets. Ne nous étonnons pas de vivre dans une poubelle. Toi qui t’en plains, qu’as tu consommé, qu’as tu légué ?
Je n’ai jamais si peu, ni si mal étudié que lorsque je faisais des « études ». Je n’ai jamais été aussi inactif que durant les brèves périodes où j’étais dans la « vie active ». Nulle part l’égocentrisme ne m’est apparu plus cuirassé qu’au milieu de gens qui se réunissent pour « parler solidarité ». Ce sont des anti-racistes qui, le plus souvent, m’ont demandé, en me dévisageant, si j’étais vraiment un Français « de souche ». Il devient difficile d’ironiser sur le monde comme il va, antiphrastique, de sa démarche de crabe, impossible à parodier.

Sous le signe du docteur Mabuse, la société de contrôle va, à brève échéance, vers la connexion directe du cerveau humain avec la machine. Le mot d’ordre est « Connectez-vous ». Autrement dit, perdez radicalement ce qui pouvait encore demeurer de vos anciennes souverainetés. Qui ne voit pas dans les totalitarismes du début du siècle précédent la répétition un peu cafouilleuse d’un totalitarisme en train de se parfaire, restera dans cet en-deçà de l’esprit critique où l’on s’offre en proie aux mystifications élaborées ou grotesques.
La pensée du puritain ou du fondamentaliste tourne toute entière, comme l’âne attaché au piquet, autour de l’acte sexuel. Le libertin, reposé de ses frasques, a le loisir de penser à autre chose.
Nos forces, nos faiblesses sont issues d’une même réalité : nous n’avons plus de royaume. Nous errons, aberrants d’ici ou là. Il est possible de succomber à l‘absence de royaume, mais possible aussi de recréer en soi un royaume. Rien de triste. Cris de joie, courses, air libre, récréation générale ! Retour des divinités bruissantes, lumineuses qui nous arrachent à la torpeur, au bourrage. Vide enchanté, silence florissants. Peuplons, en souverain, d’oiseaux, de vocables volages, la liberté de l’air !

Les grands livres, eux aussi, creusent en nous du vide enchanté, ne fût-ce qu’en nous vidant de nos ressassements infirmes, en poussant aux périphéries de l’attention ce qui occupe la pensée sinistrée de nos contemporains. L’attention soudain délivrée du subalterne, du morbide, de l’obsession, s’ouvre à l’infinité de l’infime, à la simplicité du grandiose. Le Logos, alors, nous honore de ses vertus et une souveraine liberté nous vient à le servir.
Se défier des philosophes, des ésotéristes qui, tout en parlant de sagesse, semblent crispés sur leur dû et se perdent en polémiques hargneuses, personnelles. La sagesse est équanime et légère ou point du tout.
L’indignation est le talon d’Achille des grands esprits et la tourmente des petits.
Chaque heure paradisiaque peut être gâchée par la considération excessive d’un détail. « Ce qui ne va pas ». Quotidienne propagande médiatique reproduite, à l’identique, dans chaque individu qui croit aussi faire preuve d’esprit critique alors qu’il se laisse hypnotiser par le plus petit aspect du réel qui lui permettra de dénigrer tout le reste. Le nihilisme n’est pas le propre des penseurs. Il est ce mouvement de fond auquel, par démagogie ou inclination personnelle, certains intellectuels se raccrochent et s’offrent à bon compte le plaisir d’avoir l’air malin.
Nihilisme « soft » : utilitaire, classe moyenne, moralisateur, coincé. Nihilisme « destroy » : rock, spectaculaire, fusionnel, massif. On ne peut s’empêcher de penser que le nazisme fut un peu le mélange de ces deux-là qui, désormais, dominent à peu près la planète. Nous ne sortirons pas du nihilisme par un coup d’éclat mais par d’infinies nuances, une impitoyable douceur. Contre l’atrocité, se refaire une âme odysséenne, couleur de mer.
(...)
15:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Luc-Olivier d'Algange: entretien avec André Murcie
Entretien réalisé pour Littera-incitatus
Vous avez, cher Luc-Olivier d'Algange, publié naguère aux éditions Arma Artis, trois ouvrages, qui attendent actuellement (après le décès de Jean Marc Tapié de Céleyran, admirable éditeur, fondateur d'Arma Artis, dont il présidait, presque seul, aux destinées hautement philosophales) une réédition dont j'espère qu'elle sera aussi prochaine que possible. L'avis aux éditeurs audacieux est lancé ! Il s'agit de Fin Mars. Les hirondelles, qui est un recueil d’hommages à des auteurs et des lieux qui vous tiennent particulièrement à cœur, Terre lucide, écrit en collaboration avec Philippe Barthelet, sous-titré « entretiens sur les météores », et enfin, Le Chant de l’Ame du monde, qui s’achève par une Ode au Cinquième Empire, en hommage à Dominique de Roux. Il me semble que ces ouvrages, aussi distincts qu’ils soient par la forme, témoignent entre eux d’affinités et de résonances qui les inscrivent dans un même dessein. Pouvez-vous nous parler de ce dessein, autrement dit de ce qui, antérieur à votre écriture elle-même, suscite votre écriture, ou bien est-ce là s’aventurer dans une zone inviolable, radicalement inconnue, ou d’avance récusée théoriquement ?
Luc-Olivier d’Algange : - J’aime ce mot : dessein, que vous utilisez. Il me semble que notre temps, si planificateur, est aussi riche en « plans de carrière » qu’il est pauvre en desseins créateurs… Le dessein n’est pas un calcul sur l’avenir, et s’accorde fort bien avec ce que l’on peut nommer le hasard, la fortune, la chance ou la grâce. En écrivant, si l’on se tient à la disposition de ce qui advient on va littéralement Dieu sait où. Une grande part est laissée à l’aventure, « à la venvole » pour reprendre la formule de Philippe Barthelet.
Si l’écriture n’est pas seulement expression d’une pensée antérieure, si le langage est partie constituante et non seulement partie constitutive de la pensée, il s’en faut de beaucoup que l’œuvre ne soit qu’un « travail du texte ». En amont de notre langue, le Logos, qui se tient dans son royaume de silence, œuvre, à notre insu parfois, à notre délivrance et à notre souveraineté. En écrivant, nous sommes ses Servants. Une trame secrète se révèle peu à peu. Je ne puis me défendre de l’idée, peut-être étrange à la plupart des intellectuels modernes, que le livre que nous écrivons est déjà écrit dans quelque « registre de lumière », pour reprendre la formule des théosophes persans, dans un « suprasensible concret », que nos phrases tracées sur le papier (j’appartiens à ces archaïques qui s’offrent encore le luxe d’écrire avec de l’encre sur du papier) se révèlent par gradations, comme dans une lumière croissante. J’en veux pour preuve cette impression d’aurore fraîche, presque dure, qui environne le moment où nous allons commencer à écrire… Une phrase survient, et nous savons si peu où elle va nous conduire qu’il faut bien se rendre à l’évidence que nous ne sommes plus dans une activité susceptible d’être planifiée … Un ordre préside à ce chaos d’intuitions, une cohérence née de l’improvisation elle-même, et qui ne pouvait naître autrement. La notion d’inconscient, en l’occurrence, ne me paraît que partiellement opérante, et s’il s’agit bien d’un inconscient, je serais plutôt enclin à penser à l’inconscient de la langue française elle-même, sa part immergée, songeuse, étymologique, nervalienne, sa vérité héraldique, tisserande, qui, se servant de nous pour se révéler, nous tient littéralement à sa merci.

Tout cela pour vous dire que ni l’objectivité du travail stylistique, ni la subjectivité expressive ne me paraissent pouvoir rendre compte de ce qui est à l’œuvre. Ce qui se dit à travers nous nous appartient parce que nous lui appartenons, et cette appartenance, et là seulement intervient notre entendement singulier, nous libère, nous élargit, nous restitue à cette latitude humaine et divine que presque tout, dans le monde affairé où nous vivons, contribue à restreindre à l’extrême. Le Logos, en hauteur, en largeur et profondeur, dès lors que nous consentons à le servir avant de servir ce que nous croyons être nos compétences et notre subjectivité, nous ouvre à des vastitudes insoupçonnées. Ces vastitudes, plus encore que celles que l’espace visible, sont les espaces du temps.
Dans Fin Mars. Les hirondelles, dont le titre est un hommage à celui que Philippe Barthelet nomme « l’altissime Joseph Joubert », mon dessein fut de rendre le temps visible : temps des œuvres, des civilisations, et encore le temps comme attention, comme attente paraclétique, incandescente, telle qu’elle brûle dans les œuvres d’André Suarès ou de Dominique de Roux, ou, bien avant, dans celles de Ruzbehân de Shîraz, de Sohravardî, ou encore, d’une façon différente, chez Hölderlin ou Hermann Melville… Certaine oeuvres font date, elles participent des rythmes du temps, du renouveau du temps, et à partir d’elles si magnifiquement fidèles aux clartés antérieures, d’une certaine façon, tout recommence…. Et ce recommencement qui témoigne d’un au-delà du temps n’est lui-même qu’un retour à la vérité de l’être, c’est-à-dire à l’éclaircie de la toute-possibilité. Tout soudain, à relire ces auteurs, redevient possible ! Nous voici, les lisant, dans un usage sapientiel de la lecture, qui nous restitue à ce dont nous étions séparés par des illusions funestes… Voici l’inépuisable richesse du réel qui va de la substance la plus opaque à l’essence la plus lumineuse, en gradations infinies, dans ce chromatisme prodigieux dont surent si bien parler Ibn’Arabî et Jacob Böhme, mais aussi, d’une autre manière, ces écrivains, tels que Henri Bosco ou Henry Montaigu, qui, sourciers à l’écoute des ressources profondes de notre langue, en laissent circuler les vertus jusqu’aux plus hautes branches, aux plus fines, aux plus impondérables, les mieux accordées aux rumeurs célestes et aux puissances telluriques.
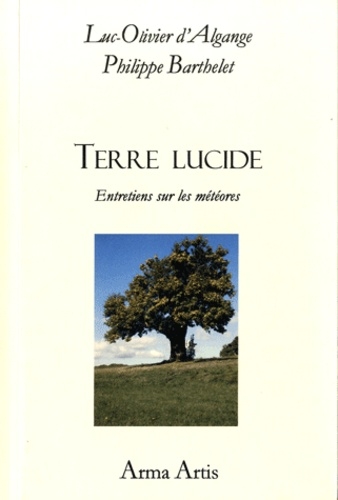
Nous voici précisément, il me semble, au cœur de votre ouvrage commun avec Philippe Barthelet, Terre Lucide, entretiens sur les météores. Il s’y dessine aussi un autre recours, celui de l’amitié, de la conversation, contre tous les systèmes et toutes les idéologies, ou plutôt, en dehors d’elles.
Luc-Olivier d’Algange : - Il y aurait peut-être une sorte de redondance à s’entretenir à propos d’un ouvrage qui est déjà un entretien, sinon à rappeler (comme hommage à ce qui me fut une chance rare) que Philippe Barthelet est, par ailleurs, l’auteur d’un vaste « roman de la langue française », qui s’ouvre, à chaque phrase, sur la plus exacte et la plus profonde méditation métaphysique. Le propre de notre ouvrage étant de ne pouvoir se résumer, de même que l’on ne peut résumer une promenade au bord d’un fleuve (et l’on sait aussi, par Héraclite, que « l’on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve »), je laisse le lecteur, si le cœur lui en dit, à découverte de ce livre quelque peu maistrien et dont il pourra lui-même, dès lors notre invité, être à la guise le Comte, le Chevalier ou le Sénateur ! Disons seulement qu’en ces temps monomaniaques, idéologiques et puritains rien ne semble plus rare que les bonnes conversations, et je ne suis pas loin de penser que presque toutes les œuvres dignes d’êtres lues participent ou invitent à une conversation ; qu’elle soit, bien sûr, avec le lecteur, ou avec des prédécesseurs, voire avec les êtres et les choses les moins saisissables : nuées, nuances, météores, signes du ciel… En réalité, il n’y a pas de monologue, sauf chez les fous ou les Modernes. Toute œuvre est, par nature, dialogique
Le Chant de l’Ame du monde est-il, en suivant votre idée, un dialogue avec l’Ame du monde ?
Luc-Olivier d’Algange : - L’Ame du monde est ce qui rend possible les conversations. Elle est la lucidité de notre terre. C’est dire qu’elle n’a rien d’abstrait ; elle n’est pas davantage, s’il faut le préciser, une sorte de « world music » adaptée aux besoins euphorisants du village planétaire, quand bien même lui revient une prérogative irrécusable d’universalité : celle du cosmos, tel qu’il se figure sur le bouclier de Vulcain dont parle Virgile. L’Ame du monde est la Sophia… Entre le sensible et l’intelligible, elle recueille les éclats de l’un et de l’autre, dans leurs mouvements, leur ressacs, leurs réminiscences qui irisent la présence pure. L’Ame du monde ne se conceptualise pas. Elle affleure, elle transparaît, dansante comme à travers le feuillage bruissant, comme l’épiphanie de la lumière sur l’eau, vérité insaisissable et lustrale, réfractée et diffractée, en splendeur, là où adviennent les Anges et les dieux, ces réalités à la fois intérieures et extérieures. Mais les poèmes, je le crains, ne se résument pas davantage que les conversations…
L’impression nous vient que, les ayant écrit, vous n’avez pas particulièrement de commentaires à ajouter à vos livres, soit par humilité, soit que vous les considériez comme derrière vous, soit que vous en laissiez le propos à vos lecteurs… S’il ne vous déplaît pas, nous aimerions cependant poursuivre cet entretien par des considérations plus générales, politiques, poétiques, et métaphysiques, qui nous reconduiraient à ce qui a donné naissance à ces ouvrages… Et pour commencer, quels sont vos Maîtres ?
Luc-Olivier d’Algange : - Nos écrits ne sont pas toujours « derrière nous », ils sont peut-être lancés en avant, ce vers quoi nous cheminons ; ce qui rendrait d’autant plus difficile d’y revenir, d’en faire le commentaire, sans compter le ridicule à être son propre glossateur ! Et puis, le « monde culturel » me semble avoir tourné de telle façon que l’on cherche bien souvent à se faire une idée des ouvrages d’un auteur sans les lire. Alors autant ne pas abonder dans le sens de cette mauvaise paresse et s’attarder indûment sur ce qui a déjà été écrit, et qui le fut précisément, pour échapper à ces quelques opinions, abstractions ou généralités où les gens « informés » voudront les ensevelir ! En revanche, et j’en suis bien d’accord avec vous, parler de ses Maîtres est un devoir de gratitude, et surtout une joie qui renouvelle celle que nous avions à les lire.
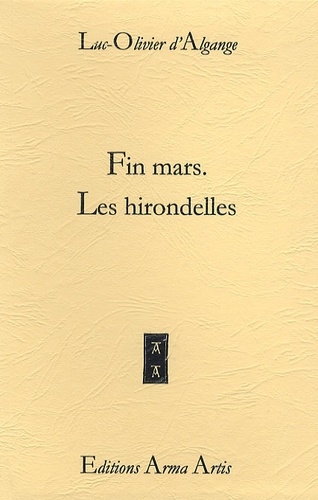
Je considère comme des Maîtres tous les auteurs qui m’ont appris quelque chose, et ils sont nombreux. Mais pour en distinguer quelques uns, outre ceux dont je parle dans Fin Mars. Les hirondelles, peut-être convient-il d’en revenir aux premiers en date, à ces lectures de l’adolescence, qui nous donnent des raisons d’être, nous confirment dans nos audaces, affermissent notre courage et notre intelligence. Au monde souvent mesquin et étriqué qui s’apprête à nous dévorer dans la tendreté de notre âge, ils opposent un contre-monde, qui n’est pas un refuge mais une exigence plus haute. Ceux-là sont des amis ; ils nous donnent des armes et nous montrent le monde plus grand, plus intense, plus aventureux. Car enfin, l’inanité est là, depuis notre adolescence : le monde devient un monde-machine, toutes les souverainetés sont corrodées, arasées. L’infantilisme et la bestialité triomphent sur tous les fronts, et après deux ou trois vagues de totalitarisme, depuis la Terreur de 1793, les hommes se sont si bien habitués à n’être que des « agents » et des « rouages », leur servitude volontaire est si bien intégrée à leur complexion, à leur physiologie même, que la survie de l’esprit humain, dans ses pouvoirs de discrimination et ses puissances poétiques, est devenue des plus aléatoires, alors même que la Machine, autrement dit, la société de contrôle (qui succède, pour tout arranger, aux sociétés de souveraineté et aux sociétés disciplinaires) travaille sans relâche à éliminer précisément toute chance d’être, toute chance, selon le mot d’Hölderlin « d’habiter en poète ». Deux maîtres donc : Villiers de L’Isle-Adam et Hölderlin.
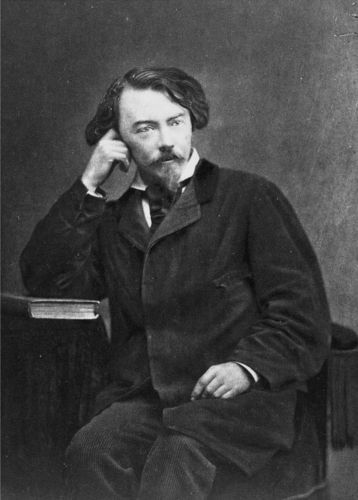
Villiers de L’Isle-Adam fut l’auteur qui m’arracha à ce qui me semblait devoir être une triste singularité. Il me vint à cet âge inquiet où il s’en faut de peu que nous ne concevions, non sans quelque effroi, être fort esseulés dans notre pensée. Certaines œuvres sont, pour ainsi dire, en forte teneur d’amitié spirituelle. Il semble qu’une main nous soit tendue, mais avec une arme, fraternellement, à nous qui étions désarmés. Une contradiction se trouvait résolue. Nous pouvions donc, en même temps, récuser la société et consentir à être les héritiers de la civilisation, porter un songe de splendeur et exercer nos sarcasmes à l’égard d’un monde qui s’acharnait en médiocrités despotiques à nous rendre la vie apeurée, misérable et banale. Refuser d’un même geste l’avilissement et le nihilisme, ne pas vivre en bête traquée, tout cela tient dans la dédicace de L’Eve future : « Aux railleurs, aux rêveurs ». Le rêve devenait ainsi, non plus une fuite, mais un Songe plus haut, fondateur, celui-là même dont naissent les civilisations. Les Contes Cruels anticipent, en tout point, et parfois à partir d’infimes indices, ce monde ridicule, malfaisant et sinistre que décrira plus tard, mais en l’ayant sous les yeux, Philippe Muray… Villiers de L’Isle-Adam, lui, nous donne l’alexipharmaque avant même que le poison ne ruisselât dans nos veines ! Magistrale leçon d’ironie guerroyante, ouverte à chaque phrase sur des hauteurs et des profondeurs métaphysiques ; humour cruel et fidélité pure, c’est-à-dire brûlante, à l’égard de ce qui, dans notre bref séjour ici-bas, nous tient dans la proximité ardente de la voix du cœur et de la beauté ; pessimisme alerte et joyeux ; ethos héroïque qui répond, avec la désinvolture aristocratique qui lui est propre à la mise-en-demeure d’Hölderlin : « A quoi bon des poètes en des temps de détresse ? » A quoi bon ? A rien du tout… Mais à l’entendre ainsi, dans la définition que Pessoa donne du Mythe, « ce rien qui est le tout », sceau invisible de cette visible empreinte qu’est le monde.

Nul, de façon plus radicale qu’Hölderlin, n’eut l’audace de se tenir en cet espace intermédiaire, à la fois éblouissant et ténébreux, mais aussi parfois clair d’une douce clarté et comme à l’ombre de feuillages orphiques, où le Mythe vient à la rencontre du réel pour en révéler la nature véritable. Hölderlin n’écrit pas à propos du Mythe, ses poèmes ne sont pas des poèmes mythologiques, au sens néo-classique ou romantique, mais des épiphanies survenues, de façon imprévisible, à l’intérieur de la langue allemande. Hölderlin parle de l’intérieur : il est le feu qui éclaire et consume. Le sacré, le Mythe sont, chez Hölderlin, des advenues, l’apparaître de l’apparition elle-même, qui naît au moment où nous naissons avec elle. C’est ainsi qu’il peut laisser transparaître l’une dans l’autre la figure du Christ et celle d’Apollon, c’est ainsi que sa poésie nous dit, du sacré, une profondeur en attente, qui, jusqu’à présent, fut à peine entrevue, c’est ainsi que le plus lointain, le plus antérieur, s’irise dans ses écrits comme une promesse encore insoupçonnée.
La plupart des œuvres, quand bien même s’amoncellent à leur sujet des thèses universitaires, n’ont pas encore été lues. Je veux dire que réduites au statut d’objets, un interdit à les lire n’a pas encore été levé. Etudiant les œuvres, les tenant à distance par des méthodes critiques, on s’épargne la chance et le risque d’en être ravi, c’est-à-dire dépossédé du rôle d’analyste auquel se complaisent nos arrogances intellectuelles. Au-delà même de l’expérience sensible et intelligible que nous pouvons avoir d’une œuvre, qui est déjà elle-même supérieure à la simple étude universitaire, une autre possibilité demeure « en réserve », selon la formule de Heidegger, qui est celle de la relation avec l’œuvre. C’est du passage de l’expérience à la relation, c’est à dire à la survenue d’une conversation dont témoignent à leur mesure Fin Mars. Les hirondelles, et, d’une façon plus directe encore, Terre Lucide. En son hiver, il me semble que notre civilisation est en attente d’un printemps herméneutique, d’une terre lucide annoncée par ces météores, ces « signes du ciel » que sont les œuvres des poètes.
Nous retrouvons dans ce printemps herméneutique, votre méditation sur les saisons, sur le retour, sur le temps qu’il fait et celui qui passe. Quel serait le « temps » de l’herméneutique ?
Luc-Olivier d’Algange : - L’herméneutique nous initie à une autre temporalité. Ni le cercle, ni la ligne droite mais une sorte de spirale qui, repassant par les mêmes points, nous porte plus haut. L’herméneutique, et que l’on entende bien sous ce vocable austère, un voyage odysséen et non un travail d’expert, fait apparaître dans une œuvre plus qu’à première vue. Ressaisissons notre bien : ne le laissons pas au seul usage des spécialistes. Les œuvres sont des signes d’intelligence que nous adresse l’aléthéia, la vérité qui n’est pas objet d’évaluation mais l’instant de sa propre révélation. Les abysses lumineuses des poèmes d’Hölderlin disposent nos entendements aux abysses lumineuses de l’instant qui est l’éternité même. Celle qui oscille dans les fleurs de cerisiers !
A chacun d’entre nous une œuvre reste à accomplir qui est de se réapproprier ce dont le monde-machine nous a exproprié : les paysages, les heures, les noces d’Eros et de Logos, la qualité et la dignité des êtres et des choses. Mais cette recouvrance si elle exige une décision résolue, n’implique nulle âpreté. Il ne s’agit pas d’être crispé sur son dû, mais de s’abandonner à ce qui nous appartient : ce temps qualifié, ces événements de l’âme. Nous reprenons possession du monde comme d’un texte sacré en refusant de le planifier, en lui laissant la chance de nous faire signe, en aiguisant notre entendement à percevoir ces subtiles invitations par-delà « le vacarme silencieux comme la mort » dont parlait Nietzsche.
Voyez comme les prétendants littéralistes préjugent dans les textes sacrés de la « vérité » qu’ils y veulent trouver pour ensuite l’administrer, et comme ils laissent peu de place à la surprise, et comme ils trahissent en réalité la lettre à laquelle la véritable herméneutique retourne, comme Ulysse après son périple. Toute opinion est fondamentaliste, hostile par ses prémisses et ses usages à l’aventure de l’esprit. S’il importe de ne jamais oublier que nous vivons sous le règne de l’Opinion, il importe encore davantage de ne pas se laisser subjuguer ou obnubiler par la terreur qu’il prétend nous inspirer. Ce qui n’est pas, fût-ce en néant dévorant, ne peut en aucune façon triompher de qui est, ni empêcher ce qui fut d’avoir été et de demeurer présent dans la présence, dans la délicieuse anamnésis dont l’essor se confond avec le pressentiment lui-même, avec ce qui crée et ce qui fonde.
La didactique coutumière, scolaire, oppose le platonisme et l’hédonisme, comme elle suppose que la philosophie platonicienne oppose le sensible et l’intelligible pour déprécier l’un au détriment de l’autre, alors qu’elle les hiérarchise, ce qui est tout différent ! Cette mésinterprétation banale de la pensée platonicienne procède de la difficulté que nous avons, nous autres modernes, à sortir d’une pensée de l’antagonisme. Hiérarchique, graduée, la pensée platonicienne récuse par avance l’antagonisme que les exégètes futurs y voudront introduire. Le sensible ni l’intelligible ne sont, en soi, préférables l’un à l’autre, ce ne sont pas des camps, des partis, mais des modes opératoires de notre compréhension du monde et dont les œuvres sont les noces ardentes.

Si l’on me dit qu’un hédonisme néoplatonicien est impossible, que la louange du sensible, la relation extatique avec le monde sensible est impensable par la célébration de l’Idée, de la Forme, eh bien soit : je l’invente, je la rend possible, je l’instaure, j’en fais la prémisse d’une philosophie nouvelle ! Mais, à dire vrai, je ne crois pas être si novateur, mais seulement l’héritier d’un courant philosophique moins connu, moins balisé, d’une façon de philosopher, d’un poien qui, à l’exemple de Plotin, de Sohravardî, de Ruzbehân de Shîraz, de Pic de la Mirandole, ou de Marsile Ficin, hiérarchise pour ne pas opposer, ce qui appartient au visible et ce qui appartient à l’invisible, l’un et l’autre n’étant que des moments différents de l’apparaître.
Cette tradition héliaque, métaphysique et patricienne, tenue à l’écart par une idéologie dominante, lunatique et matérialiste (celle précisément des « hallucinés de l’arrière-monde » dont parle Nietzsche) me semble non seulement devoir être défendue et illustrée, par l’exemple, par la beauté du geste, mais aussi en tant qu’art poétique et romanesque, si lassés de l’expression de la subjectivité, nos contemporains désirent à nouveau tenter la grande aventure des états multiples de l’être et de la conscience. De même que le printemps herméneutique éveille et discerne dans les textes les « états » et les « stations », les degrés et les plans d’interprétation différents, on peut espérer et imaginer un printemps poétique et romanesque où, à l’hiver du durcissement des certitudes, à l’aridité et aux froidures conceptuelles, formalistes ou vengeresses succéderait un ressaisissement du chant et de la vision.
« Ne servir que sa vision » écrivait Dominique de Roux, qui recommandait aussi de ne pas oublier notre exil fondamental, et que « nous sommes partout et toujours en territoire ennemi » : observation qu’il importe, il me semble, de ne pas prendre dans un sens pathétique, mais plutôt pragmatique, à la façon de Marc Aurèle. Chaque heure que nous sauvons de la confusion, de l’agitation, des promiscuités débilitantes, chaque heure sauvée de l’endormissement hypnotique du travail et des distractions, chacune de ces heures est une victoire : nous y retrouvons, sauvegardées et d’une fraîcheur castalienne la puissance, la beauté et bonté. Les mots ont le pouvoir de recréer ce qu’ils détruisent.
Que pouvez-vous nous dire à propos de cette tension entre le pouvoir créateur et le pouvoir destructeur du langage ?
Luc-Olivier d’Algange : - Les mots tuent, au propre et au figuré, et parfois d’ennui. Les totalitarismes nomment pour tuer en renversant la « logique » de la divine création qui nomme pour faire advenir à l’être. Le totalitarisme dédit ; son jargon est la mesure de sa perversion : ce qu’ont démontré, de façon magistrale, Orwell ou George Steiner. La définition du mal échappe aux moralisateurs pour autant qu’ils méconnaissent cette atteinte au Logos ou au Verbe. S’il est bien souvent question, dans Terre lucide, des ressources de la langue française, c’est qu’en elles s’avivent nos pensées. Par cette langue nous appartenons à une tradition qui nous libère de nos subjectivités outrancières et nous donne la latitude de penser, c’est-à-dire de peser le juste et l’injuste… Il n’est pire conformisme que celui du « non-conformisme » où chacun croit pouvoir penser par lui-même dans le déni de toute tradition et de tout héritage, et s’en trouve ainsi penser comme tout le monde, exactement selon le vœu des « prescripteurs » de la publicité. Les dogmes, les doctrines, laissaient encore la part à la critique, alors que le conformisme de l’informe est une glue, un totalitarisme sans issue, car il enferme chacun en lui-même… Bienvenue dans le monde du « chacun pour soi » où règne le grégarisme au suprême, où la bétaillisation de l’être humain se fonde non plus sur un despotisme discernable mais sur une servitude volontaire, oublieuse de sa volonté, relayée par la technique et devenue presque physiologique, au point qu’il n’est pas absurde parler d’une post-humanité, mais régressive, à la fois hyper-technologique, numérisée, clonée, et psychologiquement réduite à l’infantilisme. Le conformisme de l’informe devient ainsi le principal recours des faiblesses coalisées contre la singularité et la force, en meutes d’autant plus impitoyables qu’elles travaillent, comme l’écrivait Philippe Muray, pour « l’empire du Bien ».
Que reste-t-il alors des sentiments humains, une fois débarrassés des intempestives grandeurs ? La langue s’y étiole, l’entendement s’y rabougrit, la privation sensorielle s’instaure disposant la conscience à ne percevoir que des représentations secondes, au détriment de la présence réelle des êtres et des choses, présence réelle qui contient en elle les abysses et les hauteurs, une verticalité qui sacre l’Instant, notre seul bien… Le printemps herméneutique est à la pointe de chaque phrase lue ou écrite amoureusement ! Le printemps herméneutique est la floraison du Logos qui, à partir de ses racines, de ses étymologies, délivre la puissance du silence, de son cœur de feu, de sa vérité paraclétique.

Dans Fin Mars, les hirondelles, vous évoquez le Paraclet, à propos d’André Suarès, d’Henry Corbin et de Dominique de Roux. Pouvez-vous nous préciser ce qu’est le Paraclet, et son « règne » dont certaines œuvres vous semblent l’attente ardente ?
Luc-Olivier d’Algange: - Le Paraclet est l’Esprit-Saint, et le règne du Paraclet qui succède au règne du Fils, comme celui-ci succède au règne du Père, serait l’accomplissement de l’Alliance, l’accomplissement d’une liberté souveraine, d’une terre céleste, lucide… Cependant, je suis loin de prétendre à théoriser en ce domaine, et plus loin encore de comprendre comment s’inscrirait dans « l’histoire », cette succession de règnes qui, d’une certaine façon, m’apparaissent pour ainsi contemporains les uns des autres ; de même que dans l’écriture, qui se situe entre le silence et la parole, le silence de « ce qui n’est pas encore dit » et la parole dont on se souvient, le temps est bien davantage qu’une ligne droite, qu’une historicité déterminable et déterminante…. Entre le Logos rayonnant du silence de la toute-possibilité et la parole filiale, la parole en filiation spirituelle, le Paraclet gradue ses révélations dans notre conscience. Il est cet « entre-deux » entre ce qui est dit et celui qui reçoit la parole, cet espace intermédiaire et impondérable comme le sens lui-même qui s’offre à être traduit du silence.
Le temps a été créé avec le monde pour peupler de réminiscences les commencements sans fins. Chaque phrase que nous écrivons ne vaut d’être écrite que si, d’autorité, elle recommence le monde. Le Logos et le Verbe disent une même réalité cosmogonique. La poésie, à cet égard, consiste moins à ré-enchanter le monde qu’à lui ôter le voile qui nous le désenchante, qu’à l’arracher aux fictions misérables et sinistres qui font que la réalité, comme l’écrivait Rémy de Gourmont, finit par copier les mauvais romans : monde plat, sans syntaxe ni grammaire, mots réduits à leurs écorces mortes, sentiments et vertus réduits à l’apparence qu’ils donnent selon les normes du kitch, dérisoire ou titanesque… Le nouveau règne, celui dont parlait Stefan George, débute sitôt que l’on s’éveille de ce mauvais songe, de cette pensée stéréotypée, binaire, qui nous réduit à l’alternative ou au compromis. Et comme l’écrivait Rimbaud : « là tu te dégages, et voles selon. »
(Entretien réalisé par André Murcie pour Littera-incitatus)
13:45 Publié dans Entretiens, Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, philosophie, entretien, andré murcie, luc-olivier d'algange, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook